Henri Maspero (1883-1945)
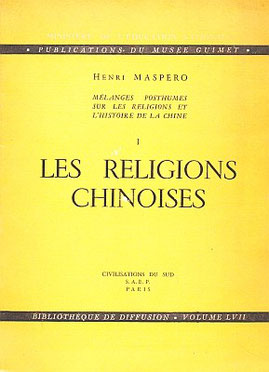
LA RELIGION CHINOISE DANS SON DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE
Mélanges posthumes sur les religions et l’histoire de la Chine,
Publications du Musée Guimet, Paris, 1950, volume I, pages 15-138.
- "L’histoire de la religion chinoise est celle d’un développement continu depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Ce n’est pas à dire que rien n’ait jamais changé et que les croyances d’aujourd’hui soient celles d’autrefois ; dans ce pays comme partout, les révolutions politiques et les transformations de la société ont eu des répercussions profondes sur les idées religieuses."
- "Mais les idées nouvelles se sont toujours introduites assez progressivement pour pouvoir s’intégrer dans le cadre ancien sans le faire éclater ; il ne s’y est jamais produit aucune de ces révolutions complètes qui, en Occident, sont venues à plusieurs reprises interrompre la continuité, conversion au christianisme, puis conversion à l’islamisme dans une partie de l’Orient, et réforme encore plus tard dans une partie des pays occidentaux."
- "Certes, il ne reste plus grand-chose des croyances antiques dans la religion chinoise moderne, à peine quelques idées générales, et peut-être même une manière de sentir plutôt qu’une croyance définie. Mais le cadre a subsisté, en se vidant peu à peu de sa substance ancienne, que sont venues remplacer sur bien des points des notions différentes ; et les Chinois n’ont jamais eu cette sensation de rupture brusque avec le passé, cette condamnation des croyances antérieures, qui caractérisent l’évolution religieuse de l’Occident. Cela a suffi pour leur donner l’illusion que la religion actuelle est encore la religion antique, et pour qu’en maintenant la tradition de l’antiquité ils en conservent quelque chose."
Extraits : La religion antique - La religion populaire moderne
Feuilleter
Lire aussi
Chez les plébéiens, peuple de paysans, le culte suivait exactement le rythme des travaux des champs. Au début du printemps, le commencement en
était marqué dans chaque village par l’ouverture cérémonielle de la terre ; on annonçait la nouvelle au dieu du Sol, car, souverain divin du territoire du village, il veut savoir tout ce qui s’y
passe. Mais, avant de commencer réellement les travaux, il fallait encore chasser les mauvaises influences, restes de l’hiver, saison de froid, et de stérilité. Et comme, dans la Chine ancienne
comme en beaucoup de pays, la fécondité de la terre et celle des familles apparaissaient comme liées, c’étaient les mêmes cérémonies qui, en chassant l’influence mauvaise de l’hiver, marquaient
le commencement de la saison agricole et le commencement de la saison des mariages. Chaque pays avait pour cela des fêtes différentes où jeunes gens et jeunes filles jouaient le premier rôle. Au
Tcheou et au Tcheng (Nord du Ho-nan actuel), ils allaient ensemble au confluent des rivières Tcheou et Wei quand venait le dégel, et les jeunes filles, une orchidée à la main, appelaient les deux
espèces d’âmes humaines houen et p'o, pour les réunir, ramenant ainsi pour l’année nouvelle la fécondité. Au Tch'en (Sud-Est de la même province), ils dansaient ensemble sur un
tertre Yuan en agitant des plumes d’aigrette. Et presque partout ils allaient chanter par groupes ou par couples dans la campagne, et leurs chants s’achevaient dans des unions en plein air. La
fête du dieu du Sol était connue pour se terminer par des scènes que réprouvait fort la morale des lettrés au temps des Royaumes Combattants. Ces mœurs n’étaient pas particulières aux Chinois :
elles étaient celles de tous les peuples agricoles de l’Asie du Sud-Est, et on les rencontre encore partout où les circonstances locales ont retardé le développement propre de certaines tribus,
ou les ont tenues à l’écart des grands courants de civilisation, chez les Lolo par exemple ou les Miao-tseu ou les Tai. J’ai assisté à des fêtes de ce genre chez les Tai-Noirs du Haut Tonkin, et
vu au printemps jeunes gens et jeunes filles partir de leurs villages en groupes, et faire quelquefois deux à trois jours de marche dans la forêt pour aller chanter dans la grotte que la
tradition a consacrée à cette coutume.
C’est après ces fêtes que les paysans se rendaient au défrichement, abandonné depuis la fin de l’automne :
Aux jours du 3e mois, nous prenons nos houes ;
Aux jours du 4e mois, nous partons (du village),
Avec nos femmes et nos enfants,
Qui nous apportent à manger en ces champs méridionaux.
Si le défrichement était ancien, il était laissé à l’abandon depuis sa récolte : si c’était un nouveau défrichement, le terrain choisi avait été
incendié l’année précédente au moment de la chasse de printemps, et pendant toute l’année on y avait fait le plus gros ouvrage. Ils le mettaient en état, dessouchaient, désherbaient, houaient,
semaient ; puis au troisième mois, quand approchait l’été et que les semis grandissants exigeaient un labeur constant, binage, sarclage, et une surveillance de tous les instants contre les bêtes
sauvages, tous, hommes, femmes et enfants quittaient la maison du hameau pour aller s’installer dans des huttes près du défrichement. Et en partant on «faisait sortir le feu», en éteignant le
foyer de la maison pour rallumer avec un foret un feu nouveau sur une aire en plein champ.
Les travaux absorbants de l’été et de l’automne, et l’éloignement des villages, ralentissaient pour un temps le rythme des fêtes, à moins qu’il n’y eût une longue sécheresse et qu’on ne dût
demander la pluie. Ce cas excepté, ce n’est que vers la fin de l’année que la vie religieuse reprenait son activité, avec la fin des travaux des champs. Au neuvième mois, les paysans faisaient «
rentrer le feu » et se réinstallaient dans leurs maisons du village : une lustration chassait les influences de l’été devenues nocives pour la période de repos qui s’ouvrait ; on annonçait au
dieu du Sol le retour au village. Puis, la moisson faite, les grains engrangés, l’année se terminait par la fête de la moisson, grande fête paysanne à laquelle tous, seigneurs et manants,
devaient prendre part, également vêtus en paysans. On l’appelait la « Grande Fête en l’honneur des Huit qu’on va chercher » pa-tcha ou ta-tcha. On y présentait toutes les
espèces d’offrandes, produits de la culture, de la chasse, de la pêche. L’esprit principal était le Premier Moissonneur ; à côté de lui, on sacrifiait au Premier Laboureur, au Premier
Constructeur de Digue, au Premier Bâtisseur de Huttes; et ensuite aux esprits des chats mangeurs de rats, à ceux des tigres mangeurs des sangliers : en un mot, à tous les esprits qui présidaient
aux divers moments de la culture ou protégeaient la moisson. C’était une vaste mascarade : les esprits des chats et des tigres étaient représentés par des enfants et des hommes masqués et
déguisés, qui se comportaient comme les animaux dont l’âme les possédait, sautant, criant, griffant. Les offrandes étaient consommées sur place en un grand banquet qui s’achevait en une vaste
orgie. C’était la fin de tout travail des champs pour l’année. Désormais nul ne devait plus toucher à la terre, même les animaux devaient être écartés des pâturages et rentrer à l’étable, et les
hommes s’enfermaient dans les maisons en lutant les portes. L’interdit était sur le sol jusqu’à ce que le printemps ramenât le recommencement du cycle des cérémonies.
Les cérémonies saisonnières des seigneurs et de la cour royale ne différaient guère de ces fêtes paysannes que par une solennité et une pompe plus grandes ; mais c’étaient exactement les mêmes.
Aucun village ne pouvait célébrer une fête avant que le seigneur ne l’eût célébrée lui-même au lieu qu’il habitait. Le roi ouvrait la terre de son domaine au « Champ du Seigneur » (c’est-à-dire
du Seigneur d’En Haut), ti-tsi, terrain dont la récolte était réservée à la fourniture du grain pour les sacrifices. Dès que le jour faste avait été fixé par la divination, le Grand
scribe l’annonçait au roi en disant — « Dans neuf jours, la terre sera remuée ; que le roi se purifie respectueusement, et qu’il dirige le houage sans rien changer ! » Au jour dit, le roi
commençait par offrir un suovetaurile à l’Ancêtre de l’Agriculture, la Grande Offrande comme disaient les Chinois, taureau, bélier et porc ; puis, vêtu en paysan, il enfonçait lui-même
la houe dans le sol et soulevait trois mottes de terre ; après quoi les ministres, les grands officiers et tous les gens de la cour, chacun suivant son rang, achevaient le houage de mille
arpents.
Quelques unes de ces fêtes — ouverture du sol pour le désacraliser, ouverture de la saison des mariages par le sacrifice au Haut Entremetteur, sacrifices du printemps et de l’automne au dieu du
Sol, sacrifices pour la pluie en été —, en se transposant ainsi en fêtes royales ou seigneuriales, prenaient un caractère particulier. Le sacrifice du printemps au dieu du Sol était suivi d’une
revue des troupes qu’on présentait au dieu et qui prêtaient serment devant son tertre servant d’autel. Dans le Domaine royal et dans quelques principautés (par exemple Lou au Chan-tong, et Song
au Ngan-houei, mais non dans le Tsin au Chan-si, autant qu’il semble), la série des fêtes s’ouvrait au printemps et se finissait en automne par un sacrifice au Seigneur d’En Haut ; au printemps,
c’était le sacrifice sur l’Autel du Ciel, tertre rond en plein air, sans temple, dans la banlieue Sud de la capitale Nan-kiao ; en automne le sacrifice se faisait au Temple Ancestral, ou dans cet
énigmatique Palais Sacré, le Ming-t'ang. Celui-ci paraît avoir été l’antique demeure royale au temps où le roi, personnage sacré, ne se mêlait pas à la foule des hommes mais vivait, au milieu
d’interdits, dans un palais entouré d’un fossé plein d’eau ; mais à l’époque historique, et quand furent écrites les odes sacrificielles du Che-king (VIIIe VIIe siècle), ce n’était plus
que le temple du pouvoir royal autour duquel les ritualistes du IVe et du IIIe siècle a. C. ont créé une atmosphère mystique impénétrable.
Le changement de vie des hommes, passant de la maison du village à la hutte des champs au printemps, et revenant des huttes aux maisons en automne, s’accompagnait d’un déplacement semblable du
Seigneur d’En Haut, qu’on conduisait hors de la ville au printemps en lui sacrifiant en plein air, et qu’on ramenait à la ville en automne en lui sacrifiant à l’intérieur d’un temple.
Ces deux sacrifices au Seigneur d’En Haut étaient les fêtes les plus solennelles du rituel royal. Tout ce qui prenait part à la cérémonie devait être rituellement pur : sacrifiants, assistants,
offrandes ; le roi et tous les assistants gardaient l’abstinence dix jours ; et le jour du sacrifice, aucune personne en deuil ne pouvait entrer en ville ni aucun rite funéraire être célébré. Le
roi tuait lui-même à coups de flèches la victime, un jeune taureau roux, dont le corps entier était brûlé au sommet du tertre pour monter au ciel en offrande dans la fumée ; et pendant
l’holocauste, les musiciens aveugles chantaient :
Nous remplissons d’offrandes les coupes en bois,
Les coupes en bois et les coupes en terre ;
Dès que le parfum en est monté,
Le Seigneur d’En Haut se met à manger.
On offrait ensuite un second taureau non plus au Ciel, mais au Premier Ancêtre de la famille royale qui servait d’intermédiaire entre le Roi et
le Seigneur d’En Haut, divinité trop haute pour qu’on pût s’adresser, à elle directement. Et la fête se terminait par une grande danse à la suite de laquelle on mangeait la victime présentée à
l’Ancêtre.
Le culte des Ancêtres s’entremêlait à ce culte agraire, tout en ayant ses cérémonies propres. D’une part, on offrait aux Ancêtres chaque mois les prémices des fruits de la saison ; de l’autre,
chacun d’eux avait son anniversaire. Ces jours là, l’esprit descendait et venait posséder un de ses petits fils désigné d’avance pour ce rôle : l’enfant recevait les offrandes à la place de
l’Ancêtre, se mêlait aux assistants, offrait et acceptait à boire, parlait et agissait sous l’impulsion de l’Ancêtre qui le possédait, puis se retirait après avoir exprimé sa satisfaction et fait
des promesses de bonheur :
Le prieur habile reçoit la déclaration (des esprits)
Et va la porter aux pieux descendants :
De bonne odeur est le pieux sacrifice,
Les mânes sont satisfaits des boissons et des mets ;
Ils vous accordent un bonheur centuple
Tels vos désirs, telles vos réalisations !
Pour toujours ils vous accordent les plus hautes faveurs
Par dizaines de mille, par centaines de mille.
Après le départ de l’Ancêtre, tous les assistants mangeaient ses restes en un banquet ; on en envoyait même une partie à ceux des descendants qui
n’avaient pu être présents. Ainsi la continuité du lien de famille se resserrait chaque année pour tous les membres dans la communion du repas sacré où l’on mangeait les offrandes à l’Ancêtre
commun.
Culte agraire, culte ancestral, tout se passait en cérémonies publiques, où offrandes et prières étaient faites pour un groupe constitué, famille, seigneurie, etc., par son chef, et jamais pour
une personne en particulier. Ceux qui avaient des demandes à adresser aux dieux pour eux-mêmes devaient aller chercher des intermédiaires particuliers, les sorciers et les sorcières de classe
diverse, médiums, médecins, faiseurs de pluie, exorcistes, etc., car ceux-ci, ayant des relations personnelles avec les esprits, allaient leur porter les demandes des suppliants. L’esprit
descendait dans leur corps et s’en emparait : «Ce corps est celui de la sorcière, mais l’esprit est celui du dieu.» La sorcière se purifiait en se lavant le visage avec de l’eau où avaient
bouilli des orchidées et le corps avec de l’eau parfumée à l’iris ; puis elle se vêtait des habits de la divinité qu’elle allait appeler. Les offrandes préparées, elle envoyait son âme chercher
cette divinité et la ramenait en son propre corps ; et elle mimait le voyage, une fleur à la main, en une danse accompagnée de musique et de chants, au son des tambours et des flûtes, jusqu’à ce
qu’elle tombât épuisée. C’était alors le moment de la présence du dieu qui répondait par sa bouche. Après son départ, la sorcière se relevait et « saluait ses propres âmes », afin de rappeler
celles qui pouvaient avoir «oublié de revenir» au cours du voyage.
Telle était dans ses grandes lignes la religion chinoise antique. Expression de la vie religieuse de groupes sociaux définis où nul n’avait de place qu’en vertu de son rôle dans la société, les
seigneurs pour conduire le culte, les sujets pour y prendre part derrière leur seigneur, elle n’accordait aucune place au sentiment personnel.
*
La religion populaire moderne
[Sections ajoutées : La religion populaire - Des dieux
personnels - La hiérarchie céleste - Dieux de la maison - Dieux des métiers - Mauvais esprits et défense
passive - Les fêtes - Transmigration - Cérémonies funéraires - Œuvres pies
L'état réel de la religion chinoise actuelle]
Le confucianisme et le taoïsme, les deux grands systèmes créés en Chine même, avec le bouddhisme importé de l'Inde, alimentèrent pendant des
siècles la vie religieuse des Chinois de toute classe, menant les uns contre les autres une lutte tantôt ouverte, tantôt sournoise, qui les usa peu à peu. Le bouddhisme et le taoïsme moururent
lentement entre le VIIe et le XIVe siècle, non sans jeter encore quelque éclat ; aujourd'hui, par une sorte de paradoxe comme l'Orient en présente si souvent, ils ont encore un clergé, mais ils
n'ont plus de fidèles. Leurs cérémonies s'accomplissent encore journellement et souvent avec grand faste ; mais ils n'ont plus de vie propre ni l'un ni l'autre, du moins en tant que systèmes
religieux définis et distincts. Le confucianisme est resté plus vivant, sinon comme système religieux, au moins comme système de direction de vie ; mais ce n'est que dans un milieu relativement
restreint, celui des lettrés.
[La religion populaire]
À mesure que les masses populaires se détachaient des religions anciennes, elles se créaient à leur usage propre une sorte de système syncrétique qui unissait en proportion inégale des croyances
empruntées à ce qu'on appelle les Trois Religions, et spécialisait de plus en plus le clergé qui s'est réduit, en somme, à deux classes de sorciers supérieurs ayant des rôles différents. Bonzes
bouddhistes d'une part, tao-che de l'autre, possèdent des pouvoirs surnaturels, les premiers en ce qui concerne les âmes des morts qu'ils savent délivrer des supplices infernaux en
rachetant leurs péchés, les seconds contre les démons qu'ils savent chasser et toutes les influences mystérieuses dont ils délivrent les vivants, sans que d'ailleurs les domaines respectifs de
ces deux classes de prêtres soient nettement définis et aient des limites exactes ; leur importance respective varie suivant les régions et les milieux. Ils remplissent les fonctions des prêtres
spécialisés de toutes les religions anciennes, sacrificateurs, évocateurs des morts, exorcistes, prophètes, médiums, devins, etc. Mais, même dans les cérémonies dont le rituel est exclusivement
bouddhique ou taoïque, ou relève du culte officiel confucianiste, l'interprétation des fidèles (et même, le plus souvent, celle des officiants) n'est pas celle du système religieux auquel le
rituel appartient : c'est une interprétation distincte, qui appartient à un système à part, tout différent de chacun des trois, celui de la religion populaire moderne.
Les observateurs occidentaux, tout en parlant de la religion populaire chinoise, n'en ont guère reconnu l'indépendance, et en traitent en disséquant les éléments taoïques, bouddhiques, etc.
Autant vaudrait décrire le christianisme contemporain en disséquant les éléments qui appartiennent au judaïsme, ceux qui proviennent de la philosophie grecque ou des anciennes religions
orientales, ceux enfin qui remontent aux anciens cultes locaux. Que dirions-nous d'un Chinois qui viendrait nous déclarer que les Français actuels pratiquent à la fois trois religions : le
christianisme parce qu'ils vont à la messe, le judaïsme parce qu'ils célèbrent la fête de Pâques, et les mystères de la Grande Déesse parce qu'ils se font baptiser ? Tous ces éléments, qu'il est
intéressant de distinguer si l'on envisage l'histoire des origines, se sont fondus dans la religion moderne, et le croyant contemporain, même si les études historiques lui ont appris à les
distinguer, ne les sent pas comme distincts, mais bien comme les parties d'un tout. Il en est de même du croyant chinois. Quand tel sinologue contemporain fait des remarques comme la suivante : «
Quelle est la confession de la divinité ? On ne s'en soucie guère ; on sait seulement que, selon les milieux, il faut pour brûler de l'encens s'adresser à un bonze ou à un tao-che », ou
comme celle-ci : « Que le dieu ait été inféodé à tel ou tel panthéon, que le desservant ait la tête tondue ou porte un bonnet, cela n'a pas d'importance », ou enfin lorsqu'il ajoute que le paysan
qui fait « quelques menues offrandes à des divinités taoïstes ou bouddhistes) n'est point pour cela bouddhiste ou taoïste ou les deux à la fois », il montre que ceux qui étudient les questions
religieuses auraient intérêt à tenir compte de la distinction entre diachronie et synchronie que Saussure a fait si heureusement entrer dans les études de linguistique. Le caractère bouddhique ou
taoïque de telle divinité, de tel rite ou de telle croyance, c'est de la diachronie, c'est un fait d'histoire ; leur caractère actuel, tel que le conçoit le paysan contemporain, est de la
synchronie... Ce qui nous induit en erreur, c'est la survivance distincte des deux clergés, bouddhiste et taoïste, avec leurs temples séparés et leurs cérémonies différentes, et nous avons peine
à croire que les Chinois ne voient pas ces différences qui sautent aux yeux. Ils les voient en effet, mais autrement que nous. Nous y voyons des différences de dogme, de panthéon, de rituel ; ils
n'y voient que des différences de spécialistes à l'intérieur d'un seul et même système religieux : le bonze est le prêtre qui sait ce qu'il faut faire pour les morts, le tao-che le
prêtre qui sait chasser les démons.
La religion populaire s'est intégrée dans les cultes paysans, seuls débris survivants de la religion antique. Ceux-ci lui ont donné un cadre général de fêtes saisonnières, qui servent d'armature
à une énorme masse de pratiques et de croyances assez flottantes et variant l'une région à l'autre. Ces fêtes paysannes elles-mêmes sont loin d'être tout à fait fixes : elles se sont
naturellement mieux conservées à la campagne qu'à la ville, mais le grand développement de la vie urbaine en Chine depuis le Xe et le XIe siècle a contribué à faire disparaître quelques-unes de
ces fêtes et à diminuer l'importance des autres même à la campagne, car, en Chine comme ailleurs, la campagne suit facilement l'exemple de la ville ; et celles qui ont subsisté ont tellement
changé de caractère qu'il est souvent malaisé d'en reconnaître l'origine. D'autre part, la religion personnelle a pris dans le peuple une place prépondérante, sous des formes tantôt taoïques,
tantôt bouddhiques suivant les occasions et aussi suivant les lieux. Enfin, la tendance à transformer toutes les forces religieuses en divinités personnelles, continuant de s'exercer, a constitué
une mythologie populaire énorme et des plus confuses, sous forme d'une hiérarchie analogue à celle de l'administration impériale, avec des dieux temporaires, qui montent en grade ou descendent
comme les fonctionnaires de ce monde, et qui sont conçus suivant un curieux dosage d'Immortels taoïstes et de Saints bouddhistes. Seul peut-être le culte des Ancêtres s'est conservé sans grand
changement, bien que les idées sur les morts aient changé et que la croyance bouddhique à la transmigration soit universellement adoptée, ce qui rend ce culte assez difficile à expliquer.
C'est se faire étrangement illusion que de penser, avec certains auteurs, que « les sentiments (religieux des Chinois) sont, à peu de chose près, ceux qui dominaient la vie de leurs ancêtres »
dans l'antiquité. Presque tout a changé, et ce qui par chance s'est conservé est loin d'avoir la même valeur dans l'ensemble des idées religieuses. La notion d'une solidarité entre l'homme et le
monde, de ce que De Groot appelait « universisme », a survécu ; mais si elle reste assez forte dans les milieux confucianistes, elle n'est plus guère en dehors d'eux que l'ombre de l'influence de
la Doctrine des lettrés. La divination reste usitée dans toutes les classes de la société ; mais ni dans sa pratique, ni dans les croyances qui s'y rattachent, elle n'a plus rien de semblable à
celle de l'antiquité. Ce sont les ancêtres que les rois de la dynastie Chang consultaient par la tortue, ce sont des divinités de toute sorte que l'on consulte aujourd'hui en tirant les sorts
dans les pagodes; et le mobile du croyant n'est plus d'obtenir l'agrément des ancêtres sur un acte donné et le moment où il l'accomplira : on se propose simplement de tirer de la science
supra-humaine des divinités la connaissance d'une chance ou malchance pour le temps de l'accomplissement de l'acte prévu. Le paysan chinois qui consulte le calendrier ou obéit à la géomancie ne
cherche pas à orienter son existence dans le temps et l'espace ; il veut seulement se documenter sur le faste et le néfaste dans des circonstances particulières de temps et de lieu. Peut-être un
lettré rattachera-t-il ces pratiques à des notions générales d'ordre philosophique : mais c'est qu'il essaie de les interpréter dans le système confucianiste, système qui a contribué (et
contribue encore) à la formation de la religion populaire, mais n'est pas plus celle-ci que le bouddhisme ou le taoïsme ne la sont ; et la justification qu'il tire de ses principes est aussi
étrangère à l'esprit du paysan que celle de certains savants européanisés qui, pour expliquer la géomancie, ont voulu faire intervenir le magnétisme terrestre. Si les paysans chinois manifestent
aujourd'hui une répugnance certaine à abattre des arbres au printemps, est-ce parce qu'ils continuent à pratiquer l'« universisme », ou simplement parce que les ordonnances répétées des préfets
et sous-préfets (des lettrés qui ont appris le Yue-ling) l'interdirent depuis des siècles ? Personnellement, je n'ai jamais obtenu des paysans (au Tchö-kiang et au Kiang-sou) que la seconde
réponse ; et il m'a fallu m'adresser à un tao-che et à un ancien préfet devenu bonze, pour avoir la première. En fait, pour comprendre la religion populaire moderne, ce ne sont ni les Rituels
confucéens, ni les livres saints du bouddhisme ou du taoïsme qu'il faut interroger. Ce sont les paysans eux-mêmes. Par l'étude des livres, on peut établir l'origine historique d'une cérémonie ou
d'une croyance, mais on n'a aucunement le droit d'en tirer une explication de sa valeur ou de son interprétation actuelles.
[Des dieux personnels]
La religion populaire moderne d'aujourd'hui, comme celle de l'antiquité, s'adresse avant tout à des dieux personnels. Ce n'est pas que les forces impersonnelles ne jouent un grand rôle dans la
vie des Chinois, puissances obscures et mal caractérisées comme le Bonheur fou ou le Destin ming de chaque homme ; mais même ces forces impersonnelles (sauf peut-être ces
influences mystérieuses que produisent « le Vent et l'Eau » fong-chouei, et que savent reconnaître les géomanciens), le peuple a tendance à les concevoir comme le don de divinités
personnelles qui les accordent, les accroissent ou les diminuent à leur gré pour chacun.
Les dieux sont pour la plupart ceux de la religion antique ; mais la transformation qu'a apportée dans la manière de les concevoir l'influence des idées bouddhiques et surtout taoïques vers le
temps des Six Dynasties a été durable, et, en recevant les titres bouddhiques et taoïques de Bouddhas, Bodhisattvas, Vénérables Célestes, Immortels, ils ont pris un caractère particulier. Ces
notions se sont fondues en se simplifiant ; elles ont perdu les traits particuliers que chacune devait au système religieux auquel elles appartenaient.
Dans la religion populaire, tous les êtres surnaturels, qu'on leur donne les titres de Fo (Bouddha), P'ou-sa (Bodhisattva), Lo-han (Arhat), T'ien-tsouen (Vénérable Céleste), Sien (Immortel), Ti
(Empereur), Heou (Impératrice), Wang (Roi), ou même le moins élevé de tous, chen (dieu ou déesse), sont des êtres de même nature, et ne se distinguent guère les uns des autres que par
les pouvoirs plus ou moins étendus dont ils jouissent ; les titres divers qu'on leur donne marquent simplement les degrés d'une hiérarchie un peu flottante. Le Soleil et la Lune reçoivent de
leurs dévots le titre de Bouddha ; l'empereur Kouan, dieu des plus populaires, est souvent appelé Bodhisattva.
Tous les dieux, grands et petits, sont des hommes qui après leur mort ont été promus à la dignité de dieux. Les plus importants, Bouddhas, Vénérables Célestes, Empereurs, ont mis plusieurs
existences successives à acquérir les mérites qui les ont fait promouvoir ; à ceux de moindre puissance, il suffit d'une seule. Les légendaires bouddhiques donnent les biographies successives des
Bouddhas et des grands Bodhisattvas au cours d'âges innombrables ; les légendaires taoïques, fabriqués à leur instar, donnent celles du t'ai-chang Lao-kiun (dont une des nombreuses
descentes sur terre fut Lao-tseu) et des Vénérables Célestes ; on a des recueils analogues sur le Grand-Empereur de la Gloire-Littéraire Wen-tch'ang ta-ti, dieu de la constellation
Wen-tch'ang et protecteur des candidats aux examens, et sur d'autres divinités. Le principal des dieux chasseurs de démons, qui sous la dynastie Ts'ing avait pris place dans le panthéon officiel
comme dieu de la Guerre, l'empereur Kouan Kouan-ti, est un général qui mourut au début du IIIe siècle de notre ère. Le dieu du fleuve Jaune est un homme qui s'y est noyé au temps de la dynastie
Tsin. Celui de la barre du Tchö-kiang est Wou Tseu-siu, ancien ministre d'un prince local, qui, mis à mort injustement, se venge en essayant chaque année de détruire le pays et sa capitale en
lançant les vagues du mascaret lors des grandes marées d'équinoxe. Chacun des dieux protecteurs des villes a sa biographie humaine.
La divinité est une charge comme les fonctions publiques : le titre est durable, mais les titulaires varient et se succèdent les uns aux autres. Ces dieux fonctionnaires reçoivent une charge, ont
de l'avancement, sont rétrogradés, et finalement meurent pour renaître comme hommes sur terre ; seuls les plus élevés, comme les Vénérables Célestes ou les Bodhisattvas, ont cessé d'être soumis à
la naissance et à la mort et tiennent leur charge à perpétuité : c'est que, grâce à leurs mérites, ils ont reçu l'élixir d'immortalité, ou une des pêches de la Dame Reine d'Occident Si-wang-mou.
Les idées taoïques ont à ce point pris le pas sur les idées bouddhiques que les Bodhisattvas eux-mêmes sont conçus comme des Immortels (la légende populaire de Kouan-yin le montre bien).
La divinité est si bien une fonction qu'elle se délègue. Les grands dieux qui ont beaucoup de temples et de statues ne peuvent résider à la fois dans toutes leurs images, pour animer chacune
d'elles, ils y convient des âmes de justes, qui sont chargées de les représenter et de leur rendre compte de ce qui se passe dans les temples et qui, en échange, ont le droit de prélever une
partie des offrandes.
Sous des aspects nouveaux, sous des noms et des titres nouveaux, une bonne partie des dieux de l'antiquité ont survécu en se transformant. Du moins le cadre reste-t-il, si les idées ont changé;
et cela permit aux lettrés, tout en protestant contre les « superstitions » populaires dont ils ne trouvent pas l'origine dans les Classiques, de continuer à prendre un certain intérêt aux
manifestations extérieures de la religion populaire, tout au moins à certaines de ces manifestations qui remontent à l'antiquité.
[La hiérarchie céleste]
L'antique Seigneur d'En Haut occupe la tête de la hiérarchie céleste, où il joue le rôle de l'empereur parmi les hommes ; mais l'influence athéistique de la religion officielle lui a fait perdre
son nom pour être appelé simplement le Ciel, sans réussir à lui faire perdre son caractère de dieu personnel ; car les dieux personnels de l'antiquité se refusent à mourir dans la conscience
religieuse du peuple. Il est le Ciel T'ien, mais aussi Monsieur le Ciel T'ien lao-ye : noms commodes qui donnent satisfaction à tout le monde, aux élites qui peuvent y voir le
Ciel impersonnel de la Doctrine des lettrés, et aux gens du peuple qui y voient le dieu suprême personnel de la religion populaire. On lui donne aussi le titre taoïste d'Empereur Suprême, Auguste
de Jade Yu-houang chang-ti (chang-ti est la vieille désignation du Seigneur d'En Haut), titre d'origine fort ancienne, mais qui ne prit de l'importance que tardivement, aux XIe
et XIIe siècles, quand l'Auguste de Jade apparut à deux empereurs de la dynastie des Song.
Le Ciel voit tout, il entend tout. « Rien n'échappe à l'œil du Ciel », dit un proverbe, et un autre : «Les secrets dits dans une chambre obscure, le Ciel les entend comme les roulements du
tonnerre.» Il décide tout suivant son bon plaisir : « Si le Vénérable Ciel veut qu'il pleuve, il pleuvra ; s'il veut qu'une vieille se marie, elle se mariera ! » Et : « Ce que le Ciel ordonne,
l'homme n'y peut désobéir. » D'ailleurs juste, il protège et aide les bons et punit les méchants, souvent dès cette vie même ; sa bonté omnisciente n'oublie personne : « Chaque tige d'herbe a sa
part de gouttes de rosée. » Du reste, son gouvernement du monde ne s'exerce pas par caprices ; il a établi un ordre constant pour la marche du monde, le yin et le yang qui
produisent la succession des saisons, laquelle à son tour ramène avec le froid et le chaud tout ce qui est nécessaire à la nourriture de l'homme. Mais, comme il advient souvent des dieux
suprêmes, si on le met très haut, on ne lui rend guère de culte, et l'on préfère s'adresser à des divinités plus proches de l'homme ; et le portier du Palais de l'Auguste de Jade, celui qu'on
appelle le Fonctionnaire Transcendant Ling-kouan et qui, armé d'un bâton noueux, poursuit les mauvais esprits, joue un rôle plus vivant dans la religion populaire. Et il y a, sous les ordres du
Ciel, toute une série de dieux des phénomènes naturels. Les uns portent encore les vieux noms de Comte du Vent, de Maître de la Pluie ; les autres revêtent des noms et des titres nouveaux
d'origine taoïste, tel Monseigneur le Tonnerre Lei-kong, le seul qui soit vraiment vivant dans la croyance populaire ; il est le bourreau céleste, car c'est le tonnerre qui châtie les crimes les
plus graves. Tous ces dieux sont connus, on en parle, mais ils n'ont guère de place que dans le folk-lore ; le culte populaire les a laissé tomber, au point que les sacrifices pour obtenir la
pluie, par exemple, n'ont rien à faire avec le Maître de la Pluie.
Le véritable assistant du Ciel, c'est le Grand Empereur du Pic de l'Est Tong-yo ta-ti. C'est au propre le dieu du mont T'ai-chan, dans le Chan-tong ; mais cette montagne, la plus haute
de l'Est de la Chine, appartient au groupe des Cinq Pics, les montagnes qui président chacune à une des cinq régions du monde. Le T'ai-chan préside à l'Orient et, par suite, au principe
yang naissant, et à l'élément Bois ; il préside à la vie, fixe la naissance et la mort, établit la destinée humaine. Dans les temples qui lui sont consacrés, de nombreuses inscriptions
rappellent ce rôle :
À tous les êtres il procure la vie ;
Son autorité préside au mécanisme de la vie.
Il a pour cela sous ses ordres une immense administration avec d'innombrables employés. Une inscription du XIIIe siècle énumère 75 bureaux qui dépendent de lui ; son temple à Pékin en contient
maintenant plus de 80. Il s'occupe de tout ce qui concerne la vie sur la terre, humaine et animale — il serait impossible qu'il en fût autrement, puisque la naissance animale est un des
châtiments des âmes coupables — ; il préside à la destinée, à la fortune, aux honneurs, à la postérité, etc. Il a des bureaux d'enregistrement des naissances et des décès, un bureau pour
distribuer la fortune, un autre pour fixer le nombre d'enfants de chaque famille ; il a aussi un bureau des voleurs, un des empoisonneurs, un bureau de la piété filiale, un de la lecture des
livres saints, etc. Un bureau est chargé d'ajuster le destin accordé au moment de la naissance avec les mérites et les démérites acquis au cours de l'existence, en ajoutant ou retranchant des
années au nombre primitif. Il a enfin des bureaux chargés de la surveillance et de l'inspection de tous les dieux terrestres, ainsi que des bureaux des maladies, etc. Le personnel de tous ces
bureaux est recruté parmi les âmes des morts : ce sont les âmes des hommes de bonne conduite qui remplissent toutes ces fonctions. C'est un dieu très populaire, et nombreuses sont les femmes qui,
dans son temple de Pékin, vont emprunter une des petites poupées déposées en ex-voto par celles qui ont obtenu de lui d'avoir un fils. Elles font une petite offrande ou brûlent quelques bâtonnets
d'encens, puis choisissent parmi les poupées celle qu'elles veulent et l'emportent à la maison ; elles la rapporteront quand elles auront eu un enfant, et en offriront une autre en
remerciement.
La hiérarchie des dieux du Sol, qui dans l'antiquité tenaient une place si importante dans le culte, a subsisté, mais en se transformant : chaque préfecture ou sous-préfecture a son dieu
protecteur, le dieu des Murs et des Fossés Tch'eng-houang, qui est le représentant actuel de l'ancien dieu du Sol seigneurial. Il protège le territoire et ses habitants, et il a même gardé au
moins une partie de son rôle de dieu des morts. Le titre de Tch'eng-houang apparaît entre les Han et les Six Dynasties, et dès le VIe siècle les tch'eng-houang étaient si bien les
protecteurs attitrés des villes qu'en 555 le général Mou-jong Yen, chargé de défendre la place de Ying (aujourd'hui Wou-tch'ang dans le Hou-pei), adressa au Tch'eng-houang de cette ville des
pièces officielles, comme dans l'antiquité un prince féodal aurait fait au dieu du Sol. On lui demandait ce qu'on avait coutume de demander jadis au dieu du Sol : le bonheur et la paix en général
pour la circonscription, que les fauves n'attaquent pas les habitants, que les insectes ne dévorent pas les récoltes : c'est ce que lui demanda le poète Tchang Yue en 717 quand il était
gouverneur de King ; ou plus particulièrement d'arrêter les pluies torrentielles, ou de faire cesser une sécheresse, comme firent deux écrivains célèbres, Tchang Kieou-ling en 727 à Hong, et Tou
Mou en 842 à Houang. Sous les T'ang, bien que ces dieux ne fussent pas encore inscrits au registre des sacrifices officiels, la fondation d'un centre administratif s'accompagnait aussitôt de la
construction d'un temple du dieu des Murs et des Fossés.
Ce protecteur des habitants d'un district s'est complètement humanisé au cours des siècles. On le représente comme un homme, généralement un ancien fonctionnaire local qui a reçu la charge, dans
l'autre monde, d'administrer comme dieu les territoires qu'il a administrés autrefois de son vivant comme fonctionnaire. Il n'est pas le fondateur : celui-ci a souvent son culte particulier sous
le nom d'Ancêtre de la Commune chö-tsou. Il est une sorte de fonctionnaire divin chargé d'un territoire et de ses habitants, comme le préfet ou le sous-préfet en est le gouverneur
humain. Il a son temple dans la ville, et c'est à lui qu'on demande de donner paix, bonheur, richesse, bonne récolte, comme le disait au début du XIXe siècle un vice-roi des Deux Hou, Wou
Yong-kouan, « le dieu des Murs et des Fossés préside réellement à l'administration d'une région ; il donne du bonheur aux bons et du malheur aux méchants ». Il a sous ses ordres toute une
administration : ses subordonnés les plus célèbres sont le Monsieur Blanc Po lao-ye et le Monsieur Noir Hei lao-ye, deux personnages larges et efflanqués, coiffés de hauts
bonnets coniques, vêtus l'un tout de blanc, l'autre tout de noir, qui voient tout ce qui se passe dans la ville, le premier de jour et le second de nuit.
Une part importante du rôle du dieu des Murs et des Fossés est de recevoir les âmes des morts et de leur faire subir un premier jugement avant qu'elles n'aillent aux enfers. La mort est produite
par la convocation du roi infernal Yen-lo (le Yama bouddhique), qui envoie deux émissaires appeler l'âme à se présenter devant lui. Ces émissaires ne sont pas nécessairement des démons ou des
morts ; ce sont souvent des vivants. Quand le roi Yen-lo a besoin d'eux, ils tombent en catalepsie pour quelques heures ou quelques jours, et, pendant ce temps, leur âme accomplit l'ordre du roi
Yama ; quand l'ordre est accompli, elle revient dans le corps, qui se réveille ayant tout oublié. Mais le dieu des Murs et des Fossés ne peut admettre qu'on emmène l'âme d'un de ses administrés
sans savoir de quoi il s'agit ; et les dieux infernaux reconnaissent son droit : c'est à lui qu'on amène l'âme du mort, il la garde quelques jours pendant lesquels il examine si le temps fixé par
le destin est bien arrivé, et il lui fait subir un premier jugement sommaire ; puis il la fait conduire aux enfers, où elle sera jugée définitivement.
D'autre part, tous les dieux des lieux de la circonscription dépendent de lui. Les dieux du Lieu t'ou-ti chen sont de petits dieux locaux chargés d'un territoire plus ou moins grand.
Chaque village de campagne, chaque quartier ou chaque rue des villes, chaque temple, chaque bâtiment public, chaque pont, chaque champ a le sien ; ils ont leur temple, leur chapelle, leur pagode
ou tout au moins leur tablette suivant leur importance. Ceux des villages jouent le même rôle que, dans les villes, le dieu des Murs et des Fossés ; ils tiennent le registre des habitants, et
c'est pourquoi, chaque fois qu'il survient un décès, un groupe de femmes de la famille va le lui annoncer dans son temple, le soir qui suit la mort, en pleurant et en brûlant des papiers d'or et
d'argent.
[Dieux de la maison]
Les maisons ont leurs dieux comme dans l'antiquité, mais certains des Cinq Dieux et quelques autres dieux ont pris de l'importance aux dépens des autres.
Le premier des dieux de la maison est maintenant le dieu du Foyer, Son Altesse le Foyer Tsao wang-ye. On le trouve, lui et sa femme, dans toutes les maisons chinoises. Son image est un simple
dessin colorié où il est figuré comme un vieillard à barbe blanche en costume de mandarin, assis dans son fauteuil, devant une table où deux urnes reçoivent le compte des bonnes et des mauvaises
actions des gens de la maison. Sa femme est quelquefois assise à ses côtés, mais le plus souvent elle est debout et donne à manger aux six animaux domestiques ; quelquefois on ajoute derrière lui
ses deux assistants, l'Adolescent Rameneur de Bois et Monsieur le Porteur d'Eau. Le dessin est collé dans une petite niche d'un pied de haut et d'autant de large, ouverte face au Midi, au dessus
du foyer ; on place dans cette niche toute l'année une coupe vide et quelques bâtonnets d'encens ; deux fois par mois, le père de famille brûle quelques bâtonnets d'encens devant lui. Ce n'est
qu'un petit dieu sans importance, mais il est le chef des esprits de la maison, et il faut se le concilier. C'est lui qui, au moment du Jour de l'An, monte faire un rapport à Monsieur le
Ciel.
Il commande aux autres dieux de la maison, dont les plus importants après lui sont les dieux de la Porte Men-chen, ces deux personnages dont on colle sur chaque vantail l'image
violemment enluminée : ce sont deux généraux de la dynastie T'ang, Monseigneur Yu-tch'e et Ts'in Chou-pao, qui, au VIIe siècle, avaient vigoureusement défendu la porte du Palais Impérial contre
un démon ; selon la croyance populaire, l'un est bon et l'autre méchant. On les représente en costumes militaires, casqués, revêtus d'une armure, et la hallebarde à la main ; ce sont eux qui
empêchent de passer les mauvais esprits, les démons des épidémies.
La maison est pleine de dieux : la porte de derrière a le sien qui diffère de ceux de la porte de devant ; il y a un dieu du Puits, il y a le Seigneur et la Dame du Lit, le dieu de la Fosse
d'Aisance, le dieu des Balais, le dieu de la Richesse. Les dieux de la Richesse Ts'ai-chen sont fort nombreux et ne manquent pas de fidèles. L'un d'eux, le Généralissime de la Terrasse Sombre
Hiuan-t'an ta-tsiang-kiun, passe dans le Nord pour avoir été musulman ; par suite, on évite de lui offrir du vin et du porc et on lui présente de la viande de bœuf, ce qui n'empêche pas
de le désigner par le titre bouddhique de p'ou-sa (Bodhisattva).
Enfin la maison contient une petite chapelle ou un coffre contenant les tablettes des Ancêtres, c'est-à-dire les planchettes de bois sur lesquelles sont écrits ou gravés les noms de chacun des
ancêtres défunts, leurs titres s'il y a lieu, avec les mots : « Siège de l'âme de... » et souvent les dates de naissance et de mort. Les Ancêtres sont, comme dans l'antiquité, les ascendants
proches du chef de famille avec leurs femmes ; les ascendants de la femme ne comptent pas : elle est sortie de sa famille par son mariage, et les Ancêtres de son mari sont devenus les siens. On
ne les figure ni par des statues ni par des images ; même quand on a leur portrait, ce n'est pas devant lui qu'on fait les cérémonies.
Toutes ces pratiques extérieures ne diffèrent pas de l'antiquité. Mais le bouddhisme a introduit dans les idées sur l'existence de l'âme après la mort la notion de la transmigration ; celle-ci
est devenue la croyance courante, et par elle s'est posé un problème compliqué, mais qu'on n'a pas cherché à résoudre, au sujet du rapport entre ce qui transmigre et ce qui vient résider dans la
tablette pour prendre les offrandes.
Le culte des Ancêtres est probablement le seul de tous les cultes familiaux qui soit absolument universel en Chine ; toutes les familles, sauf les chrétiennes et les musulmanes, ont ce petit
sanctuaire des Ancêtres devant lequel est posé un petit brûle-parfum entre deux cierges qu'on n'allume que pour les fêtes. En temps ordinaire, ils ne brûlent pas ; on n'allume cierges et
bâtonnets d'encens que deux fois par mois, le 1er et le 15, ainsi qu'aux fêtes fixes, par exemple le jour de la Fête des Lanternes, et encore lorsqu'il y a un événement familial à leur annoncer,
naissance, mariage, mort, changement de résidence, promotion d'un membre de la famille ; et surtout, à chacun des anniversaires de naissance et de mort des Ancêtres (au moins des trois derniers),
on offre un repas complet. La tablette est alors descendue du tabernacle et posée sur une table. On dispose devant elle l'encens, le vin, le riz et tout le repas ; le père de famille se prosterne
avec sa femme et fait une prière, et tous les enfants et petits-enfants se prosternent à leur tour ; après quoi on mange le repas.
Pour les dieux de la maison, le culte dépend surtout des femmes de la famille ; il dépend aussi dans un certain sens du chef de famille, et de ses dévotions personnelles ou, à l'inverse, de son
opposition à certaines dévotions. Dans les familles lettrées, il est courant qu'on réduise au minimum, sans toutefois l'éliminer complètement, tout ce qui n'est pas justifié par les Classiques et
qui est tenu pour superstition. Il n'y a pas de famille, même lettrée, où on ne fasse de cérémonie au moins au dieu du Foyer et au dieu des Richesses ; les offrandes aux dieux des Portes, au
Seigneur et à la Dame du Lit sont moins générales.
Le culte est rendu de la façon la plus uniforme : toute la variété des offrandes antiques a disparu, et aujourd'hui, quelle que soit la divinité, tout se fait suivant le rituel des offrandes aux
morts, c'est-à-dire sous forme d'un repas complet. Il n'y a d'exception que pour les divinités dont le caractère bouddhique est encore bien net comme Kouan-yin (Avalokiteçvara) ou Ti-tsang
(Kshitigarbha) : on ne leur offre que de l'encens et des fleurs, en y ajoutant, pour les offices les plus importants, un repas maigre offert à des bonzes.
Le nombre des jours d'offrandes varie non moins que le nombre des divinités auxquelles on les fait: on brûle des bâtonnets d'encens devant l'image du dieu du Foyer et du dieu des Richesses ; pour
le dieu du Foyer, comme pour les Ancêtres, on fait une cérémonie deux fois par mois, le 1er et le 15 : au matin, avant le premier repas, le chef de famille brûle devant lui deux bougies et un
bâtonnet d'encens. Ce n'est que trois fois par an qu'on lui offre un repas, le jour anniversaire de sa naissance, et les jours du départ et du retour de son voyage au Ciel pendant les fêtes du
Nouvel An, voyage dont il sera question ci-dessous.
Quant au dieu des Richesses, ceux qui ne peuvent avoir sa statue ou son image ont au moins une affiche portant les deux caractères Ts'ai-chen « dieu de la Richesse » ; ses offrandes
égalent celles du dieu du Foyer : les gens riches lui offrent un repas deux fois par mois ; et au jour anniversaire de sa naissance, on lui offre un coq avec le sang duquel on frotte le seuil de
la porte. Il a son nom et ses titres, mais ils diffèrent suivant les provinces et les familles. Les autres divinités moins importantes sont moins bien traitées : on ne leur offre guère que de
l'encens, quelquefois du vin ou du thé à leur jour de fête.
[Dieux des métiers]
En dehors de la maison et de la famille, chaque profession, chaque métier a son dieu protecteur auquel les membres de la corporation rendent un culte régulier. Je ne peux les mentionner tous : ce
serait une énumération d'innombrables divinités et génies. Quelques-uns sont bien chinois, comme le dieu des Examens littéraires, K'ouei-sing, le docteur le plus laid qui ait jamais été reçu, si
laid que lorsque, selon l'usage, le lauréat fut présenté à l'empereur, celui-ci frappé d'horreur se retira sans mot dire. Désespéré, il se jeta à l'eau, mais un énorme poisson le ramena à la
surface. Avec lui, on trouve un dieu plus curieux encore, l'Habit Rouge, dieu de la chance aux examens, qui fait passer les candidats dépourvus de mérite quand ils lui plaisent, ou au contraire
fait refuser les bons candidats qui lui ont déplu pour quelque raison.
Les femmes ont leur patronne particulière, la Sainte Mère Cheng-mou ou la Dame Donneuse d'Enfants Song-tseu niang-niang ; suivant les pays et les familles, elle est accoutrée à
la bouddhique ou à la taoïque ; mais c'est toujours au fond la même déesse sous des noms différents. bouddhiste, on la qualifie de Kouan-yin Donneuse d'Enfants Song-tseu Kouan-yin ; elle
est en effet conçue comme une forme féminine du Bodhisattva Kouan-yin (Avalokiteçvara), l'assistant du Bouddha Amitâyus, et on la représente assise, portant dans ses bras un enfant. Taoïste, on
l'appelle la Princesse des Nuages Bigarrés Pi-hia yuan-kiun, et elle est la fille du Grand Empereur du Pic de l'Est ; on la figure assise sur son trône, avec ses deux assistantes, dont
l'une porte l'enfant et dont l'autre, un œil dans la main, guérit les ophtalmies des nouveau-nés, et avec ses neuf suivantes, les Neuf Dames Kieou niang-niang, dont plusieurs président
aux diverses phases de la grossesse, tandis qu'une est la déesse de la petite vérole, une autre celle de la rougeole, etc.
Il y a encore des dieux et des esprits des maladies, la déesse de la Petite Vérole par exemple ; ou des calamités, comme la déesse qui Conduit les Sauterelles.
[Mauvais esprits et défense passive]
Toutes les divinités ne sont pas secourables. Bien au contraire, les êtres dangereux abondent. Ils sont de toute sorte. Il y a d'abord certains revenants kouei, en particulier les âmes
des morts de mort violente, noyés qui hantent le lieu de leur noyade jusqu'à ce qu'ils aient pu attirer un remplaçant dont la mort les délivrera, suicidés surtout qui sont très dangereux. La
religion populaire explique l'origine de ces revenants par le fait que chaque homme a un nombre d'années fixe qui lui est alloué à sa naissance : tant qu'il n'a pas atteint ce nombre, il ne peut
entrer aux enfers et son âme reste errante sur la terre. Ce n'est qu'après ce temps écoulé qu'elle pourra rentrer dans le cycle des transmigrations ; ou, si c'est l'âme d'un suicidé, elle
habitera la Ville des Suicidés, d'où l'on ne sort jamais pour renaître.
Certains animaux, en vieillissant, prennent un pouvoir transcendant et sont capables de nuire aux hommes, parfois en se transformant en hommes et en femmes. Les renards sont particulièrement
redoutés : transformés en beaux jeunes gens ou en jolies femmes, ils séduisent jeunes filles et jeunes gens et dévorent lentement leur substance pour s'en nourrir et protéger leur longévité ; les
maladies de langueur sont souvent attribuées à la hantise de démons-renards. D'autres animaux ont des pouvoirs analogues, comme le blaireau. D'autres encore, comme le tigre, s'asservissent les
âmes des gens qu'ils ont dévorés, et qui chassent pour eux, attirant les victimes dans l'espoir de se libérer elles-mêmes. Toute chose ancienne prend un pouvoir dangereux, surtout si elle a été
longtemps en contact avec les hommes : les tertres qui portent des stèles funéraires sont hantés; les statues de chevaux dressés devant les anciens tombeaux de hauts fonctionnaires se promènent
parfois la nuit, et même arrivent, elles aussi, à prendre la figure humaine ; un vieil oreiller, avec l'âge, se charge d'un pouvoir maléfique et attaque celui qui s'en sert. De vieux arbres, des
pierres ont souvent une vertu redoutable. Il ne s'agit pas d'esprits habitant ces arbres ou ces pierres, mais des choses elles-mêmes, et ce pouvoir est le plus souvent inconscient et impersonnel;
cependant il arrive souvent que des choses prennent conscience et personnalité et se transforment en hommes ou en femmes capables de faire du mal. Et il y a pire encore : les maléfices des
sorciers ; le scolopendre d'or qu'on produit en nourrissant des scorpions et des scolopendres les uns des autres jusqu'à ce qu'un seul survive, qui donnera la richesse à son possesseur, mais qui
veut une victime humaine chaque année et, s'il ne l'obtient pas, se nourrira de son maître.
Contre tous ces mauvais esprits et ces mauvaises influences, les hommes ne sont pas entièrement démunis. D'abord les dieux des Portes les arrêtent presque tous au seuil de la maison, et si par
hasard ils entrent par surprise, le dieu du Foyer et les autres dieux de la maison les chassent ou les exterminent. Mais il ne faut pas leur donner trop de besogne, sans quoi il n'y suffisent
pas. Aussi évite-t-on de placer une maison à la sortie d'un pont (les esprits chinois ont la même répugnance à passer l'eau courante que les esprits occidentaux) ou à l'extrémité d'un chemin.
Quand il est impossible de l'éviter, en place un écran de brique, ou simplement une pierre, qui arrête les mauvais esprits et les force à se détourner. À l'intérieur de la maison, on colle des
amulettes taoïques ou bouddhiques, pour chasser les maléfices en général ou certaines espèces de mauvais esprits ou de mauvaises influences en particulier. Il y a peu de maisons où il n'y ait
aucune de ces amulettes ; leur nombre et leur variété diffèrent suivant que le chef de famille et surtout sa femme sont plus ou moins superstitieux.
C'est là une sorte de défense passive. Mais l'homme qui sort de chez lui, pour voyager ou simplement pour se promener, est toujours en danger. Le calendrier note soigneusement, pour chaque mois
de chaque année, les jours où il est faste de partir en voyage, de traiter une affaire, etc., et ceux où à l'inverse il vaut mieux rester chez soi. Le 5e mois est un mois dangereux (transposition
religieuse d'un fait réel : le 5e mois, qui tombe en juillet, est le plus dur dans la Chine du Nord), et le 5e jour du 5e mois est le pire jour de ce mois : les mauvais esprits sont lâchés et
rôdent partout. Ce jour-là, on pulvérise du vinaigre à la porte des maisons, on colle des amulettes représentant un tigre sur les murs et les portes, on dessine un tigre et on écrit le caractère
« tigre » sur le front des petits enfants.
Les enfants, en effet, sont toujours particulièrement exposés, et on leur fait porter toute sorte d'amulettes pour écarter démons et mauvaises influences, ou bien on fait diverses cérémonies pour
eux. La vie des enfants entre la naissance et l'âge de seize ans traverse trente passages dangereux kouan, mais qui ne sont pas tous également à craindre pour tous les enfants : le
caractère plus ou moins périlleux de l'un ou de l'autre dépend en grande partie des mois, jour et heure de sa naissance, notés en caractères cycliques. Cependant tous les enfants partagent le
péril des cent premiers jours, où les Revenants Voleurs d'Enfants t'eou-tseu kouei, c'est-à-dire les âmes de jeunes filles mortes avant leur mariage, essaient de voler leur âme, prenant
pour cela toutes les formes, chien, chat, homme, femme, etc. Pendant cette période, on brûle de vieux souliers près du berceau, ou encore on entoure celui-ci d'un filet de pêcheur pour les
écarter. Pour les autres « passages », on consulte un tao-che ou un simple diseur de bonne aventure qui, au vu de la date de naissance, renseignent les parents sur les dangers et les
moyens de les éviter ; on pourra ainsi accomplir au moment voulu les cérémonies nécessaires.
En dépit de toutes ces précautions, il y a de mauvais esprits ou de mauvaises influences qui réussissent à se glisser dans les maisons. Les enfants, les jeunes gens, les parents tombent malades ;
ou bien la malchance poursuit toutes les entreprises, les accidents surviennent à tout propos. Il faut alors exorciser la maison. On fait venir un tao-che, représentant moderne du
fang-siang-che qui, vêtu d'un habit mi-parti, la figure couverte d'un masque à quatre yeux, la hallebarde et le bouclier à la main, danse, suivi de son aide, à la poursuite des mauvais
esprits et des mauvaises influences et, après les avoir pourchassés, les expulse de la maison.
[Les fêtes]
Les fêtes calendériques à date fixe sont fort nombreuses. Il y a d'abord le Jour de l'An, avec presque un mois de fêtes massives du milieu du 12e mois d'une année au milieu du 1er mois de la
suivante. Le fait principal de la religion populaire actuelle, c'est le voyage au ciel du dieu du Foyer pendant cette période. C'est à ce moment, en effet, qu'il monte saluer Monsieur le Ciel
pour lui présenter l'hommage du Nouvel An, et il profite de ce voyage pour rendre des comptes et faire son rapport sur la famille. C'est très important, parce que c'est sur ce rapport que les
bureaux de l'administration céleste fixeront le détail du destin de l'année suivante, les événements agréables ou pénibles qui surviendront, etc. Aussi fait-on le possible pour donner au dieu du
Foyer une bonne impression au moment du départ. Les dieux ne sont à vrai dire pas très intelligents, et il suffit d'un petit effort au dernier moment pour leur faire oublier la négligence de
toute l'année. Le jour du départ du dieu, le 24 du douzième mois, on lui offre un repas somptueux de six plats, avec un gâteau à la farine de haricots rouges, puis on place devant la niche qui
lui sert de sanctuaire un petit palanquin en papier ; le chef de famille décolle l'image du dieu et la met dans le palanquin, il l'emporte hors de la maison et là il brûle le palanquin et
l'image, avec des lingots d'argent en papier, pour que le tout monte au ciel. Quand, au milieu du premier mois, arrive le jour du retour du dieu au Foyer, on colle une image neuve sur le
sanctuaire et on place devant cette image une petite offrande, riz, vin, et quelques bâtonnets d'encens.
Puis vient tout le long de l'année une série de fêtes grandes et petites : la Fête des Lanternes, procession pour les âmes des morts affamés ; la Fête du Nettoyage des Tombeaux au troisième mois,
où la famille entière se transporte au tombeau familial et y fait une offrande suivie d'un grand banquet ; la Fête du dieu des Murs et des Fossés, qui dure plusieurs jours, avec sa procession de
la statue du dieu dans sa chaise à travers toute la ville (qui n'a lieu qu'au printemps), et souvent des représentations théâtrales dans le temple ; la Fête de la Lune au milieu de l'automne :
toute la famille quitte alors la maison afin de dépister les mauvais esprits, monte sur les collines les plus proches et y passe la journée à manger, boire et s'amuser ; et d'autres encore.
Dans la plupart de ces fêtes, en creusant bien, on finit par découvrir un vieux fond de fêtes paysannes remontant à la religion agraire de l'antiquité ; mais les apports nouveaux ont si bien
recouvert ce vieux fond que les gens d'aujourd'hui n'y pensent guère. Le culte des dieux des Murs et des Fossés conserve un certain lien, d'ailleurs purement traditionnel et devenu inconscient,
avec le vieux culte saisonnier : ces dieux ont chacun leurs jours de fête propres, qui sont les jours de naissance et de décès de leur existence dernière avant leur promotion au rang de divinité
; mais, de manière générale, tous ces jours se groupent en deux périodes, printemps et automne, qui rappellent les deux fêtes du dieu du Sol antique, bien qu'elles ne tombent pas exactement au
même moment.
[Transmigration]
Tout le monde aujourd'hui en Chine, sauf un petit nombre de lettrés, croit à la transmigration : c'est un des grands apports du bouddhisme à la religion chinoise. Mais, ainsi que je l'ai indiqué
déjà à propos du culte des Ancêtres, la théorie bouddhique n'a pu être acceptée telle quelle ; sa négation de toute âme substantielle, et d'un Moi permanent, rendait trop compliquée l'explication
de la rétribution des mérites et des démérites. Pour les Chinois, l'homme a une âme, support de la personnalité, et c'est cette âme qui est récompensée ou châtiée après la mort. À strictement
parler, l'homme vivant a dix âmes, à savoir trois houen et sept p'o ; mais, bien que les taoïstes donnent des noms à chacune d'elles, la religion populaire en fait deux groupes
indistincts qui pourraient tenir le rôle du chen et du kouei de l'antiquité, à cela près que les modernes ont sur eux des idées bien plus précises que les anciens. À la mort,
ces deux groupes se séparent ; le groupe des p'o reste avec le corps dans la chambre mortuaire, d'où les dieux des Portes les empêchent de sortir, puis ensuite dans la tombe, tandis que
le groupe des houen s'en va devant les juges d'outre-tombe, portant le poids de leurs péchés et les mérites de leurs bonnes actions.
À l'heure fixée par le destin, les messagers de mort se présentent. Les satellites du dieu des Murs et des Fossés, Tête-de-Bœuf et Face-de-Cheval, saisissent l'âme du mort (ses houen) ;
ils la ligotent, et l'emmènent au temple de ce dieu. L'âme y restera sept semaines. Le dieu fait tout d'abord une brève enquête sur sa conduite, en consultant le registre où sont inscrits les
rapports annuels du dieu du Foyer ; selon le résultat, il la laisse libre ou lui inflige une peine, cangue ou bastonnade. Puis il fait vérifier dans les bureaux du Grand Empereur du Pic de l'Est
si le temps de vie qui lui avait été alloué est vraiment écoulé. Au cas où un suicide ou même un accident ont mis fin à sa vie avant le temps, l'âme doit attendre sur terre la date fixée (c'est
pourquoi, comme je l'ai déjà dit, les âmes des suicidés ou des personnes mortes de mort violente sont si souvent des revenants dangereux). Dans le cas contraire, les satellites infernaux viennent
reprendre l'âme du mort, le 49e jour, et la conduisent devant les dix rois des enfers pour être jugée. Elle n'est pas jugée en bloc pour toutes ses fautes ; les péchés sont catalogués et répartis
en dix listes, une pour chacun des dix rois des enfers ; et les morts passent successivement devant chacun des dix rois pour que chacun d'eux prononce en ce qui le concerne. Ce n'est qu'après
avoir subi toutes les peines qui lui ont été infligées que l'âme pourra renaître. Les dix juges infernaux président chacun à un enfer différent où sont punis des péchés particuliers. Le premier
d'entre eux est non seulement le souverain du premier enfer, mais encore le chef des neuf autres rois. C'était jadis Yen-lo (Yama), le roi des morts de la mythologie hindoue : mais il était trop
bon et trop doux ; il lui arrivait de permettre aux pécheurs de retourner quelques jours sur terre pour y accomplir de bonnes œuvres et racheter ainsi leurs fautes, en sorte que les mécontents
n'étaient pas punis ; il fut dégradé de son rang suprême et envoyé gouverner le cinquième enfer. Il ne perdit pas pour autant son indulgence. Les « Mémoires sur les dieux » Seou-chen ki
rapportent le cas d'un certain Li Sin de Tch'ou-lieou qui, à l'âge de 38 ans, rêva une nuit que le directeur du Destin l'envoyait chercher par un démon. Conduit au palais du roi Yama, il comparut
devant lui et lui demanda à être renvoyé sur terre pour soigner sa mère veuve et âgée, et mourir le même jour qu'elle. Frappé de cette piété filiale, Yama était près de consentir, lorsque le chef
des démons lui déclara qu'il créait un précédent bien fâcheux et proposa qu'au moins, avant de réexpédier Li Sin chez les vivants, on lui fît subir la peine que méritaient ses péchés ; et il le
jeta dans un chaudron bouillant. Quand le roi Yama se souvint de lui, il avait déjà la tête et le visage si bien bouillis que le chef des démons prit peur et lui mit aussi vite que possible une
autre tête, qui se trouva être celle d'un Barbare d'Occident ; à son réveil chez lui, ce changement de tête causa naturellement certaines perturbations dans sa famille.
Je n'insisterai pas sur la description des enfers et des supplices effroyables que les âmes subissent, dévorées par les fauves, jetées du haut de montagnes, percées de couteaux affilés, sciées en
deux, écrasées sous des meules. Aussi bien y a-t-il heureusement très peu d'âmes assez mauvaises pour mériter les supplices des enfers, de même qu'il y en a malheureusement peu d'assez bonnes
pour mériter les joies du paradis : presque toutes les âmes, n'étant ni très bonnes ni très mauvaises, sont renvoyées immédiatement renaître en ce monde comme êtres humains ou comme animaux. Un
lettré, mort par suite d'une erreur d'un greffier des tribunaux infernaux, qui ressuscita et raconta son voyage aux enfers dans un petit ouvrage qui était très répandu en Chine il y a quelques
années, rapporte que pendant les quelques jours qu'il resta l'hôte du roi du premier enfer, il ne vit que trois âmes qui montèrent aux Palais Célestes, une quarantaine qui furent condamnées aux
supplices infernaux, tandis que 752 reprirent l'existence humaine.
[Cérémonies funéraires]
Les cérémonies funéraires montrent un curieux mélange de pratiques disparates. Il y a, d'une part, des pratiques que les Rituels avaient notées et que cette inclusion dans des Livres Classiques a
conservées ; de l'autre, nombre de pratiques d'origine bouddhique ou taoïque, reflétant la nouvelle conception que se font les Chinois de la vie d'outre-tombe. Le cadre reste celui des cérémonies
funéraires antiques, espacées de la mort à l'ensevelissement, puis de l'ensevelissement à la fin du deuil de trois ans ; mais, le plus souvent, ce sont des cérémonies nouvelles qu'on accomplit
aux jours fixés, et l'esprit dont ces cérémonies s'inspirent ne s'accorde guère avec leur occasion.
Ce qui se passe au moment de la mort et de l'enterrement n'a guère changé : lamentations, rappel de l'âme, lavage du cadavre, habillage, mise en bière, offrandes devant le cercueil, tout cela est
essentiellement pareil ; il s'y ajoute seulement des prières pour le mort, faites ordinairement par des bonzes, afin d'assurer le salut de l'âme. L'enterrement se fait en général au bout de
quelques jours. Le cercueil est emporté de la maison précédé de domestiques, qui jettent à droite et à gauche des lingots de papier pour acheter le passage aux esprits, et suivi d'une chaise à
porteurs et de domestiques en papier, de bannières portant les titres du mort, et enfin des enfants et petits-enfants conduits par le fils aîné en grand deuil, vêtu de la robe blanche sans
ourlet, pleurant ostensiblement et s'appuyant sur un bâton parce que sa douleur doit l'empêcher de marcher sans support. Au retour, après une nouvelle offrande à la maison, a lieu le banquet
funèbre. Jusqu'au troisième jour, on ne doit rien déranger de sa place habituelle dans la maison, car le mort n'est pas encore parti pour les enfers et peut revenir, en particulier pour chercher
la lumière de ses yeux qu'il peut avoir laissée à la maison en partant ; et si les objets sont dérangés, il risque de ne pas la retrouver. C'est le troisième jour qu'a lieu le voyage aux enfers
et qu'on fait la cérémonie du passage du Pont des immortels, cérémonie dont le but est d'aider l'âme à franchir ce pont dangereux, gardé par deux démons, Courte-Vie et Prompte-Mort, qui veulent
précipiter dans le Torrent de la Douleur les âmes qui s'y engagent. Parfois la scène est mimée : on figure le pont à l'aide de quelques tables, et, le soir, le fils portant entre ses bras la
tablette provisoire franchit le pont, arrêté par deux bonzes figurant les deux démons, à qui il doit payer le passage pour continuer son chemin ; pendant ce temps d'autres bonzes récitent des
prières. Le 49e jour, on offre au mort une maison avec son mobilier, des domestiques et des lingots d'or et d'argent, le tout en papier.
[Œuvres pies]
Les œuvres pies qui permettent d'échapper aux enfers sont de toutes sortes. Il y a des fêtes de pénitence, les unes bouddhiques, les autres taoïques, pour effacer les péchés. Mais, de plus, la
restauration de temples, l'érection de statues, l'impression des livres saints sont des œuvres de haut mérite. L'aumône, sous toutes ses formes, est aussi excellente, surtout les dons aux
temples. L'œuvre la plus méritoire, c'est de sauver la vie des êtres vivants, ou, à défaut, de rendre la liberté aux captifs. On s'en procure le mérite sans peine et à peu de frais : en achetant
à la porte des temples des poissons ou des oiseaux vivants qu'on lâche les uns dans une pièce d'eau, les autres au milieu d'une des cours du temple. Le végétarianisme, c'est-à-dire l'abstention
de toute viande et de tout poisson, est cultivé par certains dévots et surtout par des dévotes.
La piété filiale, le loyalisme envers le souverain, la probité sont vantés dans de nombreux tracts populaires ; et, pour raffermir dans de bonnes intentions les hésitants, les temples des Murs et
des Fossés et ceux du Pic de l'Est contiennent des représentations réalistes des divers enfers, quelquefois en grandeur naturelle, dont le spectacle se grave dans l'esprit des enfants quand ils
visitent le temple aux grandes fêtes avec leur mère ou leur grand'mère.
Un autre genre d'œuvres pies, c'est la récitation du nom du Bouddha Amitâyus, grâce à laquelle on ira renaître en son paradis. Le Livre d'Amitâyus, traduit du sanscrit, rapporte comment, il y a
des âges sans nombre, un roi ayant entendu la Loi bouddhique se convertit et abandonna son royaume pour se faire moine. Il se rendit auprès du Bouddha de ce temps, et fit vœu de devenir un jour,
lui aussi, un Bouddha parfaitement accompli ; puis il ajouta le vœu suivant : « Je fais vœu de ne pas prendre une terre de Bouddha qui soit impure ; j'émets ce vœu que, lorsque j'arriverai à
l'état de Bouddha, dans mon monde il n'y ait d'existence ni dans les enfers, ni parmi les démons affamés, ni parmi les animaux, et que tous les êtres y soient exempts de la naissance, de la
douleur et de la mort, qu'ils soient tous couleur d'or et que, naissant par transformation, ils jouissent d'une vie qui dure éternellement. »
[L'état réel de la religion chinoise actuelle]
Après avoir passé en revue le panthéon moderne et décrit les cérémonies du culte populaire, quand on se demande dans quelle mesure cette description correspond à l'état réel de la religion
chinoise actuelle, il est bien difficile de répondre à cette question. La part de croyance vraie et de simple observance traditionnelle qui entre dans ces pratiques varie, en Chine comme
ailleurs, suivant la région et la classe sociale, et selon les personnes. De manière générale, la part de la croyance diminue et celle de la tradition augmente à mesure qu'on monte de la classe
populaire à la classe des lettrés, et aussi quand on passe des femmes aux hommes. Mais, même dans les familles lettrées qui affichent l'incroyance et le mépris des superstitions et prétendent
écarter tout ce qui ne se justifie pas par les Classiques, il n'est guère possible de se soustraire aux actes traditionnels que les voisins attendent. Il y a une trentaine d'années, tel ministre
du dernier empereur mandchou, qui s'était rendu célèbre par ses attaques contre le bouddhisme, n'en appela pas moins, après la mort de sa mère, cent huit bonzes qui se relayaient constamment pour
dire les prières funéraires, simplement parce que c'était la coutume à Pékin pour un homme de son rang, et qu'en ne le faisant pas il aurait paru manquer de piété filiale. En cela la Chine
n'offre pas un spectacle très différent de l'Occident.
Ce qui est vraiment propre à la Chine, c'est une certaine tendance à expliquer et justifier les cérémonies en dehors de toute participation de divinités personnelles. Tendance ancienne, puisque
sa première manifestation date de la fin de l'antiquité ainsi qu'on l'a vu, mais tendance philosophique qui ne se manifeste guère hors de la classe des lettrés. Dès le temps des Han, on
prétendait justifier les sacrifices aux Ancêtres par leur utilité sociale, qui n'exigeait pas qu'on prît parti sur la question de savoir « si les morts avaient ou non la connaissance », si les
âmes des morts survivaient outre-tombe ou non. Au XVIIe siècle, les missionnaires catholiques se sont laissés à demi convaincre que les cérémonies funéraires n'avaient rien de religieux ;
l'interprétation qu'on leur en donnait alors, et d'autres analogues, sont encore courantes aujourd'hui. Il ne faut pourtant pas s'y tromper : il y a autant de traditionalisme dans cette
interprétation rationaliste des uns que dans la croyance raisonnée des autres.
Même quand on laisse de côté ceux qui font profession de scepticisme, pour ne s'adresser qu'à des croyants, le tableau varie énormément d'une région à l'autre de la Chine : il n'y a pas de dogme
fixé, et chacun prend et laisse ce qu'il veut. Il est d'autant plus difficile de se rendre compte de la part de croyance et de simple observance que, vis-à-vis des étrangers, dont le scepticisme
est connu et qui, de plus, sont volontiers considérés comme méprisants, une certaine pudeur fait dans bien des cas adopter un scepticisme de commande qui n'est combattu que par la crainte que des
paroles trop sceptiques n'exposent à quelque vengeance celui qui les prononce. Tout ce que je puis dire est que, pour toutes les régions que je connais et partout où j'ai pu en faire
l'expérience, la croyance est bien plus profondément ancrée dans les esprits, même dans les milieux lettrés, que des voyageurs superficiels ne l'ont cru et dit souvent, et que c'est le
scepticisme qui est à fleur de peau plutôt que la foi.
Les dieux de la religion chinoise moderne, même ceux qui apparaissent à l'esprit occidental comme les plus grands parce qu'ils ont des titres élevés et sont classés au haut de la hiérarchie, n'en
ont pas moins une activité strictement limitée et spécialisée, et hors de leur domaine propre il n'y a rien à attendre d'eux. Même les divinités d'origine bouddhique ont fini par se spécialiser
en Chine : Kouan-yin (Avalokiteçvara) est spécialisée presque entièrement dans la protection des femmes et le don d'enfants ; Ti-tsang (Kshitigarbha) délivre les âmes des enfers ; Amitâyus
accueille en son paradis ceux qui invoquent son nom. On ne saurait attendre de dévotions aussi spécialisées qu'elles aient une grande influence sur l'ensemble de la vie ; elles ne peuvent guère
s'élever au-dessus de la notion donnant donnant. Les seuls sentiments qui aient une action générale sur la vie religieuse et morale sont la Piété Filiale et, dans une moindre mesure, la notion de
rétribution entendue non dans son sens bouddhique de récompenses et de châtiments dans l'autre monde, mais sous la forme de récompenses et de châtiments en cette vie même.
La Piété Filiale n'a guère changé depuis l'antiquité ; peut-être est-elle devenue un peu plus formaliste, mais à peine. Et le « Livre de la Piété Filiale » Hiao-king reste toujours
l'unique fondement de l'éducation morale dans toutes les classes de la société. Tous les enfants l'ont étudié ; tous ont lu ou entendu l'histoire des fils pieux et en ont vu les images. Cet
ouvrage n'est pas d'une inspiration très haute, et les histoires des fils pieux qu'on peut y lire ont presque toutes la naïveté un peu bête de tous les livres de morale à l'usage des enfants en
tous pays. Mais, ressassés, récités, commentés non seulement en paroles mais en action par la famille à tout instant, les préceptes du « Livre de la Piété Filiale » finissaient par s'imposer à
l'esprit des enfants et leur restaient pour la vie entière. Ils sont en quelque sorte le catéchisme de la morale privée en Chine.
Telle est dans ses grandes lignes l'histoire de la religion chinoise de l'antiquité jusqu'à nos jours. Elle a passé par des phases qui rappellent celles des religions de l'Occident. C'est le même
point de départ : une religion du groupe social reposant sur un culte agraire ; puis, à mesure que le sentiment religieux se développe, le même désir se fait sentir de religion personnelle et de
rapports directs avec les dieux. Le taoïsme et le bouddhisme, qui donnèrent corps à ce sentiment religieux, ont eu en Chine à peu près la même relation l'un avec l'autre que les religions dites
orientales et le christianisme dans notre antiquité méditerranéenne. Le taoïsme a préparé les voies au bouddhisme, mais celui-ci n'a jamais triomphé complètement en Chine comme le christianisme
en Occident ; et, à la fin, il a même dû reculer devant le confucianisme, puis devant la religion populaire. C'est la religion populaire qui est la vraie triomphatrice des temps modernes ; elle a
absorbé les Trois Religions en prenant quelque chose de chacune d'elles, et rien n'est plus vivant aujourd'hui que ce curieux mélange d'idées élevées et de superstitions grossières, extrêmement
différent selon les personnes qui le pratiquent.

















