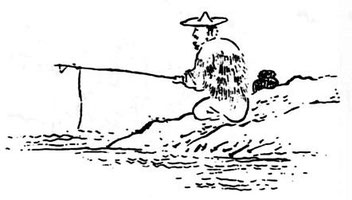Marcel Granet (1884-1940)

FÊTES ET CHANSONS ANCIENNES DE LA CHINE
Première édition : Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences religieuses, tome XXXIV. Ernest Leroux, Paris, 1919.
- Introduction : Je veux montrer qu’il n’est pas impossible de connaître quelque chose des antiquités religieuses de la Chine... Il est donc possible d’étudier l’organisation des temps féodaux ; aussi s’est-on essayé, en classant les textes, à décrire tel culte féodal. Mais, quand on l’a fait, que sait-on de la vie religieuse des anciens Chinois ? Tout ce qu’on atteint, c’est la religion officielle. C’est bien de la décrire ; il faudrait encore savoir de quel fonds de coutumes et de croyances est sorti le culte des États féodaux. Si l’on renonce à retrouver dans les textes autre chose que les formes appauvries de la religion d’État, dès qu’on voudra les expliquer, on se verra au dépourvu... Une étude déçoit qui s’arrête à de si pauvres généralités. Certains, renonçant à saisir dans leur principe les notions religieuses qui règnent en Chine, prennent comme point de départ les faits actuellement observables ; ils en dressent des catalogues : précieux documents ; mais qu’en tire-t-on ? Tantôt on attribue une valeur positive aux explications que les indigènes donnent de leurs coutumes... Ou bien, de soi-même et au gré de l’inspiration, on rattache l’usage à expliquer à telle ou telle des théories à la mode, et, selon que plaît, pour l’instant, le Naturisme ou l’Animisme, on rend compte d’une coutume par la croyance, universelle, aux esprits, ou par l’adoration, non moins répandue, du soleil et des astres : méthode paresseuse qui ne permet pas de classer les faits avec quelque précision, qui en gâte même la description.
Extraits : Quelques chansons d'amours du Che King : Les thèmes champêtres - Les amours de village -
Les chansons des monts et des eaux
Les fêtes anciennes : Les fêtes de Tcheng (Ho-nan) - Les fêtes de Lou (Chan-tong) - Les fêtes de Tch'en (Ho-nan)
Télécharger
Feuilleter :
(Suite des extraits de l'introduction)
- Ni la méthode de l’historien qui se borne à classer les
textes avec les seules ressources de la critique externe, ni celle du folkloriste qui se contente de décrire les faits dans le langage des informateurs indigènes ou dans celui d’une école, ne me
paraissent efficaces : car toutes deux sont peu critiques. On ne peut espérer de résultats, me semble-t-il, que si l’on prend une double précaution : 1° il est bon de soumettre les documents,
d’où l’on espère tirer des faits, à une étude qui détermine d’abord la nature de ces documents et ainsi permette de fixer la valeur exacte des faits ; 2° les faits acquis, et une fois qu’on peut
les traduire dans un langage positif, il est prudent de ne point chercher en dehors d’eux de quoi les interpréter. J’ai donc divisé en deux parties l’étude qu’on va lire : dans la première, j’ai
essayé de montrer ce qu’est au juste le document principal dont je me suis servi ; dans la deuxième, après avoir donné la description de ceux des faits établis qui forment un ensemble suffisant
pour qu’on les puisse interpréter, j’ai tenté cette interprétation.
- Le choix des documents est chose essentielle : pourquoi
choisir, pour les étudier, les chansons d’amour du Che king ? Le Che king est un texte ancien ; par lui on peut espérer entrer de plain-pied dans la connaissance des formes anciennes de la
religion chinoise. C’est là un grand point ; mais qui n’a pas un respect superstitieux des textes antiques ne doit pas se décider sur ce seul avantage. Pour ma part, je n’ai pas l’idée de
chercher dans les faits anciens l’origine des faits récents ; une des convictions que j’ai puisées dans cette étude est qu’il est vain d’établir comme une succession généalogique entre des faits
similaires et d’âge différent... A chaque instant du temps, les coutumes se maintiennent par une création perpétuellement renouvelée. On n’explique pas un usage en montrant qu’il exista jadis des
usages semblables : on l’explique en faisant voir le lien qui, d’une façon permanente, l’unit à certaines conditions de fait... Il se trouve qu’on peut déterminer assez exactement la valeur
documentaire du Che king, ou plutôt de celles des pièces de ce recueil qui sont des chansons d’amour : voilà une première raison de choix ; il se trouve encore que cette valeur est de premier
ordre : voilà la raison principale.
- J’ai confiance que ce travail pourra éclairer l’origine de
quelques croyances chinoises ; il renseignera encore sur la naissance d’un genre littéraire ; il mettra en évidence les points d’attache du symbolisme et de quelques idées directrices de l’esprit
chinois ; enfin il préparera l’étude des procédés par lesquels un rituel savant peut sortir d’un rituel populaire... Je serais heureux si j’avais posé convenablement les questions et dégrossi
l’ouvrage.
*
Quelques chansons d'amour du Che King
Les pièces dont je donne la traduction sont les plus importantes parmi celles du Che
king qui me paraissent être des chansons d’amour ; je les ai rangées dans l’ordre où elles s’expliquent le mieux l’une par l’autre ; elles sont classées d’après les thèmes essentiels qu’elles
contiennent et divisées en trois groupes, chacun suivi des remarques qu’il suggère.
Les chansons qu’on lira d’abord sont remarquables par de brèves descriptions dont les sujets sont empruntés à la nature ; on en retrouve de semblables dans les vieux calendriers. L’étude de ces
thèmes champêtres fera voir que la poésie des chansons est liée à des usages saisonniers ; on peut se demander si elle n’a pas une origine rituelle.
Une deuxième section comprendra les pièces qui peignent l’amour au village. Cette poésie rustique a t elle une origine savante et des fins morales ? Je montrerai que, si on l’a soutenu, c’est
uniquement pour justifier l’emploi pédagogique du Che king. Mais, si on a pu le soutenir, c’est que le souci de l’orthodoxie morale empêchait de comprendre d’anciennes mœurs paysannes. Ces mœurs,
précisément, nous feront connaître de quel milieu sont sorties les chansons. Il restera à étudier la matière et les procédés de cette poésie rustique ; ils ne s’expliquent que si elle a pris
naissance au milieu des chœurs de danse.
Les dernières pièces, enfin, feront connaître les thèmes de la promenade sur les monts et près des eaux ; elles permettront de voir comment les chansons d’amour, comment l’amour avec la poésie
naissaient des rites de fêtes saisonnières. Pour terminer, j’indiquerai brièvement ce que la poésie amoureuse, même devenue personnelle, conserve de l’art primitif de la chanson.
LES THÈMES CHAMPÊTRES
Les mûriers du val (Siao ya VIII, 4).
Les mûriers du val, quelle force !
leur feuillage, quelle beauté !
Sitôt que je vois mon seigneur,
ma joie, quelle n’est-elle pas !
Les mûriers du val, quelle force !
leur feuillage, quelle douceur !
Sitôt que je vois mon seigneur,
allons, quelle n’est pas ma joie !
Les mûriers du val, quelle force !
leur feuillage, quel vert profond !
Sitôt que je vois mon seigneur,
son prestige, qu’il agit fort !
Celui donc que dans mon cœur j’aime,
est-il trop loin pour y songer ?
Lui, que du fond du cœur j’estime,
lui, quand pourrais-je l’oublier ?
Les cailles (Yong fong 5).
Les cailles vont par couples
et les pies vont par paires...
D’un homme sans bonté
vais-je faire mon frère ?
Les pies s’en vont par paires
et les cailles par couples...
D’un homme sans bonté
ferais-je mon seigneur ?
Le nid de pie (Chao nan 1).
C’est la pie qui a fait un nid ;
ce sont ramiers qui logent là !
Cette fille qui se marie,
avec cent chars accueillez-la !
C’est la pie qui a fait un nid :
ce sont ramiers qui gîtent là !
Cette fille qui se marie,
avec cent chars escortez-la !
C’est la pie qui a fait un nid :
ce sont ramiers plein ce nid-là !
Cette fille qui se marie,
de cent chars d’honneur comblez-la !
Le vent du nord (Pei fong 16).
Le vent du nord, quelle froidure !
pluie et neige, quelles bourrasques !
Tendrement, oh ! si vous m’aimez,
les mains jointes, allons ensemble.
Pourquoi rester ? Pourquoi tarder ?
le temps est venu ! oui, vraiment !
Le vent du nord, quelle tempête !
pluie et neige, quels tourbillons !
Tendrement, oh ! si vous m’aimez,
les mains jointes, partons ensemble !
Pourquoi rester ? Pourquoi tarder !
le temps est venu ! oui, vraiment !
Rien n’est fauve comme un renard !
rien n’est noir comme une corneille !
Tendrement, oh ! si vous m’aimez,
les mains jointes, montons en char !
Pourquoi rester ? Pourquoi tarder ?
le temps est venu ! oui, vraiment !
On ne s’étonnera pas de voir les lettrés considérer les thèmes champêtres comme des dictons
de calendrier : cette conception favorise singulièrement l’interprétation morale des chansons. Voit-on deux amants se rencontrer quand la rosée couvre les plantes des champs ? Cela prouve que le
printemps était alors avancé, que, par suite, le temps des mariages était fini, et qu’enfin, puisque garçons et filles se rencontraient encore, le seigneur de leur pays n’y faisait point régner
les bonnes mœurs. La jeune fille, au contraire, se refuse-t-elle à aller, soir ou matin, par les chemins trop mouillés de rosée ? Cela prouve que la Vertu du prince et, par suite, la conduite de
ses sujets étaient conformes à l’ordre naturel.
Certes il ne faut pas suivre les commentateurs dans le détail de leurs explications ; il serait, en revanche, peu prudent de croire que, dans son fonds, le symbolisme dont ils usent ne s’appuie à
rien. Or il est clair qu’il n’a pas d’appui si les thèmes champêtres ont pour origine je ne sais quel sentiment poétique de la Nature ; il n’est fondé en quelque manière que si ces thèmes sortent
d’un rituel saisonnier.
En fait, dans les calendriers agricoles, se retrouvent les thèmes champêtres, classés à leurs dates, parmi des dictons tout semblables. Nous possédons plusieurs calendriers anciens ; quatre
principalement sont utiles à comparer : le Petit Calendrier des Hia, qui est le plus ancien et qu’ont conservé les Rites de T’ai l’aîné ; le Yue ling ou Ordonnances mensuelles, qui forme un
chapitre du Li ki et qu’on retrouve à peu près tel quel dans d’autres ouvrages ; un autre qui est inséré dans le troisième chapitre du Kouan-tseui ; un dernier, enfin, qui figure au chapitre
sixième du Ki tchoung Tcheou chou. Leur étude permet d’établir les faits suivants : 1° Tous sont des calendriers rustiques et indiquent, en général, les termes de l’année à l’aide de dictons
campagnards ; 2° Tous s’efforcent d’affecter chacun de ces dictons à une date précise de l’année astronomique ; 3° Pour cette répartition plusieurs méthodes de classement sont employées :
Kouan-tseu divise l’année en trente périodes de douze jours (huit au printemps, sept en été, huit en automne, sept en hiver). Le Ki tchoung Tcheou chou la divise en vingt-quatre périodes de
quinze jours subdivisées en trois périodes de cinq jours, chacune de ces périodes étant marquée par une formule champêtre. Le Yue ling et le Petit Calendrier des Hia se contentent de la division
en mois ; cependant on trouve, dans le Yue ling, groupées en un ou deux paragraphes pour chaque mois, les formules qui, dans le Ki tchoung Tcheou chou, servent de nom aux périodes de quinze ou
cinq jours. Dans le Petit Calendrier des Hia la plupart aussi se retrouvent, mais dispersées dans la matière de chaque mois ; 4° Tous les dictons n’occupent pas la même place dans les divers
calendriers : par exemple, le Petit Calendrier des Hia fixe au premier mois de printemps la transformation de l’épervier en ramier ; le Yue ling, de même que le Ki tchoung Tcheou chou, la fixe au
deuxième mois.
On comprend assez bien comment ont été composés ces divers calendriers : ils sont les résultats d’un travail de classement qu’inspirèrent des idées théoriques variables et un souci croissant de
symétrie et de précision ; ils sont l’œuvre d’archéologues travaillant sur une matière analogue aux thèmes champêtres des chansons. Dès lors une question se pose : les poètes ont-ils mis dans
leurs vers des dictons de calendrier ? ou bien les calendriers sont-ils faits de débris de chansons ?
Un fait reste acquis : l’importance qu’ont les thèmes champêtres dans la poésie du Che king et pour ses interprètes — même si, en fin de compte, cette poésie est savante, et si, dans le détail,
les interprètes se trompent, — est un indice sûr du rôle considérable que jouaient les usages saisonniers dans la vie et la pensée des anciens Chinois.

LES AMOURS DE
VILLAGE
L’éphémère (Ts’ao fong 1).
Oh ! les ailes de l’éphémère !
oh ! le beau ! Le beau vêtement !
Dans le cœur que j’ai de tristesse !...
près de moi viens-t’en demeurer !
Oh ! les ailes de l’éphémère !
oh ! Le bel habit bigarré !
Dans le cœur que j’ai de tristesse !...
près de moi viens te reposer !
Il sort de terre, l’éphémère !
Robe en chanvre blanc comme neige !
Dans le cœur que j’ai de tristesse !...
près de moi viens te réjouir !
Les coings (Wei fong 10).
Celui qui me donne des coings,
je le paierai de mes breloques ;
Ce ne sera pas le payer ;
à tout jamais je l’aimerai !
Celui qui me donne des pêches,
je le paierai de belles pierres ;
Ce ne sera pas le payer :
à tout jamais je l’aimerai !
Celui qui me donne des prunes
je le paierai de diamants ;
Ce ne sera pas le payer :
à tout jamais je l’aimerai
Le dolic (T’ang fong 11).
Le dolic pousse sur les buissons,
le liseron croît dans les plaines...
Mon bien-aimé est loin d’ici !...
avec qui ?..non, seule ! Je reste !...
Le dolic pousse aux jujubiers,
le liseron croît sur les tombes...
Mon bien-aimé est loin d’ici !...
avec qui ?..non, seule ! Je repose !...
Hélas ! Bel oreiller de corne !...
Hélas ! Brillants draps de brocart !...
Mon bien-aimé est loin d’ici !...
avec qui ?..non, seule ! j’attends l’aube !...
Jours de l’été !...
nuits de l’hiver !...
Après cent ans passés
j’irai dans sa demeure !
Nuits de l’hiver !....
jours de l’été !...
Après cent ans passés
j’irai dans sa maison !
Je t’en supplie (Tcheng fong 2).
Je t’en supplie, ô seigneur Tchong,
ne saute pas dans mon village,
ne casse pas mes plants de saule !...
comment oserais-je t’aimer ?...
J’ai la crainte de mes parents !...
O Tchong, il faut t’aimer, vraiment,
Mais ce que disent mes parents
il faut le craindre aussi, vraiment !
Je t’en supplie, ô seigneur Tchong,
ne saute pas sur ma muraille,
Ne casse pas mes plants de mûriers !..
Comment oserais-je t’aimer ?..p.74
j’ai la crainte de mes cousins !..
O Tchong, il faut t’aimer, vraiment,
Mais ce que disent mes cousins
il faut le craindre aussi, vraiment !
Je t’en supplie, ô seigneur Tchong,
ne saute pas dans mon verger,
Ne casse pas mes plants de t’an !...
Comment oserais-je t’aimer ?...
j’ai la crainte de ces cancans
O Tchong, il faut t’aimer, vraiment,
Mais les cancans que font les gens
il faut les craindre aussi, vraiment !
Si les Chinois croient à l’origine savante du Che king, c’est qu’ils l’expliquent savamment
; s’ils sont obligés d’en faire une explication subtile, c’est qu’ils veulent en tirer un enseignement conforme à l’orthodoxie morale : la théorie de l’origine savante des chansons est liée à
leur emploi pédagogique. Si parfois les lettrés se sentent moins sûrs et de la valeur morale et de l’origine savante, c’est qu’il y a trop de distance entre les mœurs qu’ils découvrent dans
l’Anthologie et celles qu’ils estiment vertueuses. L’embarras des interprètes leur vient, en dernière analyse, de leur croyance à l’immutabilité des principes moraux.
Mais, dès qu’on ne se sent pas tenu de respecter le Che king comme un classique, dès qu’on ne croit pas à la valeur première des règles confucéennes, rien n’oblige à penser que telle chanson
peint le vice et telle autre la vertu, rien n’oblige à prouver que là seulement où s’exerça l’influence royale les mœurs furent bonnes ; il est plus simple, il est plus sûr de présumer que toutes
les chansons expriment les mœurs régulières du temps passé.
Elles nous montrent fort simplement des amours de campagne. C’était aux champs que garçons et filles liaient connaissance, il y avait en dehors des portes des lieux de promenade où ils se
rencontraient ; c’était tantôt parmi les mûriers, tantôt dans les vallons, ou bien sur un tertre, ou bien près de la source qui en jaillissait. Ils y allaient par la grand’route, souvent sur le
même char et les mains jointes. Les assemblées étaient nombreuses ; les filles y semblaient un nuage ; elles étaient soigneusement attifées : on admirait leurs beaux habits bigarrés, leurs robes
de soie à fleurs, leurs coiffes grises ou garance, leur beauté ; on comparaît à des fleurs blanches, à des fleurs de cirier, celle qui vous charmait ; on se choisissait et l’on s’abordait ;
souvent les filles prenaient les devants et invitaient les garçons ; parfois elles faisaient les fières et traitaient de haut les jeunes fous ; puis elles s’en repentaient. Les jeunes gens se
faisaient rustiquement la cour, s’invitant à manger et à boire ensemble ; ils se réjouissaient ; alors venaient les cadeaux, les gages d’amour, les protestations de fidélité, les serments ; car,
après ces accordailles, il fallait rentrer chez soi et vivre loin l’un de l’autre, chacun dans son village, jusqu’à la réunion prochaine. Il y avait des inconstants qui refusaient de renouer les
vieilles relations et qu’on allait supplier et prendre par la main ; d’autres fois on essayait de les piquer de jalousie ; sur tous ces manèges d’amoureux les cancans allaient leur train ; plus
d’une se plaignait des médisances ; telle pleurait son amour perdu ; mais la bonhomie paysanne dominait tout :
Lorsqu’on veut prendre une femme
Faut il des princesses de Song ?
Il semble qu’au village l’on avait, moins de liberté ; les temps de séparation étaient durs à passer. Tout en faisant sa besogne on songeait aux absents et leur pensée revenait dans les chansons
de travail. On tâchait de se voir, on se donnait des rendez vous ; le crépuscule était l’heure propice, on s’attendait dans les ruelles ou bien au coin des remparts Quand on ne pouvait se réunir,
on prenait du plaisir à entendre la voix de l’ami ou à le regarder passer, tout paré, au haut des murailles. On se retrouvait parfois la nuit ; les amants trop hardis faisaient frémir les filles
soucieuses du qu’en dira t on, de leurs parents et de leurs frères ; pourtant elles appelaient leur venue de tout leur cœur. Mais s’ils réussissaient à les rejoindre, sautant murs et haies du
hameau où habitaient leurs familles, dès le chant du coq elles les pressaient de s’en aller et ils se départaient de leur amour.
Il y a trop de naïveté dans ces mœurs rustiques pour y voir, si l’on n’est pas pédagogue, un spectacle de corruption. On voudrait, pour la gloire de l’orthodoxie morale, que les paysans de la
Chine ancienne aient obéi, par avance, aux règles de la vie seigneuriale, que les lettrés transformèrent en maximes universelles : c’est manquer de critique. Ne nous dit on pas que les rites ne
s’appliquaient pas aux gens du peuple ? On ne leur accorde pas de temples d’ancêtres : comment veut on que leurs filles s’y soient retirées dès quinze ans, pour y faire, avant le mariage, leur
apprentissage rituel ? Que dès le temps des Tcheou on ait cherché à rendre uniformes les usages, c’est bien possible ; la chanson le char du seigneur, si elle ne conte pas simplement un amour
contrarié, montre, peut être, l’arrivée d’un officier chargé de faire respecter parmi le peuple les règles de la séparation des sexes, telles que les nobles les comprenaient ; mais alors cette
chanson fait sentir combien cette innovation parut douloureuse. En allant se chercher des amis dans la campagne, en leur donnant des rendez vous au village, les paysannes d’autrefois ne violaient
que des règles qui n’étaient point faites pour elles ; elles obéissaient à de vieux usages : les accordailles se faisaient dans les champs, elles étaient suivies d’une période de séparation
pendant laquelle les jeunes filles ne revoyaient leurs amants qu’en se cachant de leurs parents : c’était là le temps des fiançailles. Émotions des rencontres, ennui de l’absent, voilà de quels
sentiments est faite la poésie de nos chansons ; certes, il n’est point commode d’en tirer les enseignements confucéens, mais pour y voir de l’immoralité, il faut manquer de sens historique. Ces
vieilles chansons sont morales à leur manière : elles expriment une vieille morale. Seulement elles ne l’expriment pas délibérément : elles ne sont pas œuvres de moralistes, elles n’ont guère
l’air d’être nées d’un travail de réflexion ni de sortir d’un milieu aussi raffiné que celui qui, plus tard, y prit plaisir. Croie qui voudra que ce sont œuvres de lettrés !

LES CHANSONS DES EAUX
ET DES MONTS
Les tiges de bambou (Wei fong 5)
Les tiges de bambou si fines
c’est pour pêcher dedans la K’i !
À toi comment ne penserais-je ?
mais au loin on ne peut aller !
La source Ts’iuan est à gauche,
à droite la rivière K’i !
Pour se marier une fille
laisse au loin frères et parents !
La rivière K’i est à droite,
à gauche la source Ts’iuan !
Les dents se montrent dans le rire !...
Les breloques tintent en marchant !...
La rivière K’i coule ! coule !
rames de cèdre !..barques en pin !...
En char je sors et me promène,
c’est pour dissiper mon chagrin !...
La Han (Tcheou nan 9)
Vers le Midi sont de grands arbres ;
on ne peut sous eux reposer !
Près de la Han sont promeneuses ;
on ne peut pas les demander !
La Han est tant large rivière,
on ne peut la passer à gué !
Le Kiang est tant immense fleuve,
on ne peut en barque y voguer !
Tout au sommet de la broussaille,
j’en voudrais cueillir les rameaux !
Cette fille qui se marie,
j’en voudrais nourrir les chevaux !
La Han est...
Tout au sommet de la broussaille,
j’en voudrais cueillir les armoises !
Cette fille qui se marie
j’en voudrais nourrir les poulains !
La Han est...
La belle armoise (Siao ya III).
O la belle, la belle armoise,
qui est au milieu du coteau !
Sitôt que je vois mon seigneur,
quelle joie donc et quel respect !
O la belle, la belle armoise,
qui est au milieu de l’îlot !
Sitôt que je vois mon seigneur,
mon cœur alors a la gaieté !
O la belle, la belle armoise,
qui est au milieu de la berge !
Sitôt que je vois mon seigneur,
il me donne cent coquillages !
La barque en peuplier vogue ! vogue !
plongeant tantôt, flottant tantôt !
Sitôt que je vois mon seigneur,
mon cœur alors a le repos !
Je croirais volontiers, sur la foi des chansons, qu’à des temps réglés, en des lieux
consacrés, l’usage voulait qu’il se tint de grandes réunions champêtres.
C’était au bord de l’eau ou sur les montagnes : tantôt une mare ou un lac, tantôt un gué ou une source, parfois le confluent de deux rivières ou bien encore une haute colline, un tertre boisé, un
fond de vallon attiraient les visiteurs. Pour quelques pays, nous pouvons voir où se tenaient les assemblées. Dans les seigneuries du Sud, les jeunes filles se promenaient sous les grands arbres
des bords de la Han, près de son embouchure, dans le (Yang-tseu) Kiang. À Tcheng, c’était sur les beaux gazons d’au-delà de la Wei, là où elle s’unit à la rivière Tchen, que les filles
retrouvaient les jeunes fous du pays. On allait, à Tch’en, s’ébattre sous les chênes du tertre Yuan, à l’est de la ville. Dans les pays de Wei, la belle Mong Kiang et la belle Mong Yi et la belle
Mong Yong et cette femme aussi que séduisit un rustre, accompagnaient leurs amants sur les bords de la K’i : là était un tournant où poussaient de superbes bambous ; tout à côté se trouvait le
tertre Touen ; on y allait en même temps. Apparemment, puisque les chansons, souvent, parlent tout ensemble des eaux et des monts, l’on devait d’ordinaire se réunir auprès de quelque hauteur
dominant la rivière ou bien auprès d’une pièce d’eau ou d’une source placées sur les flancs d’un coteau ; et il y a grand’chance que ce fut toujours sur de riches prairies basses ou sous de beaux
massifs d’arbres, en des lieux, enfin, où la végétation était belle.
Quand y allait-on ? Seuls les thèmes champêtres peuvent indiquer la date ; il ne faut pas la vouloir aussi précise que la donnent les glossateurs en rapportant ces thèmes aux calendriers
rustiques qu’ils servirent à former ; il est vraisemblable, aussi bien, que, selon les pays, la date variait. On a l’impression que les mois propices étaient ceux de l’automne et du
printemps...
À ces fêtes printanières et automnales des eaux et des monts que se passait-il ? On y venait des différents villages et hameaux ; il ne semble guère qu’il y eût pour une seigneurie plus d’un lieu
de réunions. Les jeunes gens allaient se chercher et partaient en bande ; les uns offraient leur char ; les autres se faisaient inviter. En arrivant au terrain de fête on trouvait une grande
animation ; sans doute il y avait des installations provisoires, des marchands ambulants, une foule de voitures et de barques, des passeurs d’eau qui appelaient la clientèle. Les promeneurs se
répandaient tout au long de la rivière ou du coteau, joyeux, riant à belles dents, admirant le spectacle, beauté des arbres, grandeur de la montagne, luxe des barques de cèdre... Alors venaient
les jeux : le passage de l’eau, l’ascension du mont.
On traversait le gué en soulevant les jupes ou en les troussant ; parfois on allait à la nage, s’aidant peut-être de calebasses évidées ; quand l’eau était trop haute, la rivière trop puissante,
ceux qui avaient une voiture s’en servaient, un peu inquiets, si l’eau arrivait aux essieux ou aux tentures ; ou bien on frétait une barque et l’on avait l’émotion de la voir tantôt plonger et
tantôt flotter. On se poursuivait le long des berges, des digues, des barrages, ou bien dans le courant même, au beau milieu de l’eau, jusque sur les bancs de sable et les écueils. On s’amusait à
pêcher, mais surtout l’on cueillait les fleurs qui poussent dans les coins humides ou les plantes d’eau, joncs, nénuphars, orchidées, armoises, lentilles d’eau, mauves, herbes aromatiques.
On gravissait les coteaux, en char souvent, à la course, au point d’en rendre fourbus ses chevaux ; dans les bois et les pâturages on cueillait aussi des fleurs ; peut-être chassait-on ; surtout
l’on faisait des fagots, coupant à la hache les branches de chênes, ramassant les broussailles et la fougère.
On sent qu’il devait y avoir dans tous ces exercices une grande émulation et que le passage, l’ascension, les poursuites, les cueillettes étaient tout autant d’occasions à luttes et à joutes ; on
se lançait des invitations, des défis. Or, assurément, l’agitation joyeuse de cette jeunesse réunie ne se faisait pas dans le désordre ; ce n’étaient point des bousculades que ces luttes ; ce
n’étaient point des cris confus que ces défis ; les mouvements et la voix se réglaient sur le son des instruments, on battait le tambour, on faisait résonner le tambourin d’argile et, sur le
rythme qu’ils donnaient, au fil de l’eau, au penchant des collines se déroulaient en chantant des danses processionnelles.

*
Les fêtes anciennes
Les chansons d’amour du Che king m’ont permis d’établir le type moyen des fêtes
saisonnières des monts et des eaux ; j’étudierai maintenant quelques fêtes locales.
Les fêtes
printanières de Tcheng (Ho-nan).
Dans la seigneurie de Tcheng, les jeunes gens et les jeunes filles se réunissaient en grand nombre près du confluent des rivières Tchen et Wei ; ils y venaient en bande cueillir des orchidées, se
provoquaient en chants alternés, puis, jupes troussées passaient la Wei, et, quand les couples s’étaient unis, les nouveaux amants, en se séparant, se donnaient une fleur comme gage d’amour et
signe d’accordailles.
La fête se tenait quand la Tchen et la Wei étaient grosses, c’est-à-dire, affirme-t-on, au moment de la crue printanière que produit le dégel. C’est au premier mois de printemps que le vent d’est
amène le dégel ; cependant une autre tradition place la fête au moment où le pêcher fleurit et où tombent les premières pluies, termes agricoles que les calendriers rapportent au deuxième mois,
ce qui n’empêche pas qu’on ne donne encore comme date le premier jour Sseu du troisième mois. Il est clair que la fête, d’abord liée aux premières manifestations de l’éveil printanier, fut
ensuite assignée à un terme fixe, à un jour déterminé du calendrier.
Sur le lieu de la fête nous avons un témoignage complémentaire : L’assemblée se tenait au pied d’une montagne de la sous-préfecture de Tou-leang ; il en sortait une source très pure ; il y
poussait des orchidées qu’on appelait parfois « parfums de Tou-leang ». Les réjouissances où venaient les jeunes gens de cet étroit pays de montagnes qu’était Tcheng se tenaient donc au bord de
l’eau et au pied des monts.
La cueillette des orchidées est celle des parties de la fête sur laquelle nous avons le plus de renseignements. C’était, nous dit-on, un moyen de se préserver des mauvaises influences, de se
prémunir contre les venins, c’était un rite de purification. C’était sur l’eau, dit-on encore, que, tenant en mains ces orchidées, tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles de Tcheng
chassaient les influences malignes, les maléfices, les impuretés de l’air ou de la saison ; du même coup ils évoquaient les âmes, ou, pour traduire plus exactement, ils appelaient les âmes
supérieures (houen — âme-souffle) pour les réunir aux âmes inférieures (po = âme corporelle, âme du cadavre, âme-sang).
Propitiations, lustrations diverses, cueillettes de fleurs, passage de l’eau, joutes de chants, rites sexuels, accordailles, voilà ce dont, à notre connaissance, se composait à Tcheng la fête
printanière des eaux et des monts.

Les fêtes
printanières de Lou (Chan-tong).
Un jour qu’il s’entretenait avec quatre de ses disciples assis auprès de lui, Confucius s’enquit de leurs désirs : à quoi voudraient-ils employer leur mérite, si quelque prince, d’aventure, le
reconnaissait ? L’un désirait rendre fort et prospère un État affaibli par la famine et les ennemis, l’autre voulait enseigner la musique et les rites ; le troisième aider aux cérémonies du
temple ou du palais ; mais, le dernier, déposant la harpe dont il jouait, répondit (si j’en crois les interprètes chinois et les traducteurs européens) qu’il préférait, pour lui, « au troisième
mois de printemps, dans le costume complet qui convient à cette saison, et en compagnie de cinq ou six hommes faits et de six ou sept jeunes garçons, aller se baigner dans la rivière Yi, jouir de
la brise au pied de l’autel de la pluie et après avoir chanté (ou bien, en chantant) s’en revenir. » Et Confucius l’approuva.
Cette approbation étonne : le Sage en était-il venu à préférer les charmes d’une partie de campagne aux plus hauts desseins de la politique ? S’était-il décidé, converti par Lao-tseu, à ne plus
se mêler de conduire les hommes ? où bien la réponse qu’il approuva contenait-elle une flatterie délicate, qui lui fut sensible ? On le croirait à lire le glossateur ; selon lui, le disciple bien
inspiré voulait exprimer qu’il ne formait point d’autres vœux, dès qu’il aurait goûté quelques plaisirs printaniers et chanté, comme il convient, la vertu des anciens rois, que de s’en revenir
bien vite auprès du Maître. Innocents plaisirs ! Touchant attachement ! Cette explication doucereuse ne satisfait guère : car, enfin, pourquoi était-ce justement avec des habits de printemps, en
compagnie d’un nombre réglé de jeunes gens et d’hommes faits, et tout exprès au pied des autels de la pluie, que l’on désirait aller se divertir, pour un moment ?
Il y a grand’chance, pour qui ne fait que lire le texte, que les vœux auxquels Confucius donna la préférence n’aient pas été tout différents des autres ; sans doute, celui qui les émit voulait, à
sa manière, être utile à l’État. Or, la pluie est affaire d’État. Il appartient à un bon gouvernement de la faire tomber en son temps ; mieux encore qu’au progrès matériel, à l’ordonnance des
rites, au cérémonial, le mérite se voit si l’on obtient la pluie de saison. Que Confucius ait ainsi pensé, c’est fort possible ; en tout cas, c’est bien ainsi que jadis, en Chine, on interpréta
ce passage de ses Entretiens. Témoin Wang Tch’ong qui, dans son Louen heng, y voit une description des fêtes printanières de la pluie, telles qu’elles avaient lieu à Lou, patrie du Sage.
Wang Tch’ong a conservé diverses gloses de ce texte et une variante. Le mot que l’on a traduit par revenir et qui fournit à l’interprète classique une si plaisante remarque, est l’homophone d’un
terme qui signifie repas et peut très bien désigner le festin qui suit un sacrifice. Wang Tch’ong donne cette orthographe et explique qu’après avoir chanté dans la cérémonie, on festoyait.
Les autres notes ne manquent pas d’intérêt. On conteste que la date soit le troisième mois ; c’est au deuxième mois que les habits de printemps étant achevés, on les revêtait pour accomplir la
cérémonie. Les participants étaient des danseurs et des musiciens, spécialement chargés des rites de la pluie. Ils se composaient de deux groupes égaux : six ou sept jeunes garçons, autant
d’hommes faits, car, avec ceux-ci compte le disciple de Confucius qui veut prendre part à la fête et la diriger. Tous ensemble, ils passaient à gué la rivière Yi et chantaient sur le tertre
consacré aux danses et aux chants qui font venir la pluie. On ne croit pas qu’ils se soient baignés ni qu’ils aient fait sécher leur corps au vent : au deuxième mois de printemps, il fait encore
trop froid. On explique qu’au lieu d’entendre « jouir de la brise au pied des autels de la pluie », ou « se sécher le corps au vent sur ces autels », il faut lire : « chanter sur les autels de la
pluie ». On donne pour cela au mot dont le sens normal est vent, le sens de chant ou chanson qu’il a, par exemple, dans le titre de la première partie du Che king. Enfin, et ceci est fort
instructif, on voit dans le passage à gué de la rivière Yi, une espèce de danse processionnelle où était imité le dragon sortant de l’eau.
Il y avait donc à Lou, au printemps et à une date qui, peut-être varia, qui correspond en tout cas à la fin du tissage des habits de la saison chaude, une fête sur les bords de l’eau, dont on
attendait la pluie : deux groupes différents d’acteurs y prenaient part qui dansaient et chantaient, un sacrifice et un festin complétaient la cérémonie ; une partie essentielle en était le
passage de la rivière.
Le rapprochement s’impose avec les fêtes de Tcheng qui ont lieu sensiblement à la même époque et où un rite essentiel est aussi le passage de l’eau. Qu’à Tcheng, en passant la Wei, on imitât le
dragon, il y a des raisons de le croire : En 523 avant J.-C. « il y eut (dans cet état) de fortes pluies : des dragons combattirent dans les marais de la Wei ; le peuple voulut leur faire des
sacrifices . » Le ministre du pays, qui était philosophe, s’y opposa ; mais s’il ne croyait plus à la nécessité de s’occuper des dragons, maîtres de la pluie, les gens du commun y croyaient
encore et il est permis de penser que, lorsqu’elles passaient la Wei, les bandes de jeunes garçons et de jeunes filles, imitaient les dragons sortant de la rivière : ainsi les obligeaient-ils à
faire pleuvoir.
N’y avait-il, à Lou, ni cueillette de fleurs ni rites sexuels ? Pour ces derniers, on peut croire que non, puisque n’assistaient à la cérémonie que quelques couples de fonctionnaires et
d’adolescents. Les Tcheou, disent leurs rites, employaient pour faire pleuvoir, sorcières et sorciers ; à Lou tout se passait entre hommes : à cette fête officielle de la pluie, Confucius n’avait
rien à redire.

Les fêtes de Tch’en
(Ho-nan).
La fortune de Tch’en lui vint de T’ai Ki, dit le Kouo yu, tandis que les glossateurs du Che king rendent T’ai Ki responsable des mauvaises mœurs du pays. T’ai Ki était une princesse du sang de la
Chine, venue de la capitale des Tcheou, pour épouser le prince de Tch’en. Elle n’avait point eu d’enfants et s’était plu aux danses des sorciers et des sorcières. Voilà pourquoi, longtemps après,
les gens de Tch’en chantaient et dansaient sans mesure sous les chênes du tertre Yuan.
C’était une première raison de scandale de danser ainsi hors de propos ; mais la principale est que, dans ces réunions dansantes, les sexes se mêlaient : même les enfants des grandes familles
paraissaient en des lieux où n’était guère leur place. Qu’à Tch’en l’on dansât trop et hors de saison, il est possible : « qu’importe hiver ! été qu’importe ! » dit, peut-être avec une nuance de
blâme, une chanson. Qu’il y eût mélange des sexes, c’est bien certain : on chantait des chants alternés, on se faisait des déclarations galantes, on se donnait des fleurs. Mais que les meilleures
familles se soient alors déshonorées, ce sont les glossateurs qui le veulent : ils ont confié à l’histoire le nom de deux maisons compromises, celle de Tseu Tchong, celle de Yuan.
Pour Tseu Tchong, la chanson nomme son enfant, qui dansait sur la place publique ; il était, dit-on, grand officier : on n’eut sans doute pas grand’peine à retrouver dans les annales de Tch’en un
nom aussi commun. Le mérite fut plus grand pour Yuan : c’est dans le texte qu’on le retrouva. Il y figure (ou plutôt sa fille) dans les vers que j’ai ainsi traduits :
« Un beau matin l’on se cherche
Dans la plaine du Midi.
Le sens que j’ai suivi, simple et clair, est celui des modernes pour qui Yuan a ici sa valeur commune de plaine. Les anciens qui eurent le bonheur de découvrir à Tch’en une famille Yuan,
comprenaient ingénieusement :
« Un beau matin l’on va chercher
(la fille de la famille) Yuan (qui habite) au Midi.
Et comme c’était assurément une fille qu’on découvrait ainsi entre les vers, il était clair qu’elle avait été séduite par l’enfant de Tseu Tchong et, partant, que celui-ci était un garçon.
Tant d’ingéniosité ne mérite pas l’oubli : l’obstination des interprètes à retrouver dans cette pièce des noms de fonctionnaires est instructive. Pour les glossateurs, la chanson raconte une fête
de la pluie, fête officielle, naturellement. Le fils de Tseu Tchong, qui y figure, est un chef de pantomimes : c’est donc sa fonction d’aller danser sous les ormeaux. Pourquoi crie-t-on au
scandale ? C’est que le fils de Tseu Tchong mène avec lui des danseuses. Mais le Tcheou li ne nous dit-il pas que les chefs des sorciers conduisent la danse des sorcières ? La vérité est qu’il ne
peut ici être question de danseuses professionnelles : il est clair qu’on parle de jeunes filles dont le tissage était l’occupation ordinaire ; de telles jeunes filles, en effet, l’exhibition est
un scandale. On le voit : l’interprétation classique est pleine d’inconséquences ; les glossateurs ne sortent point d’embarras parce qu’ils veulent voir dans la fête populaire que décrit la
chanson, une cérémonie officielle analogue à celle de Lou.
La fête de Tch’en avait lieu au moment où sont finis les travaux de tissage (c’est alors qu’on peut revêtir les habits légers en toile de chanvre). On y jouait d’antiques instruments ; on
chantait en agitant éventails et plumes d’aigrette ; du bas en haut du tertre Yuan, les chœurs de danse demandaient la pluie : passaient-ils pour cela quelque rivière ? Imitaient-ils l’ascension
du dragon ? Les commentateurs, de toutes façons, sont si bien assurés qu’il s’agit d’une fête de la pluie que certains entendent les deux derniers caractères des 5e et 9e vers des Ormeaux comme
s’ils figuraient les cris consacrés pour faire pleuvoir.
Chanteurs et danseurs n’étaient pas tous du même sexe ; il y avait sur le tertre Yuan, comme à Tcheng près de la Wei, des filles et des garçons qui s’interpellaient en vers et, s’offrant des
fleurs, se déclaraient leur amour. Des rites sexuels se mêlaient à la fête : pour l’avoir mise en vogue, c’en fut fait de la réputation de T’ai Ki.
T’ai Ki n’avait point d’enfants et elle aimait ces fêtes. Désirait-elle seulement faire tomber la pluie ? Et suffisait-il à ceux et à celles qui s’offraient des graines aromatiques que la pluie
vint rendre la terre féconde ? De fait, ces graines sont un des emblèmes de la fécondité ; c’était un gage de fécondité et non pas seulement un gage d’amour qu’on recevait avec une poignée
d’aromates. Leur parfum, nous dit-on, était capable de faire descendre les puissances sacrées : ainsi sur la Wei, les âmes étaient évoquées par les parfums de Tou-leang. À la fête du printemps de
Tch’en, après T’ai Ki, les filles du pays demandaient des enfants ; ainsi faisaient sans doute les filles de Tcheng qui cueillaient l’orchidée. N’était-il point comte de Tcheng ce seigneur que sa
mère conçut miraculeusement en recevant une orchidée ?