Henri Maspero (1883-1945)
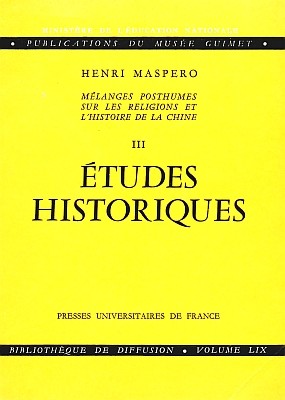
LES RÉGIMES FONCIERS EN CHINE DES ORIGINES AUX TEMPS MODERNES
Article extrait du Recueil de la Société Jean Bodin, t. II, Bruxelles, 1937, p. 265-314.
Mélanges posthumes..., Paris, 1950, vol. III Études historiques, pages 147-192.
- "Aujourd’hui [années 1930], la terre est tellement divisée et la petite propriété est tellement la règle normale que les statistiques officielles considèrent comme grande toute propriété dépassant 50 meou (3 ha). Les propriétés de moins de 3 hectares détiennent plus de la moitié de la surface du sol et forment 83 % des cotes foncières. La moitié de la population paysanne environ vit du produit de ses propriétés, un quart doit joindre à ce qu’il possède l’affermage de terres complémentaires pour trouver sa subsistance ; le dernier quart, dénué de terres, gagne sa vie comme ouvriers agricoles salariés."
- "En somme, aujourd’hui, le paysan chinois a non seulement conquis le droit d’être propriétaire du sol, mais encore il a acquis le sol lui-même ; si les propriétés sont, en général, très petites, ce n’est pas que la grande propriété réduise les paysans à la portion congrue, c’est que la population étant très dense et n’ayant, pour vivre, d’autres débouchés que l’agriculture, la part proportionnelle de chaque famille est nécessairement très réduite."
- "Les anciens modes de possession du sol par concession viagère, spéciaux aux paysans, de même que les types successifs de tenure seigneuriale, réservés aux princes et aux fonctionnaires, ont disparu les uns après les autres, pour ne laisser subsister qu’une propriété qui ne diffère de celle que le droit romain nous a léguée que par cette restriction que le « droit d’abuser » n’est pas reconnu au propriétaire, du moins en principe, et que les Codes (au moins jusqu’à la fin des Ts’ing) prévoient sa déchéance en cas de négligence ou de non-culture de ses terres. À part cette restriction plus théorique que pratique, le droit de propriété est entier ; il se cède en entier ou se fractionne aussi librement et avec autant de nuances que dans la plupart des pays occidentaux."
Extraits : L'antiquité - L’époque des Han et des Trois Royaumes - L’époque des règlements agraires
Complément
Feuilleter
Lire aussi
Au début de l’époque historique, les Chinois vivaient en petites communautés agricoles dans les plaines du bas fleuve Jaune. Un village groupait
quelques familles sur un terrain assez élevé pour être protégé contre les inondations annuelles : tout autour, les terres, suivant leur hauteur au-dessus des eaux, formaient des étangs ou des
marais, des prairies, des taillis et des forêts. C’est dans la petite brousse de taillis et de forêts que les habitants d’un village allaient ensemble chaque année faire un défrichement en
commun, parfois assez loin du village. La grande chasse d’hiver, où on incendiait la brousse pour tirer le gibier qui fuyait devant le feu, rappelle rituellement les incendies des défrichements.
Au printemps, les gens du village « faisaient sortir le feu » et allaient s’installer au lieu du défrichement où ils élevaient des buttes temporaires, puis ils dessouchaient, préparaient le sol
et semaient. La récolte faite, on faisait « rentrer le feu », et les gens retournaient dans leurs maisons du village. Le défrichement durait de 3 à 5 ans, suivant les terres, et les meilleures
récoltes étaient celles de la 2e année ; quand le sol était épuisé, on allait ailleurs choisir un autre terrain.
Chaque village avait son domaine, réservé à ses propres défrichements à l’exclusion de ceux des voisins. Comme le défrichement était fait en commun, les paysans cultivaient tous ensemble et se
partageaient la récolte, dont une partie allait au seigneur ; l’étendue du défrichement était calculée suivant le nombre des familles qui y prenaient part. Plus tard, quand, dans la deuxième
moitié des Tcheou, aux siècles qui précédèrent les Han, les champs permanents prirent peu à peu la place des défrichements, la notion que le sol était propriété de la communauté, et non des
particuliers, resta à la base des idées chinoises, et s’imposa à toute leur organisation agraire pour des siècles : seulement, la communauté s’élargit, et du village devint l’empire entier ;
aujourd’hui encore, elle domine les conceptions de certains réformateurs qui se contentent de l’affubler d’apparences socialistes ou communistes pour la faire paraître nouvelle.
L’existence de grands domaines fonciers n’était pas en contradiction avec cette notion, parce que les deux faits n’étaient pas sur le même plan. Le domaine foncier privé, réservé aux nobles et
aux mandarins à qui il servait de solde, est en principe au-dessus ou à côté du domaine foncier public partagé entre les paysans ; ce sont deux institutions distinctes qui ne doivent pas empiéter
l’une sur l’autre. D’une part, le seigneur ne doit pas gêner l’exercice du droit des paysans à cultiver, et c’est pourquoi on blâme la création de grands parcs de chasse qui enlèvent aux paysans
non leurs terres, puisqu’ils n’en possèdent pas, mais leur droit à cultiver les terrains rendus à la brousse ; d’autre part, le droit du paysan, n’étant pas un droit de propriété, ne peut gêner
en rien le droit du seigneur à disposer de son domaine.
La culture par défrichement disparut peu à peu au temps des Tcheou Occidentaux : le Yi-king la mentionne comme une pratique normale ; mais les commentateurs, au temps des Han, tout en
sachant en gros ce dont il s’agit, la connaissent si mal qu’ils ne sont pas d’accord dans leurs explications des termes. L’augmentation de la population, et aussi la nécessité d’avoir les
exploitations à proximité des habitations pour les défendre en ces temps de razzias et de guerres continuelles (peut-être pas plus fréquentes qu’aux époques plus anciennes, mais avec des armées
aux effectifs grandissants), devaient amener les paysans à restreindre le cercle des défrichements, en même temps que le progrès des méthodes de culture et l’emploi des engrais permettaient de
continuer le travail sur le même lopin de terre pendant plus longtemps, et de remplacer les longues périodes de retour à la brousse par de courtes jachères. Les Jarai du plateau qui s’étend
autour de Ple Ku, au sud de Kon-tum en Annam, ont aujourd’hui des habitudes de ce genre, intermédiaires entre le défrichement pur et simple et le champ permanent : les terres, bonnes et bien
arrosées, ne sont jamais complètement rendues à la brousse ; elles sont simplement laissées en jachère pendant un ou deux ans après chaque période de culture de 3 à 5 ans. Au point de vue
technique, ils sont par conséquent passés du défrichement temporaire à la culture par assolement avec des jachères régulières. Mais, au point de vue social, la situation du cultivateur n’a pas
changé : comme il ne peut naturellement pas vivre un ou deux ans sur ses réserves pendant la période de jachère en attendant que la terre soit de nouveau propre à la culture, il quitte le terrain
qu’il cultive au premier signe d’épuisement (comme autrefois le défrichement), et s’en va cultiver ailleurs un terrain dont la jachère est finie. En somme, une situation qu’on pourrait à la
rigueur interpréter comme un allotissement périodique sur des champs permanents, mais que les indigènes eux-mêmes voient tout autrement.
Les Chinois du temps des Royaumes Combattants devaient être à peu près dans la même situation : les paysans quittaient sans doute les terres qu’ils avaient cultivées quelques années, lorsqu’elles
avaient besoin d’être mises en jachère, et passaient sur un autre lopin, sous la surveillance du village. Ces arrangements, qui, je crois, se perpétuèrent jusqu’au temps où des ordonnances
impériales vinrent essayer de réglementer la question, facilitaient l’usurpation des terres vacantes par les gens riches, qui les faisaient cultiver par leurs esclaves ou par des ouvriers à gages
: cette usurpation est dénoncée pendant des siècles par les lettrés comme une des causes de la misère des campagnes. Les lettrés semblent bien avoir vu là un thème à déclamation commode ; mais
ils n’ont pas inventé le fait lui-même.
Un document qui paraît dater de la fin des Tcheou, ou de l’époque des Ts’in, nous donne un tableau un peu systématisé et poussé au noir, mais tout de même relativement juste, de la situation du
paysan chinois vers le IVe siècle a. C. C’est un fragment d’un ouvrage philosophique perdu aujourd’hui, le Li-tseu, qu’on attribue au ministre d’une principauté du Nord de la Chine vers la fin du
Ve siècle a. C., mais qui est vraisemblablement l’œuvre d’un lettré du IIIe siècle.
« Quand le grain est trop cher, cela fait du tort au peuple (c’est-à-dire aux patriciens, aux artisans et aux marchands, dit le Commentaire) ;
quand il est trop bon marché, cela fait du tort aux paysans. Quand le peuple subit un préjudice, il se disperse ; quand les paysans subissent un préjudice, le pays s’appauvrit...
Aujourd’hui une famille de 5 personnes cultive 100 meou de terrain (environ 5 ha). Par an et par meou la récolte est de 1 ½ che (environ 20 litres à cette époque), ce
qui fait en tout 150 che (30 hl) de grain. Retirez l’impôt d’un dixième, soit 15 che : reste 135 che. Nourriture d’un homme par mois, 1 ½ che ; pour les 5
personnes (de la famille) et par an : (1,5 x 5 x 12) = 90 che. Reste 45 che. Si 1 che = 30 pièces de monnaie, cela fait 1.350 pièces. Retranchez les dépenses pour le
sacrifice au dieu du Sol, pour les sacrifices familiaux, pour les sacrifices des prémices du printemps et de l’automne, qui prennent 300 pièces : restent 1.050 pièces. Vêtements par personne :
300 pièces ; pour 5 personnes, par an : 1.500 pièces. (Donc) il manque 450 pièces (pour que le paysan puisse boucler son budget). Et pour les dépenses de maladies, d’enterrement, de deuil, etc.,
il n’y a pas de provision prévue là-dedans... Bonne récolte, moyenne récolte, mauvaise récolte, cela produit une petite famine, une moyenne famine, une grande famine... »
Ce n’est pas un document statistique, mais un discours sur la misère du peuple, et naturellement il ne faut pas prendre tout à la lettre. Mais
cependant le tableau ne doit pas être très loin de la réalité; le paysan chinois (le chiffre de 100 meou qui est le chiffre traditionnel du lot attribué aux paysans montre qu’il ne
s’agit pas d’un propriétaire foncier) doit avoir mené une vie misérable, et la famine ne devait jamais être très loin de sa porte, même pendant les meilleures périodes de prospérité et de
paix.
À côté des paysans qui cultivaient un lot de terres du village, il devait y avoir au temps des Royaumes Combattants de nombreux domaines ruraux. Il s’en constituait de nouveaux tous les jours :
le Chang-tseu, énumérant les titres et récompenses donnés pour des actions d’éclat militaires au Ts’in dans l’Ouest de la Chine, parle de domaines de 300 et 600 familles ; dans la
première moitié du IVe siècle, au Ts’i, dans l’Est de la Chine (Tche-li Sud-Est, et Chan-tong Nord-Ouest), le prince Houan faisait don de 300 hien (villages ?) au général de ses trois
armées, Chou-yi , et de 299 yi à Ming de T’ao ; vers la fin du IIIe siècle a. C., Hiu Hing, patricien du Tch’ou qui s’était installé dans la petite principauté de T’eng (au Nord du
Kiang-sou), s’était fait donner des terres par le prince de T’eng. Et, en dehors de ces donations pour hauts faits ou simplement dues à la faveur du souverain, il y avait la constitution
régulière et constante de petits domaines à titre d’« émoluments héréditaires » che-lou pour les officiers de l’État et les grands : c’est un petit domaine de ce genre que possédait à
l’époque de Mencius ce Tchong-tseu de Tch’en qui, par une sorte de retour à la nature, voulait que chaque propriétaire cultivant lui-même ses terres ne vécût que de ce qu’il produisait lui-même,
alors que dès cette époque la plupart (tous ceux du moins qui avaient une charge y étaient bien obligés) les faisaient cultiver par des esclaves ou les louaient à des fermiers.
L’époque des Han hérita de cette organisation de l’économie rurale sur un double plan : des propriétaires de domaines grands ou petits qui ne
cultivaient pas eux-mêmes, mais faisaient travailler des esclaves ou employaient des fermiers, et des paysans non propriétaires se répartissant périodiquement les terres des villages. C’est un
état qui se rapproche de celui du Tonkin actuel, sauf qu’au Tonkin les grandes propriétés, même morcelées, sont rares et que les deux classes de paysans, propriétaires et non propriétaires, ne
sont pas nettement délimitées, les petits propriétaires ayant droit à leur part dans les distributions de leurs communes, et étant ainsi propriétaires pour certains champs, et simples allotis
pour d’autres.
Ce que nous connaissons le moins mal à cette époque, ce sont les propriétaires fonciers. Les propriétés privées s’appelaient au temps des Han ming-t’ien (expression peu claire dont il a
été proposé plusieurs explications toutes insuffisantes), par opposition aux domaines, yi, qui étaient les fiefs des marquis, lie-heou, ou les apanages des princesses de la
famille impériale. La différence était que le maître d’une propriété, ming-t’ien, avait simplement la possession du sol, tandis que le seigneur d’un domaine, yi, avait un droit
sur les habitants du sol. Or, si la possession d’un domaine n’était accessible qu’en vertu d’un acte de l’empereur qui conférait un titre nobiliaire, la propriété simple était accessible à tous,
nobles et roturiers, fonctionnaires et personnes privées, et l’étendue n’en était limitée que par la fortune du maître. Une ordonnance impériale de 6 a. C., énumère les gens qui possèdent des
ming-t’ien : les rois (fils et descendants des empereurs ayant reçu une principauté vassale) et les marquis, lie-heou, dans leurs fiefs, les princesses (qui n’administrent pas
elles-mêmes leurs apanages), les marquis qui ont reçu un titre sans constitution de fief, qu’on appelle kouan-nei-heou (litt. marquis de l’intérieur des passes, i. e. du territoire de la
capitale, domaine propre de l’empereur où on n’érige pas de fief), les fonctionnaires, li, et les gens du peuple, min, c’est-à-dire les personnes privées. Les propriétaires
étaient certainement fort nombreux : toutes les grandes familles provinciales dont un membre arrive de temps en temps à quelque fonction de cour qui attire l’attention avaient leur fortune en
terres, car il n’y avait pas d’autres sources normales de richesse dans la Chine d’alors. La constitution de grandes fortunes par le commerce et l’industrie au temps de l’empereur Wou est une
exception inattendue, on le voit à la manière même dont les historiens en parlent, et d’ailleurs le fait ne se renouvelle plus par la suite.
Le commerce des propriétés privées, ming-t’ien, était libre : tout le monde avait le droit d’en acheter et d’en vendre ; le prix ne paraît pas en avoir été élevé : on affirme qu’au IIe
siècle a. C., les bonnes terres atteignaient 10.000 pièces de monnaie par meou (environ 5 ares) ; mais quand nous avons un fait précis, il montre des prix bien moindres : en 118 a. C., le Premier
ministre Li Ts’ai fut accusé d’avoir pris pour lui, au cours des travaux de l’achèvement de la tombe de l’empereur King, 300 meou qu’il revendit pour plus de 400.000 pièces de monnaie,
soit environ 1.400 pièces par meou.
Nous savons à peu près comment se faisaient les contrats, grâce aux découvertes récentes de contrats vrais ou fictifs pour l’achat de terrains devant servir à l’érection de tombes. Le vendeur est
ordinairement le dieu du Sol ou le couple Tong-wang-kong et Si-wang-mou, roi et reine des Immortels ; quelquefois cependant on trouve un nom de personne. Voici une tablette de jade qui est
peut-être un contrat réel :
« La 6e année kien-tch’ou, le 11e mois, le 16e jour marqué des signes yi-yeou (4 janvier 82 p. C.), Mi et Ying, fils de Wou Meng, achètent à Ma
Hi-yi et à Tchou Ta-ti le chao-k’ing un terrain pour une tombe, ayant au Sud 94 pas de large, à l’Ouest 68 pas de long, au Nord 65 pas de large, et à l’Est 79 pas de long, et faisant 23
meou et 64 pas (1,17 ha), au prix de 102.000 pièces de monnaie. À l’Est (ce terrain) est borné par les terres de Tch’en-sseu, au Nord, à l’Ouest et au Sud par celles de Tchou le
chao-k’ing. (Témoins) connaissant le contrat : Tchao Pou, Ho Fei. Pourboire à chacun (des témoins) : 2.000 pièces de monnaie.
Je donnerai encore la pièce suivante, plus courte et plus grossière, gravée sur métal ; il s’agit du tombeau d’un chef barbare de la Mandchourie
Méridionale, et elle est de date plus récente que les Han :
« Le 17e jour du 2e mois de la 7e année yuan-k’ang (27 mars 297), Kong-souen Che, originaire de Kien-che, a acheté un terrain de 100
meou au prix de 200.000 ligatures de monnaie. Il s’étend à l’Est depuis..., au Sud depuis..., au Nord...
Les familles riches ne se contentaient pas toujours des moyens légitimes pour agrandir leurs propriétés : si le chef de la famille recevait une
des hautes charges de cour, il arrivait que lui ou les siens en profitaient pour obliger les gens du pays à vendre à bas prix leurs propriétés. On cite quelques cas extrêmes, comme celui de
Tchang Yu dont la famille, au temps où il était le favori de l’empereur Tch’eng (32-2 a. C.), acquit ainsi 400 k’ing de terres (plus de 2.000 ha) dans les vallées des rivières Wei et King (au
Chen-si actuel). Et l’eunuque Heou Lan, au milieu du IIe siècle p. C., qui s’empara de 31 maisons et de 118 k’ing de champs, et se fit un palais et un parc splendides. Des faits
analogues devaient se produire en grand ou en petit, chaque fois que « les gens riches s’emparaient d’un canton ».
Dès le milieu du IIe siècle a. C., Tong Tchong-chou accusait les usurpations de terres par les grandes familles d’être la principale cause de la misère des paysans, et il préconisait comme remède
la limitation de l’étendue des propriétés privées. C’est à quoi on arriva en effet en 6 a. C. : personne, des rois aux simples particuliers, n’eut le droit de posséder plus de 30 k’ing
de ming-t’ien (environ 150 ha) sous peine de confiscation de l’excédent . La loi ne semble pas avoir été jamais sérieusement appliquée. La tentative de règlementation encore plus radicale de Wang
Mang en 9 p. C., qui limitait strictement l’étendue des propriétés privées à 100 meou pour une famille de 8 personnes, et interdisait la vente et l’achat des terres et des esclaves, ne
réussit pas mieux : la loi fut appliquée, mais elle causa des troubles tels qu’il fallut la rapporter au bout de trois ans et rendre la liberté au commerce des terres.
Même réduites à un maximum de 150 ha, les propriétés étaient trop grandes pour que le propriétaire pût les cultiver lui-même. Il les faisait travailler sous sa direction par des esclaves ou il
les louait à des fermiers, sortes de métayers qui partageaient par moitié avec lui le produit de la récolte. L’un et l’autre mode d’exploitation paraissent avoir été également fréquents, car si
le second est un thème normal de déclamation des lettrés, le premier a amené des mesures législatives : en 6 a. C., l’administration impériale essaya de le rendre impossible en règlementant le
nombre des esclaves suivant le rang des maîtres ; les simples particuliers ne purent en conserver plus de 30, nombre qui était peut-être large pour le service familial, mais était évidemment
insuffisant pour l’exploitation d’une grande propriété. La différence du mode d’exploitation devait tenir à la classe des propriétaires : les fonctionnaires, que leur charge forçait à être
toujours absents, devaient exploiter par des fermiers ; les particuliers, au contraire, devaient exploiter au moins partiellement au moyen d’esclaves qu’ils dirigeaient eux-mêmes.
Yang Yun, dont le père Yang Tch’ang avait été ministre de l’empereur Tchao (82-76 a. C.), et qui lui-même, après avoir été conseiller, avait été disgracié en 56 et s’était retiré dans ses terres,
décrit ainsi l’existence du grand propriétaire foncier :
« Quand le propriétaire, t’ien-kia, a fini son labeur, et que la saison ramène la canicule, ou à la fête de fin d’année, il cuit un
mouton, il rôtit un agneau, tire une mesure de vin, et ainsi se remet de sa fatigue. Je suis de Ts’in et je peux faire de la musique de Ts’in ; ma femme est de Tchao et joue très bien du luth ;
plusieurs de mes esclaves chantent. Quand, après le vin, j’ai chaud aux oreilles, la tête tournée vers le ciel je bats la mesure sur une cruche en criant wou ! wou ! J’agite ma robe et
je m’amuse ; je rejette mes manches en arrière en me baissant et en me relevant ; frappant du pied, je me mets à danser... J’ai la chance qu’(après ma disgrâce) il me reste de la fortune. »
À ces propriétaires, t’ien-kia, à qui leurs grandes propriétés et les redevances de leurs fermiers font la vie assez douce, s’opposent
les paysans, nong-jen, qui possèdent peu ou pas du tout de terres et dont la vie est fort dure, si nous en croyons un rapport au trône de Tch’ao Ts’o au milieu du IIe siècle a. C., dont
je donnerai un passage pour servir de comparaison avec le tableau de Yang Yun :
« Aujourd’hui, sur une famille de paysans, nong-jen, de 5 personnes, ceux qui sont pris par les corvées officielles ne sont pas moins de
deux. Ce que la famille est capable de cultiver ne dépasse pas 100 meou (5 ha) ; la récolte de 100 meou ne dépasse pas 100 che (20 hl). Au printemps ils labourent, en
été ils sarclent, en automne ils moissonnent, en hiver ils engrangent ; ils vont couper du bois de chauffage, ils servent les autorités, ils travaillent aux corvées. Au printemps ils ne peuvent
échapper au vent et à la poussière, en été ils ne peuvent échapper à la chaleur et au soleil, en automne ils ne peuvent échapper au mauvais temps et à la pluie, en hiver ils ne peuvent échapper
au froid et à la gelée ; tout le long des quatre saisons, ils n’ont pas un jour de repos. Sans parler de leurs affaires privées : ils accompagnent ceux qui partent et vont au-devant de ceux qui
viennent ; ils font des condoléances pour les morts, et prennent des nouvelles des malades ; ils nourrissent les orphelins et élèvent les enfants. Et quand ils ont peiné de la sorte, ils ont
encore à subir les calamités de l’inondation ou de la sécheresse, des injonctions du gouvernement trop pressé, les perceptions d’impôts hors de saison, les ordres du matin et les contre-ordres du
soir. Alors ceux qui ont quelque chose le vendent à demi-prix, ceux qui n’ont rien empruntent en s’engageant à rendre le double ; il y en a qui vendent leurs champs et leurs maisons, leurs
enfants et petits-enfants, pour payer leurs dettes.
Parmi ces paysans, il y en a qui ont quelques biens propres, champs et maisons ; il y en a qui n’ont pas de terre du tout ; d’où viennent à «
ceux qui n’ont rien » ces cent meou qu’ils cultivent? Ils ne sont pas leur propriété, puisqu’« ils n’ont rien ». Ce ne sont pas des terres affermées : s’ils avaient eu des fermages à
payer, Tch’ao Ts’o en aurait sûrement parlé : cette prise de la moitié de la récolte par le propriétaire aurait été un trop bon trait de la misère paysanne pour qu’il le laissât échapper. À mon
avis, ce sont des terres de leur village qui leur sont allouées temporairement pour les cultiver, comme cela se pratiquait au temps des Tsin et des Six Dynasties. Il est vrai que les textes des
Han ne parlent pas de distribution de terres aux paysans, et que par suite les érudits chinois et japonais qui se sont occupés de ces questions en nient l’existence pendant cette dynastie ; mais
leur manière de voir ne me paraît pas juste : tout ce qu’indique le silence des contemporains, c’est que la chose était si normale, si banale, si courante, si connue de tous, que les historiens
n’ont jamais pensé à la noter, comme ils auraient fait d’une circonstance rare ou inattendue. Entre les paysans de Tchao Ts’o « qui n’ont rien », et néanmoins ont 100 meou à cultiver, et
les envois de paysans de l’Est surpeuplé dans l’Ouest à demi désert que préconise Ts’ouei Che au milieu du IIe siècle p. C., nous avons déjà implicitement tout le cadre des règlements agraires
des siècles suivants : distribution de terres dans le village et encouragements à l’émigration pour ceux à qui leur village, étant « à l’étroit » dans son territoire trop petit, n’a rien à
allouer.
La situation de ces paysans devait être à peu près ce qu’elle est dans nombre de villages du Tonkin, où les terres communales sont distribuées aux inscrits adultes pour une période de deux à cinq
ans, suivant les villages et les terres, et au bout de ce temps sont rendues au village qui les laisse reposer un an ou deux avant de les redistribuer. Naturellement le roulement des jachères et
des mises en culture est établi de façon à laisser à tous les ayants droit une quantité approximativement égale à chaque distribution . L’administration surveille, sans s’ingérer dans les
répartitions, qu’elle laisse faire aux notables des villages.
Inscrits au rôle des paysans, rôle différent à la fois de celui des fonctionnaires qui ne paient pas certains impôts et ne sont pas soumis aux corvées, et de celui des commerçants qui paient une
taxe spéciale, ces paysans de l’époque des Han devaient se voir allouer temporairement des champs de leur village, ce qui leur donnait au plus de quoi assurer péniblement leur existence et celle
de leur famille ; si le village n’avait pas assez de terre pour tous les paysans, il leur restait la ressource de se louer comme ouvriers agricoles des grands propriétaires : c’est ce que dut
faire d’abord, faute d’autres moyens d’existence, le célèbre lettré Tcheng Hiuan, lorsqu’il eut achevé ses études. Ou encore, celle d’émigrer de leur « village à l’étroit » dans un « village au
large ». Ceux qui recevaient un lot n’en étaient pas propriétaires, mais en avaient seulement la jouissance pour un temps fixé. C’est sans doute pendant les quatre siècles de la dynastie des Han
que l’on passa du régime des allotissements pour une courte période entre deux jachères, que j’ai décrit plus haut, à celui des allotissements viagers de la période qui suit. Le passage d’un
régime à l’autre fut, je pense, facilité par les progrès techniques réalisés à cette époque par l’agriculture. Le plus considérable, et qui eut les répercussions les plus lointaines, fut ce que
les contemporains appelèrent « les champs d’alternance », tai-t’ien, qu’un certain Tchao Kouo réussit à faire accepter dans la première moitié du Ier siècle a. C.
L’unité de mesure de superficie chinoise, le meou, était une longue bande de 240 pas de long sur 1 pas de large (environ 345 m sur 1,45 m : à peu près 5 ares), dans toute la longueur de
laquelle le paysan traçait avec sa charrue trois sillons, kiuan, parallèles. Les Chinois avaient toujours fait, comme tout le monde, l’assolement par parcelles entières. Tchao Kouo eut
l’idée de le faire faire par sillon : chaque année le paysan déplaçait ses sillons par rapport à l’année précédente, c’est-à-dire que, chaque sillon étant un creux, kiuan, large et
profond de 1 pied, à côté duquel il relevait la terre en une butte, long, également large et haute de 1 pied (il y avait 3 creux et 3 buttes par meou), il faisait chaque année le sillon
où l’année précédente il avait fait la butte. Tchao Kouo demandait d’autre part un travail plus soigné du sol, en particulier un sarclage suivi d’un buttage des jeunes plants dès leur apparition,
auquel il attachait une grande importance. Ce procédé de culture fut essayé officiellement avec la main-d’œuvre militaire dans les terres dépendant des palais ordinairement inhabités : la récolte
fut double de celles des terres voisines, paraît-il (2 che par meou au lieu de 1 che) ; et, à la suite de ce succès, il fut donné ordre de mettre le procédé
immédiatement en pratique et de l’enseigner partout. Je ne suis pas en état de me rendre compte si le procédé réalisait vraiment un progrès technique, et si l’assolement ainsi effectué n’était
pas plus illusoire que réel ; en tout cas, la pratique n’en dura guère, car les manuels d’agriculture du VIe siècle en parlent uniquement d’après le Ts’ien-Han chou, et n’ont pas l’air
de l’avoir vu en usage. Mais l’extension, même temporaire, du « champ d’alternance », que l’administration impériale poursuivait avec succès à l’époque, au moins dans tout le Nord de la Chine,
dut aider à prolonger la période de tenure temporaire des paysans, puisque la suppression des jachères en supprimait la fin naturelle. On dut ainsi s’acheminer tout doucement vers le régime des
concessions viagères des Six Dynasties.
Autant qu’on peut voir (mais il faut reconnaître qu’on voit mal), les milieux ruraux du temps des Han étaient constitués en haut par un petit nombre de grands propriétaires riches, pour la
plupart fonctionnaires ou descendants de fonctionnaires, et au dessous par un véritable prolétariat de paysans, sans terres ou petits propriétaires, dont les plus heureux cultivaient des lots de
terres des villages, tandis que les autres émigraient (l’époque des Han est une époque de colonisation intense de la Chine méridionale encore presque déserte), se faisaient soldats ou pirates, se
louaient comme ouvriers agricoles ou affermaient les terres des grands propriétaires, suivant leurs caractères et leurs capacités, sans jamais, que par exception, réussir à sortir définitivement
de la misère. Vivant trop au jour le jour pour se constituer une réserve, et par suite toujours à la merci des augmentations des charges (moins par l’impôt que par la corvée et le service
militaire), toujours endettés, ils font argent de tout. L’histoire du « fils pieux » qui se vend comme esclave pour payer le cercueil de son père n’est que la transposition en récit édifiant d’un
fait de tous les jours ; c’est parmi les enfants des paysans que les eunuques du harem impérial se recrutent.
La situation des campagnes chinoises était très différente de celle du monde romain. Il n’y avait pas alors de grandes villes en Chine, en dehors des deux capitales impériales et de deux ou trois
capitales d’anciennes grandes principautés féodales : ce que nous appelons villes n’étaient que de petites citadelles où vivaient les fonctionnaires, la garnison et les quelques commerçants dont
ils avaient besoin ; ce n’est qu’au cours de la dynastie T’ang (VIIe-Xe siècles) que ces petites citadelles de quelques centaines de pieds de tour deviendront trop petites, et que, assez
soudainement, de grandes villes surgiront un peu partout. Toute la population vit à la campagne ; mais le territoire est si vaste que la densité de la population reste faible. Et de plus, au
milieu de l’immensité des terres incultes, les terres cultivées sont peu étendues. La mise en culture de terres nouvelles exigeait des travaux (drainage ou, au contraire, irrigation) dont les
frais ne pouvaient que décourager toute tentative ; les travaux auraient d’ailleurs presque toujours été de trop d’étendue pour être à la portée des particuliers : l’État seul pouvait les
entreprendre, et le fit en effet de temps en temps. Ainsi, dans une pléthore de terres cultivables, les terres en culture sont insuffisantes pour les besoins de la population : de là vient que
l’idée de « limiter les propriétés », hien-t’ien, apparut au gouvernement chinois comme le grand remède.
Mais la difficulté s’accroissait de ce que l’étendue du mal variait suivant les localités. Le problème des « villages à l’étroit » est déjà posé au milieu du IIe siècle p. C. par Ts’ouei Che dans
son Tcheng-louen : d’après lui, les territoires du Nord et de l’Est sont trop étroits pour leur population, ceux de l’Ouest trop larges. Même dans les régions « au large », sauf dans les
territoires de colonisation du Sud, il y a trop de bras pour les terres. Or, il n’y a aucun débouché pour le prolétariat rural en dehors de la culture elle-même : le commerce et l’industrie
avaient commencé à se développer au début des Han, mais l’administration y avait mis le holà. Les lettrés, imbus d’idées qui rappellent celles des Physiocrates, regardaient comme des parasites
tous ceux qui (en-dehors d’eux-mêmes) ne produisaient pas directement des denrées alimentaires, et, tout le long de l’histoire de Chine, ils ont poursuivi les commerçants et les industriels d’une
haine d’autant plus tenace qu’ils craignaient la formation d’une classe riche rivale ; tout développement du commerce et de l’industrie fut toujours combattu par eux, en sorte que les débouchés
que les paysans auraient pu trouver de ce côté ne furent jamais bien larges. Aussi la main-d’œuvre paysanne a-t-elle toujours été surabondante, et les propriétaires fonciers n’ont-ils jamais eu
besoin d’attacher à leur exploitation les gens qu’ils employaient, comme cela s’est produit en Occident.
C’est à l’époque des Tsin, à la fin du IIIe siècle de notre ère, que nous trouvons le premier règlement agraire. Il semble que, l’accroissement
de la population rendant de plus en plus difficile le partage des terres, le pouvoir central fut amené à s’en occuper, alors qu’il l’avait laissé entièrement aux paysans pendant les siècles
précédents. À partir de cette époque, les règlements de cette espèce se renouvellent de siècle en siècle et de dynastie en dynastie, sans grand changement d’ailleurs.
La base du système est, comme dans l’antiquité, une circonscription administrative, le canton hiang, avec son territoire délimité : c’est à l’intérieur du canton que les terres étaient réparties
entre les familles des paysans, suivant des règles qui changent suivant les époques. Les règlements commencent par désigner ceux qui ont droit à une part entière et ceux qui sont exclus de la
répartition ou n’ont droit qu’à une part moindre : tous les hommes adultes ont droit à une part entière, les enfants et les vieillards n’y ont pas droit, et entre ces deux catégories, les jeunes
gens et les gens âgés, entre des limites arbitraires et qui varient constamment, n’ont droit qu’à une part réduite ; à certaines époques, les chefs de famille ont droit aussi à une part réduite
pour chaque esclave et pour chaque bœuf en leur possession. La répartition se faisait tous les ans, au 1er mois d’abord, puis au 10e mois. Mais elle ne portait pas sur la totalité des terres : au
Ve siècle, il est certain que les lots étaient attribués une fois pour toutes à vie au paysan quand il atteignait l’âge légal ; à sa mort ou quand il atteignait l’âge des vieillards, son lot
retournait à la communauté et était attribué de nouveau ; il n’y avait ainsi qu’un petit nombre de lots à attribuer chaque année. Il en était probablement déjà de même au temps des Tsin.
Les règlements qui se succèdent pendant les quatre siècles qui vont des Tsin aux T’ang, ne diffèrent guère que par des détails. J’y insisterai d’autant moins qu’une partie de leurs dispositions
est toute théorique et n’a jamais pu être appliquée réellement. Le chiffre légal de la superficie des lots n’a aucune valeur pour le VIe et le VIIe siècle ; c’est simplement la reproduction du
chiffre rituel de 100 meou par adulte donné par les Classiques, et que nous avons déjà rencontré chez les écrivains de l’époque des Han : 80 meou de champs et 20 meou
de terres à mûriers, sous les Ts’i Septentrionaux (milieu du VIe siècle), les Souei et les T’ang (VIIe siècle), et 100 meou sans distinction d’espèce de terre, sous les Tcheou (fin du
VIe siècle). Peut-être, au contraire, les chiffres des Wei Septentrionaux, qui s’écartent du chiffre rituel (40 meou de champs et 20 meou de mûriers = 60), reposent-ils sur des
faits réels ; mais il est bien difficile d’admettre qu’on ait réellement distribué des superficies égales sur toute la surface d’un pays aussi vaste que la Chine, où les cultures sont si variées,
et où la population est (et surtout était alors) aussi diversement répartie. Ce dernier fait avait d’ailleurs attiré l’attention du législateur. Certains cantons avaient trop peu de terres,
d’autres en avaient trop ; dans les « villages à l’étroit », s’il n’y avait pas assez de terres à partager, on ne donnait pas les 20 meou de terres à mûriers aux nouveaux inscrits ; si
cette première restriction ne suffisait pas, on diminuait la part des adultes appartenant à la même famille. Au temps des Souei, la part d’adulte peut descendre jusqu’à 20 meou seulement
en certains lieux.
Le problème se posait d’ailleurs pour les dynasties du Nord (Wei, Ts’i, Tcheou) de façon tout autre que pour les Han et les Tsin ou encore, après eux, les Souei et les T’ang. Ces dernières
dynasties possédaient la Chine entière, avec les vastes territoires peu peuplés du Sud ; les dynasties locales du Nord ne possédaient que le Bassin du fleuve Jaune, c’est-à-dire la région où la
population était le plus dense. À l’époque des Six Dynasties, nous n’entendons pas parler de règlements agraires dans les empires des Song, des Leang ou des Tch’en : c’est que, là, les « villages
à l’étroit », s’il y en avait, étaient peu nombreux. Le problème, pour les gouvernements de la Chine du Nord, était moins de faire cultiver une superficie donnée que d’employer le plus grand
nombre de personnes possible à cette culture. C’est pourquoi le principe de « limitation des propriétés » du temps des Han devint, au temps des Wei, « l’égalisation des propriétés »,
kiun-t’ien : les grandes propriétés sont condamnées parce que, pour une étendue égale, elles demandent beaucoup moins de monde que les petites concessions en usufruit aux paysans. La
solution aurait été dans la mise en valeur des terres cultivables mais laissées en friche ; les gouvernants chinois l’ont tentée par accès, sans beaucoup de suite et sans grand succès : ils
manquaient d’ailleurs de moyens pour y réussir. Le malheur de la Chine a été que, pendant dix siècles, les gouvernements successifs ont mis tous leurs efforts à entraver la constitution de la
grande propriété privée, alors que celle-ci était seule capable d’étendre, dans certaines conditions, l’étendue des terres cultivées, et, en tout cas, de donner le rendement le plus complet aux
extensions que faisaient les grands travaux d’irrigation ou de drainage du gouvernement ; et, de ce fait, elle le fit dès qu’elle exista presque librement, à partir de la fin des T’ang, et c’est
à partir de cette époque que commença le constant accroissement des terres cultivées qui a amené l’état présent, où les terres cultivables non cultivées ne sont plus que l’exception.
À l’époque des T’ang, quand le système des petites concessions paysannes était à la veille de disparaître, tout paysan, en arrivant à l’âge d’homme, recevait une concession viagère de champs à
titre de « part de distribution », k’eou-fen ; il recevait, de plus, une petite «propriété héréditaire», che-ye, ou « propriété à perpétuité », yong-ye, de terres
plantées en mûriers, jujubiers, etc. Dans les villages « au large », la concession était de 80 meou (environ 6 ha), et la propriété de 20 meou (1 ½ ha) ; dans les villages « à
l’étroit », part et propriété étaient réduites au point de n’atteindre, à l’extrême, que la moitié de ces chiffres. Sur ces terres, l’État percevait un impôt assez faible : chaque famille,
hou, ayant droit à une part payait 5 che de grains pour sa part, plus une certaine quantité de soie, de toile, etc. ; les parts étant théoriquement égales, la fixation par
famille évitait à l’administration d’avoir à s’occuper du cadastre. Il y avait de plus un impôt personnel en monnaie. Puis des corvées : 30 jours par an et par homme adulte, ting. Enfin,
le service militaire, un mois par an. Tout cela n’était pas très élevé en temps ordinaire, si la récolte n’était pas mauvaise ; mais, si plusieurs mauvaises années se succédaient, le paysan avait
peine à se libérer de toutes ces obligations.
Quand le titulaire mourait ou atteignait un âge qui a souvent varié autour de 60 ans, la concession revenait au village pour être distribuée à nouveau ; la propriété passait à son fils. Sous
quelque forme qu’il la tînt, « part de distribution » ou « propriété héréditaire », la terre était également inaliénable, et il n’avait jamais le droit de la vendre ; l’acheteur était puni de 10
coups de bâton par meou, et les terres revenaient au possesseur primitif ; le prix était perdu et n’était pas remboursé. Cette loi n’admettait de dérogation que dans des cas exceptionnels : la
propriété héréditaire pouvait être vendue en tout ou en partie par le paysan trop pauvre pour payer les frais d’enterrement ; et ceux qui possédaient plus que les 20 meou réglementaires
(on n’explique pas comment quelqu’un peut se trouver dans cette situation : ce ne peut être que par héritage, puisque l’achat serait illégal) pouvaient vendre le surplus à ceux dont la propriété
était inférieure au chiffre réglementaire. La part de distribution pouvait être vendue, à la date fixée annuellement pour les distributions, par le paysan décidé à émigrer ; après cette vente, il
n’avait plus le droit de se faire donner une part de distribution dans son village d’origine.
Les chefs de famille, hou-tchou, devaient, tous les ans, au dixième mois, fournir une déclaration de tous les membres de la famille (noms, sexe et âge), avec l’indication de la quantité
de terres à recevoir et effectivement reçues ; d’après cette liste, les administrateurs de village, li-tcheng, dressaient une liste, ki-tchang, pour le village entier (c’est
d’après cette liste qu’on faisait tous les trois ans le recensement) ; quand il y avait des terres à distribuer dans un village, l’administrateur, après enquête, envoyait sa liste au sous-préfet,
et celui-ci réunissait ceux qui rendaient leurs terres (pour raison d’âge), et ceux qui devaient en recevoir, et il faisait la distribution en leur présence. On peut se rendre compte de la
manière dont fonctionnait ce système d’après des fragments de recensement et de listes de villages trouvés à Touen-houang. Voici un fragment se rapportant à une famille, dans une de ces listes
pour l’année 769.
« Chef de famille, hou-tchou, Tchao Ta-pen, âge : 71 ans, vieillard de sexe masculin. Famille du troisième degré inférieur, hia-hia
hou.
Épouse, Meng, âge : 69 ans, épouse du vieillard.
Fille, Kouang-ming, âge : 20 ans, adolescent de sexe féminin.
Fils, Ming-ho, âge : 36 ans, pie-tsiang à Houang-ming fou, département de Houei.
Fils, Min-fong, âge : 26 ans, adulte gradé. (Au précédent recensement, il avait vingt... ans ; après le recensement de la deuxième année ta-li (767), ajouté comme non gradé d’après la
liste familiale.)
Fils, Sseu-tsou, âge : 27 ans, adulte non gradé.
Fils, Yen-yu, âge : 24 ans, adolescent de sexe masculin (ajouté après le recensement de 762).
Ensemble, doivent recevoir 453 meou de champs :
90 meou déjà reçus (de champs).
19 meou de propriété perpétuelle yong-ye.
1 meou d’habitation et jardin.
363 meou non reçus.
En effet le père, « vieillard », n’a plus droit qu’à une demi-part, soit 50 meou ; les trois fils adultes, ting, ont droit
chacun à 100 meou (7 ¾ ha), de même que le fils adolescent, tchong, et, pour sept personnes, la famille a droit à 3 meou pour l’habitation et le jardin : cela fait donc
bien 453 meou (35 ha) à recevoir ; les 20 meou (1 ½ ha) de propriété perpétuelle ne sont pas compris dans le total. Le canton est « à l’étroit » puisque la famille n’a pu
recevoir que 90 meou (7 ha), le cinquième de ce à quoi elle a droit.
*
Complément
L'organisation d'un domaine foncier en Chine au temps des Tcheou occidentaux.
In : Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 80e année, N. 1, 1936, pp. 80-82.
http:www.persee.frdoccrai0065-05361936num80176716
Un petit nombre d'inscriptions chinoises, difficiles à dater exactement, mais qu'on peut placer approximativement au VIIIe siècle avant notre
ère, permettent de reconnaître en quoi consistaient et comment étaient organisés les domaines fonciers de cette époque ; ce sont des inscriptions gravées sur des vases en bronze destinés au cuite
ancestral, où le chef de famille annonce à ses ancêtres des faits considérés comme importants dans l'histoire familiale.
Les domaines étaient appelés yi ou tien, le premier mot désignant semble-t-il l'agglomération paysanne, le village d'où les habitants sortent pour aller cultiver les champs et
le second les terres elles-mêmes, la surface délimitée. Leur étendue est variable : le Yi king, vers le VIIIe ou le VIIe siècle, parle de domaines de 300 familles. Ils étaient créés par
la donation que le roi faisait de certaines terres à ces officiers. À cette époque en effet, le pays était pauvre, l'industrie inexistante, le commerce peu développé ; les métaux précieux, or et
argent, étaient rares, et le bronze seul était d'usage courant (le travail du fer était encore inconnu) ; toute richesse était en terres : la terre était le seul moyen d'assurer l'existence d'une
famille. C'est pourquoi le roi et les princes en donnaient des parcelles à ceux à qui ils conféraient une charge : elle était remise à titre héréditaire, et les domaines ainsi donnés étaient ce
que Mencius appelle l'« émolument héréditaire » che-lou. Le domaine donné était délimité exactement : l'inscription du plateau de la famille San commence par la délimitation du domaine
de San, indiquant les points caractéristiques, rivières à franchir, localités à passer, avec l'indication précise des endroits où on a élevé les tertres en terre fong qui servent de
bornes. Le roi et son successeur conservaient le droit de reprendre le domaine donné : l'inscription du trépied de Ta est précisément le récit d'une affaire de ce genre. Mais le
propriétaire avait le droit d'aliéner son domaine, en tout ou partie : nous voyons offrir et donner des terres pour paiement d'une amende, d'une indemnité, etc.
Un grand seigneur ne pouvait régir ses terres lui-même : il était retenu à la cour ou, en général au service du roi ou du prince, pour la charge qui lui avait été conférée et dont le domaine
n'était que les « émoluments ». Il le faisait administrer par un intendant tsai souvent héréditaire qu'il désignait lui-même parmi ses parents ou ses clients :
« Maître Houei, dit l'inscription du touei de Maître Houei, votre grand-père et votre père se sont donné de la peine sur mon domaine
familial ; vous, assistez-moi, qui ne suis qu'un petit enfant ! Je vous donne charge de régir mes biens familiaux, mon côté Ouest, mon côté Est, mes cochers, mes palefreniers, mes artisans, mes
pasteurs, mes serviteurs et mes servantes, de régler le dedans et le dehors ; n'osez pas ne pas être excellent !... Soyez diligent, appliquez-vous aux affaires du matin au soir !
L'intendant avait, on le voit, l'administration du domaine avec tout son personnel.
Le personnel habitant le domaine se composait d'abord des paysans qui le cultivaient : ils ne sont pas mentionnés séparément dans l'inscription ci-dessus parce qu'ils vont avec la terre qu'ils
cultivent ; ils sont compris dans les expressions qui se rapportent à celle-ci : « mon côté Ouest et mon côté Est ». Ils sont les « vilains », littéralement les « gens du commun »
tchong-jen (Che king), ou simplement tchong (inscription du Trépied de Hou). Ils travaillent aux champs sous les ordres des officiers du domaine ; à cette époque la
culture est encore rudimentaire ; les champs permanents sont rares et les paysans cultivent surtout par défrichement, en brûlant un coin de brousse qui donne des récoltes trois ou quatre ans et
ensuite abandonné. À côté des paysans il y a les artisans, gens de métier, et enfin les esclaves, qui font les travaux que ne peuvent faire les artisans, et au besoin cultivent pour le seigneur
du domaine.
Le seigneur est responsable de tous ceux qui habitent le domaine : s'ils commettent un délit, c'est contre lui qu'il est porté plainte, c'est lui que le juge poursuit. On le voit bien par
l'inscription du Trépied de Hou, où celui-ci raconte comment il s'est fait dédommager d'un vol de grains commis par les paysans et les esclaves du domaine de K'ouang.
Telle était, autant qu'on peut le voir, l'organisation d'un domaine foncier en Chine vers le VIIIe siècle avant notre ère.

















