Ferdinand Brunetière (1849-1906)
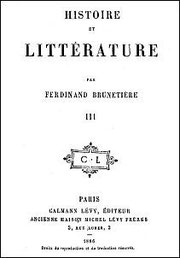
À PROPOS DU THÉÂTRE CHINOIS
Extrait de Histoire et littérature, tome 3, pages 1-25. Calmann Levy, Paris, 1886.
- "Entre notre théâtre et le théâtre chinois la seule différence réelle que je trouve, — sans parler, on l’entend bien, de celles que des institutions, des mœurs, des coutumes différentes y mettent, et qui ne sont rien d’essentiel, — c’est la différence du balbutiement de l’enfant à la parole de l’homme fait.
- Le théâtre chinois est l’œuvre d’une civilisation évidemment très ancienne, et, comme telle, très avancée à beaucoup d’égards ; mais en beaucoup de points aussi demeurée dans l’enfance, ou, si l’on aime mieux, immobilisée dans des formes rigides dont elle n’a pu réussir, de nos jours même, à se débarrasser.
- Les Chinois ressemblent à des enfants très intelligents et très vieux. Voilà longtemps qu’ils ont atteint un point de civilisation matérielle et morale où nous ne faisons que de toucher à peine, si même nous y sommes ; seulement, ils s’y sont arrêtés, et, tant qu’ils continueront de vivre sur eux-mêmes, ils y resteront, ayant dépensé pour y parvenir tout ce qu’ils avaient effectivement en eux. C’est du moins ce que l’on peut conclure de l’histoire de leur théâtre."

Si quelque lecteur était par hasard curieux de renseignements neufs et précis sur le théâtre
chinois, — et il pourrait l’être assurément de plus d’une chinoiserie moins intéressante et moins utile, — je dois l’avertir d’abord qu’il en trouvera peu dans le livre que vient de publier sous ce titre le général Tcheng-ki-tong. Très Parisien, beaucoup plus Parisien qu’on ne l’est d’ordinaire à Paris, presque
aussi Parisien que M. Albert Wolff, lequel est, je crois, de Cologne ou de Bonn, le général Tcheng-ki-tong se montre en effet moins Chinois que jamais dans ce petit volume ; et l’on peut bien
dire, si l’on veut, qu’il y passe à tout coup les promesses de son titre, mais en revanche qu’il a tout à fait oublié de commencer par les y tenir. Un bel éloge de la « défiance », bien sincère,
éloquent même à force de sincérité, très significatif en tout cas, voilà peut-être qu’il y a de plus chinois dans ce livre d’un Chinois sur le théâtre chinois. Le reste, — nous le connaissions
depuis déjà longtemps, ou du moins, et pour mieux dire, nous devrions le connaître, si c’était en effet pour nous que nos missionnaires et nos sinologues eussent écrit : les Amyot, les Prémare,
les du Halde autrefois, et dans notre siècle les Pauthier, les Bazin, les Stanislas Julien et les Abel Rémusat.
L’occasion était cependant belle et le sujet bien choisi. Du plus vaste empire qui soit au monde et du plus ancien, de la civilisation la plus originale, et la seule qui se soit uniquement
développée d’elle-même sur son fonds, sans avoir jamais subi d’autre influence que celle de l’accumulation de ses propres traditions, enfin, de trois cent cinquante ou quatre cent millions de nos
semblables, nous ne savons guère que ce que nous en ont appris les récits de voyages. Mais que veut-on qu’un voyageur, un passant puisse vraiment nous apprendre de la Chine et des Chinois? Si les
mœurs d’une de nos provinces, la Bretagne ou l’Anjou, ses coutumes, ses usages diffèrent, et diffèrent beaucoup des usages, des coutumes, des mœurs de la Flandre ou de la Provence, qu’en
sera-t-il, qu’en doit-il être, sur un territoire six ou huit fois plus étendu que celui de la France, d’un peuple dix fois plus nombreux ? Je sais de fort honnêtes gens qui, pour avoir passé
quelques jours à Pékin ou quelques semaines à Canton, n’en ont pas moins sur les institutions et les mœurs de l'Empire du Milieu l’opinion la plus décisive. Mais de quelle confiance dira-t-on
qu’ils soient dignes ? Le général Tcheng-ki-tong lui-même ne connaît peut-être qu’un coin de sa propre patrie. Et, à vrai dire, une vie d’homme ne suffirait pas pour explorer la Chine ; étrangers
ou nationaux, les voyageurs ne peuvent guère nous y servir que d’introducteurs ; et, pour pénétrer un peu avant dans la familiarité d’un grand peuple, il nous faut d’autres intermédiaires.
La littérature en est justement un, le plus sûr et le plus naturel, dont nous ne saurions trop regretter que le général Tcheng-ki-tong se soit si mal servi ; — car qui s’en servira si ce n’est un
Chinois ? Son premier livre : Les Chinois peints par eux-mêmes, était plaisant, mais instructif, celui-ci
n’est que plaisant ; et franchement, quand on s’aperçoit que l’auteur n’y parle pas d’une seule pièce que n’eussent traduite ou ana- lysée les sinologues européens, on se demande si peut-être, à
mesure qu’il se perfectionnait dans les finesses de notre langue et même dans l’argot du boulevard, ce spirituel général n’aurait pas désappris le chinois ?
Il serait pourtant à souhaiter, et, indépendamment de toute autre considération, dans le seul intérêt de la science, ou plutôt de l’histoire, que l’on étudiât de près cette volumineuse et
curieuse littérature chinoise. Ni les poètes, ni les romanciers, ni les auteurs dramatiques n’y manquent ; et ce que l’on en a traduit, qui formerait déjà toute une petite bibliothèque, ne
saurait qu’inspirer le désir d’en connaître davantage. Aucune littérature, je le disais, ne s’est développée plus excentriquement aux nôtres, n’a moins reçu de nous, ne nous a moins donné ;
cependant aucune littérature n’offre avec les nôtres de plus frappantes ressemblances, et un Allemand, un Anglais, un Français s’y retrouvent comme chez eux. Parcourez seulement quelques-unes de
ces Poésies de l'époque des Thang que nous donnait, il y a quelque vingt ans, M. d’Hervey de Saint-Denis :
celles de Li-taï-pé, par exemple, ou de Thou-fou. Je n’oserais affirmer que le génie chinois s’y montre absolument incapable d’idéal, mais ce qui n’est pas douteux c’est qu’il y rase volontiers
le sol. Rien ici d’extraordinaire ou même de très particulier, comme on serait tenté d’abord de se le figurer ; rien d’étrange ni de bizarre, point de monstres ni seulement de magots ; mais
l’inspiration la plus familière, peu d’images, toujours très simples, tirées des usages de la vie quotidienne, à peine indiquées, jamais poussées, plus de grâce enfin que de force, nulle
métaphore ambitieuse, des chansons plutôt que des odes ; — et beaucoup de chansons à boire. A la fin du siècle dernier, c’est une juste remarque de M. Emile Montégut, Li-taï-pé eût très bien pu
s’appeler Robert Burns, et rien n’eût empêché Thou-fou de chanter le Dieu des bonnes gens :
Vins qu’il nous donne, amitié tutélaire,
Et vous, amours, qui créez après lui,
Prêtez un charme à ma philosophie
Pour dissiper des rêves affligeants.
Le verre en main, que chacun se confie
Au dieu des bonnes gens.

Les Chinois boivent dans des tasses, et leur vin n’est pas, comme le nôtre, autrefois :
le jus de la treille ; on raconte aussi qu’ils se nomment Thou-fou plus souvent que Dupont ou Durand ; mais, à cela près, leur Dieu n’est pas plus gênant que celui de nos bons
chansonniers, sa morale plus exigeante, ni leur chanson enfin d’un ton beaucoup plus élevé.
Même observation à faire sur leurs romans : les Deux Cousines, les Deux Jeunes Filles lettrées, la Femme accomplie ; — je ne parle ici que de ceux
qui sont à la portée du lecteur français, — les Contes et Nouvelles jadis traduits par M. Théodore Pavie ou
les Pruniers Merveilleux, plus récemment mis en français, par M. Théophile Piry. L’Inde et la Perse ont
leurs épopées, le Ramâyana ou le Shah Nameh, des poèmes, des légendes, leurs apologues et leurs fables ; les Arabes ont leur Mille et une nuits ; la Chine seule en
Orient a des romans, de vrais romans, des romans de mœurs, comme les nôtres, et même des romans naturalistes.
« L’École de la littérature légère et des romans, dit quelque part un critique chinois, tire son origine du bureau des employés les plus infimes... Les conversations des rues, les
entretiens des carrefours, les conversations que l’on entend dans les bouges, tels sont les sujets des compositions des écrivains de cette École. »
Voilà une école proprement arrangée. Je signale ce critique, ou plutôt cet historien, à la juste colère de M. Zola : il s’appelait Pan-kou, et vivait au Ier siècle de notre ère.
Ceux des romans chinois que nous avons pu lire ne méritent pourtant pas cet excès de sévérité. Il y est ordinairement question de s’établir en mariage, et pour cela de réussir dans ses examens,
ce qui ne me paraît pas autrement immoral, ni d’ailleurs plus chinois que français. La critique la plus générale et la plus vraie que l'on en puisse faire, c’est qu’il ne s’y passe pas
grand’chose, que les détails y sont bien futiles et les conversations bien prolixes, que les héros n’en ont rien que de médiocre ou de vulgaire. Mais sont-ce les seuls romans dont on puisse le
dire ? Je n’y vois décidément, en y regardant bien, qu’un ou deux traits vraiment locaux, comme par exemple l’admiration des personnages constitués en dignité pour les jeunes gens qui manient
agréablement le ouen-tchang ou le ché-ouen. Le ouen-tchang, c’est la prose élégante, la prose académique ; « chaque mot y brille comme une perle fine » ; et quant au
ché-ouen, on ne saurait rien imaginer de plus beau, dit un savant jésuite, ni même de plus vide : pulchrius ac inanius. Ce sont des sons, dit encore ce bon homme, qui caressent
voluptueusement l’oreille, ce sont des fleurs uniquement assorties pour le plaisir des yeux... Plusieurs de nos contemporains ont écrit très bien en ché-ouen, les Paul de Saint-Victor,
entre autres, et les Théophile Gautier. Mais tout en rendant au ouen-tchang et au ché-ouen les hommages qui leur sont dus, les romanciers chinois, pour leur usage, ont préféré
le kouan-hoa, comme plus propre à prendre tous les tons, et ainsi plus convenable à la familiarité du genre.
Ce qui est vrai du roman chinois l’est enfin du théâtre. Mais c’est peut-être ici surtout que le manque de renseignements se fait sentir, et c’est pourquoi j’en veux beaucoup au général
Tcheng-ki-tong, ayant eu l’air de nous les promettre, de ne nous en avoir guère donné.
« Le caractère sérieux et austère des anciens sages de la Chine, dit à ce propos un savant missionnaire, ne pouvait accepter le délassement du théâtre... et la première fois qu’il est question du
théâtre dans l'histoire chinoise, c’est pour louer un empereur de la dynastie des Chang d’avoir proscrit ce vain plaisir. »
Mais on a fort disputé sur ce texte, et, — rapprochement assez curieux, — la controverse est la même qui s’est élevée chez nous sur les textes des pères de l’Église chrétienne : à savoir, s’il
est ici question de comédiens ou d’histrions, du théâtre proprement dit ou de la danse, de la pantomime et autres divertissements toujours et partout, on le voit, un peu mêlés d’obscénité.
Quoi qu’il en soit, ce que l’on admet communément, c’est que l’art dramatique ne prit qu’assez tard en Chine une forme régulière, et seulement aux environs du VIIIe ou IXe siècle de notre ère,
sous la dynastie des Thang. Il ne nous est malheureusement rien parvenu de ces premiers essais ; et, pour trouver non seulement de vraies pièces, mais des pièces tout simplement, des
commencements de pièces, il faut descendre jusqu’aux dynasties des Kin et des Youen, c’est-à-dire jusqu’au milieu de notre XIIe siècle. Les véritables monuments de l’art dramatique, en Chine, se
trouvent donc être ainsi contemporains du règne de Philippe-Auguste. Lorsque M. Bazin, jadis, et M. Paul Perny nous le disaient, on pouvait craindre qu’ils ne fussent mal ou incomplètement
informés : le général Tcheng-ki-tong, n’en disant pas, et sans doute n’en sachant pas plus qu’eux, nous sera garant désormais de la valeur de leurs renseignements. Et, à défaut d’autre utilité,
son petit volume aura celle de venger nos sinologues de tant de sottes plaisanteries qui pourraient bien les avoir empêchés de continuer leur œuvre.
Le répertoire des Youen, comme on l’appelle en Chine, comprend à peu près six cents pièces. M. Paul Perny, dans sa Grammaire de la langue chinoise, a donné les titres d’une centaine
d’entre elles et signalé brièvement les plus intéressantes : la Courtisane savante, l'Enfant prodigue, les Caisses de cinabre, le Songe de Liu-tong-pin, l'Orphelin de la famille Tchao,
d’où Voltaire a tiré son Orphelin de la Chine. M. Bazin, dans le Journal Asiatique (1850-1852), en
avait jadis donné l’analyse sommaire, et, pour plusieurs d’entre elles, des extraits étendus, dont il a inséré ceux qu’il jugeait lui-même les plus intéressants ou les plus caractéristiques dans
le volume de l'Univers pittoresque intitulé Chine moderne. Enfin, le même M. Bazin, sous le titre de
Théâtre chinois, en a traduit quatre intégralement, qui sont : les Intrigues d’une soubrette, la Tunique confrontée, la Chanteuse, et le Ressentiment de Teou-ngo. En y
joignant le Pi-pa-ki, traduit encore par M. Bazin, l'Histoire du cercle de Craie, l'Avare, l'Histoire du pavillon d’Occident, traduits par Stanislas Julien, on voit que si nous ne connaissions pas le théâtre chinois avant M.
Tcheng-ki-tong, ce n’était pas au moins faute de documents. Nous attendions de lui qu’il nous traduisît à son tour ou nous analysât quelques-unes des pièces que nous ne connaissions point.

Comme ils nous les avaient fait connaître, ce sont aussi nos sinologues, avant même
peut-être la naissance du général Tcheng-ki-tong, qui ont essayé de mettre un peu d’ordre, — à l'européenne, — dans le répertoire des pièces du siècle des Youen. Ils y ont donc distingué, d’une
part, les drames historiques, les drames judiciaires, les drames domestiques, les drames tao-sse ; et, de l’autre, les comédies de caractère, les comédies d’intrigues et les comédies
mythologiques. Tous ces noms s’expliquent d’eux-mêmes, à l’exception d’un seul : celui des drames tao-sse.
Les drames tao-sse, parmi lesquels M. Bazin a surtout loué la Transmigration de Yo-cheou, et M. Perny le Songe de Liu-tong-pin, la Dette payable dans la vie à venir,
sont de vives satires, poussées jusqu’à la charge, nullement indignes de notre Palais-Royal, et qui roulent sur les superstitions ou les dogmes du bouddhisme. L’esprit chinois est superstitieux,
mais d’une autre manière, et qui ne l’empêche pas d’être voltairien. Quant aux drames domestiques, ils ne répondent tout à fait à ce que nous entendrions en Europe sous ce nom, si nous en usions,
mais plutôt à de certaines idées très particulières, comme l’on sait, que les Chinois se font de la famille, de ses devoirs, et surtout de sa solidarité continuée d’âge en âge. Tel est le Vieillard qui obtient un fils, dont Abel Rémusat, dans ses Mélanges, a donné une assez ample analyse, et
le sinologue anglais J.-F. Davis, en 1817, une traduction. En y regardant d’un peu près, et en observant d’autre part le plaisir que le général Tcheng-ki-tong semble trouver à la lecture des
plaisanteries ordinaires des drames tao-sse, il est permis de croire que la religion de la famille est à peu près la seule que pratiquent les Chinois éclairés. De là l'importance des
drames domestiques ; et, — bien qu’ils ne diffèrent pas beaucoup, dans la disposition de l’intrigue ou le choix des personnes, du drame judiciaire, par exemple, ou de la comédie d’intrigue, — de
là l’utilité de la distinction : le titre seul en éveille en Chine des idées, des sentiments, où la piété semble avoir autant de part que la curiosité. Je n’ai sans doute pas besoin de définir
les drames judiciaires : nous en avons en France beaucoup plus que nous ne voudrions. Enfin les drames ou comédies mythologiques sont de pures féeries, aussi ridicules que les nôtres, comme cette
pièce des Métamorphoses, où l’on voit au premier acte « un vieux saule mâle » épouser « un jeune pêcher femelle ». Dans ces féeries chinoises, il convient seulement d’ajouter que les
vers, la danse, la musique tiennent lieu de décors et de trucs.
Toutes ces pièces, et le général Tcheng-ki-tong a raison d’en faire expressément la remarque, offrent avec les nôtres, et sans en excepter les drames tao-sse, les plus frappantes
ressemblances. Toutes ou presque toutes, elles se divisent en cinq actes ; le premier qu’on appelle : ouverture ou prologue, et les quatre autres : coupures. Toutes ou presque
toutes, comme les nôtres, elles se nouent et se jouent entre personnages de tout rang et de toute condition. Toutes ou presque toutes, comme les nôtres, elles roulent sur les événements de la vie
quotidienne : un fourbe à démasquer, un coquin à convaincre, un mariage à conclure, une fortune à défendre, un barbon à tromper, — à moins que ce ne soit une respectable mère, comme dans les
Intrigues d’une soubrette. Toutes, ou presque toutes, nomment les nôtres, côtoient de près la réalité, s’y efforcent du moins, mêlent volontiers à l’agrément d’une intrigue amusante les
leçons d’une sagesse moyenne, un peu vulgaire, mais qui sont celles dont on a besoin pour la pratique de la vie. Et il n’est pas enfin jusqu’aux lauréats des concours littéraires qui n’y jouent
le rôle aimable et avantageux que l’ingénieur sorti de l’école polytechnique a joué longtemps dans les pièces de Scribe et de ses imitateurs.
On peut donc, on doit le dire : la comédie de Tching-té-hoei ou celle de Tching-koué-pin, — ce sont des noms d’auteurs, et même d’authoress, — est plus près de nous pour le ton, pour les
mœurs, pour la disposition de l'intrigue et sa nature, que la comédie d’Aristophane ou le drame d’Eschyle. Et, tandis que partout ou presque partout ailleurs, ce sont les ressemblances que l’on
s’applique à discerner pour les mettre en lumière, ici, au contraire, dans le théâtre chinois, c’est sur la différence, uniquement, qu’il convient d’insister.

« Le personnage qui chante » en fait la principale. Dans les pièces du siècle des Youen, un
personnage, qui, d’ailleurs, prend part à l’action, si même on ne doit dire qu’il la conduit, élève quelquefois la voix, et, sur des airs notés, chante une partie de son rôle au lieu de le
déclamer. « C’est ce personnage qui constitue l’originalité de notre scène », dit M. Tcheng-ki-Tong ; et M. Bazin avant lui y avait reconnu « le trait essentiel qui distingue le théâtre chinois
de tous les autres ». Je crains qu’il ne se trompent tous deux. Sans doute, j’aurais besoin, pour parler en toute assurance, de connaître plus de pièces que je n’en ai pu lire dans les
traductions ; mais enfin, dans l’ancien Vaudeville, dans les pièces de notre théâtre de la Foire, dans celles de l’ancien Théâtre-Italien, ne l’ai-je point déjà rencontré, « ce personnage qui
chante » ; et que veut-on que je voie en lui de si rare, de si original, de si particulièrement et spécialement chinois ? Supposé même qu’il soit, comme on fait observer, le représentant du poète
au milieu de l’action, qu’il serve à guider dans une intrigue un peu complexe l'attention du spectateur, qu’il ait encore pour mission de mettre en évidence l'utilité morale de l’œuvre, c’est le
raisonneur, en ce cas, c’est l’Ariste ou le Chrysale des comédies de Molière, c’est le bouffon ou le fou des drames de Shakspeare, et voilà longtemps qu’il nous est familier.
Ce serait, d’ailleurs, une question de savoir si son rôle est vraiment et toujours celui que l’on nous dit. Ils sont en effet quelquefois plusieurs « personnages qui chantent » ; ils chantent
souvent pour dire des banalités ou faire des plaisanteries qui n’importent pas plus à la conduite de la vie qu’à celle de la pièce ; et j’ai peine à voir dans leurs ariettes « le génie même du
poète parlant au spectateur ». Veut-on voir les choses comme elles sont, et ne rien exagérer ? Dans des œuvres d’un art déjà savant et même raffiné, « le personnage qui chante » n’est rien de
plus, à notre avis, que le témoignage survivant d’un art antérieur, plus naïf, moins maître de ses procédés, et qui sentait le besoin d’attirer l’attention sur la beauté des choses qu’il
disait.
« L’intérêt ou l’intention morale » des œuvres du théâtre chinois est une autre différence, où je comprends très bien que le général Tcheng-ki-tong, pour se donner sur nous un facile avantage,
croie devoir insister, mais non pas nos sinologues. C’est prendre un peu trop à la lettre les affirmations des critiques chinois. S’il est écrit dans le Code pénal que l’objet des représentations théâtrales est d’offrir sur la scène des « peintures fictives ou réelles d’hommes justes et bons, de
femmes chastes, d’enfants affectueux et obéissants » ; il y est également écrit que l’on ne représentera sur les planches « ni les empereurs, ni les impératrices, ni les princes, les ministres et
les généraux fameux des premiers âges » ; mais, puisque les drames historiques violent impunément la défense, on peut tenir pour assuré que les comédies d’intrigue ou de caractère ne se piquent
pas davantage d’observer le précepte. Je ne vois pas ombre d’intention morale dans les Intrigues d'une soubrette, et, d’après les analyses que l’on nous a données de plusieurs autres
pièces, je ne vois même pas très clairement par où la morale s’y pourrait introduire. On ajoute que plusieurs comédies d’intrigues sont choquantes et contiennent des scènes dont la crudité ne le
céderait pas à celle même de quelques-unes des comédies d’Aristophane. A la Chine comme chez nous, la première loi que s’imposent les auteurs dramatiques est de plaire, et de plaire à tout prix ;
ils moralisent ensuite, s’ils le peuvent et comme ils le peuvent.
C’est autre chose, à la vérité, quand, sous le nom de morale, au lieu de s’en tenir aux règles de l'honnête et du juste, on prétend envelopper, comme le font quelques-uns, la conduite entière de
l’existence, et, selon l’expression de M. Tcheng-ki-tong, « l’expérience des choses de la vie ». Je lui fais seulement observer qu’à ce compte, les Scapin aussi, et les Lisette, nos Suzanne et
nos Figaro, ont leur « expérience des choses de la vie », une expérience très étendue, très sûre, et, d’ailleurs, parfaitement immorale. Il ne s’agit que de s’entendre sur le vrai sens des mots.
Le théâtre chinois, comme le nôtre, est moral dans la mesure où il peint les mœurs, et les mauvaises mœurs de préférence aux bonnes, qui ne sont point piquantes.

Ces différences, on le voit, ne sont qu’à la surface, et dès que l’on essaie de les
approfondir, je ne sais si l’on ne peut prétendre qu’elles se tournent en ressemblances. Entre notre théâtre et le théâtre chinois la seule différence réelle que je trouve, — sans parler, on
l’entend bien, de celles que des institutions, des mœurs, des coutumes différentes y mettent, et qui ne sont rien d’essentiel, — c’est la différence du balbutiement de l’enfant à la parole de
l’homme fait. Le théâtre chinois est l’œuvre d’une civilisation évidemment très ancienne, et, comme telle, très avancée à beaucoup d’égards ; mais en beaucoup de points aussi demeurée dans
l’enfance, ou, si l’on aime mieux, immobilisée dans des formes rigides dont elle n’a pu réussir, de nos jours même, à se débarrasser. Les Chinois ressemblent à des enfants très intelligents et
très vieux. Voilà longtemps qu’ils ont atteint un point de civilisation matérielle et morale où nous ne faisons que de toucher à peine, si même nous y sommes ; seulement, ils s’y sont arrêtés,
et, tant qu’ils continueront de vivre sur eux-mêmes, ils y resteront, ayant dépensé pour y parvenir tout ce qu’ils avaient effectivement en eux. C’est du moins ce que l’on peut conclure de
l’histoire de leur théâtre. Au siècle des Youen, ils en étaient déjà où nous ne sommes arrivés que deux ou trois siècles après eux, mais ils y sont toujours. Et, si les analogies, comme on l’a
vu, sont frappantes entre leurs pièces et les nôtres à un moment quelconque de l’histoire de notre théâtre, elles le seraient bien plus encore si nous faisions la comparaison des drames des Youen
à nos antiques moralités ou à nos drames savants du XVIe siècle. Dans l’histoire générale de la littérature comme dans l’histoire naturelle, presque toutes les questions de race et de
milieu se ramènent à des questions de moment. La Chine a eu ses Gringoire, ses Jodelle et ses Hardi, et elle les a eus bien avant les nôtres, mais leurs successeurs n’ont eu nom
ni Corneille, ni Racine, ni Molière.
Il n’y aurait pas jusqu’aux renseignements qu’on nous donne sur les conditions matérielles du théâtre chinois qui ne servissent à justifier et fortifier cette indication. Le divertissement du
théâtre n’est nulle part plus passionnément goûté ; cependant il n’y a pas en Chine de théâtres fixes ni de troupes régulières. Le comédiens vont de ville en ville, un peu à l’aventure, dressent
leurs tréteaux sur la place publique, avec l’agrément ou sur l’invitation des autorités locales, donnent des représentations à domicile, se contentent, comme leurs spectateurs, d’une toile de
fond pour tout décor, et au besoin suppléent le paysage, la forêt, le palais, les tapis, les meubles qui leur manquent par une pompeuse annonce.
« Ainsi, dit M. Tcheng-ki-tong, notre public entre instantanément en communication avec la fiction du poète... Ainsi le spectateur ne subit pas l’action, il la conduit lui-même... Ainsi l’idéal
devient le réel, sans plus d’effort qu’il n’en coûte à la volonté pour créer une illusion... »
Ce petit morceau, que j’abrège, est à coup sûr d’un homme d’esprit, et je me suis un instant demandé si cet homme d’esprit n’avait pas raison. Quand le spectateur, comme aujourd’hui, va chercher
au théâtre, avant tout, le plaisir des yeux, ne s’intéresse pas moins aux costumes qu’au dialogue, et pardonne, en quelque sorte, la puérilité, la faiblesse, l’invraisemblance de l’intrigue à la
prétendue vérité de la couleur locale ou du décor historique, l’art dramatique est bien malade, et l’on peut bien encore l’aimer et l’aimer passionnément, mais ce n’est plus pour lui-même. Il ne
reste pas moins vrai que, Français ou Allemands, Anglais ou Espagnols, tous ces détails que l’on nous donne ici sur les conditions matérielles de la scène chinoise nous reportent au temps de ce
que nous appelons l’enfance de notre art dramatique. C’est ainsi qu’en effet, au théâtre du Globe, du temps de Shakspeare et de Ben Jonson, un écriteau tenait lieu de décor aux imaginations
anglaises ; c’est ainsi que chez nous, au commencement encore du XVIIe siècle, la caravane du Roman comique se déroulait sur nos grand’routes ; c’est ainsi que Molière lui-même, avec sa
troupe, dont les sociétaires n’étaient pas encore ce qu’ils sont devenus, allait donner, pour un prix modéré, des représentations en ville... Seulement, jusque de nos jours les choses continuent
de se passer en Chine comme au temps des Kin et des Youen, en l’an de grâce 1886 comme jadis en 1325, et six siècles bientôt passés n’ont rien changé aux conditions ou traditions de la scène
chinoise.

Il est un dernier point sur lequel nous eussions désiré quelques éclaircissements. Après
avoir placé les commencements du théâtre chinois au VIIIe siècle de notre ère, les auteurs en font l’histoire, la divisent en plusieurs époques, la conduisent régulièrement jusqu’au siècle des
Youen, et tout à coup s’arrêtent, comme si le drame chinois, depuis lors, « avait fait son repos de sa stérilité ». Qu’est ce à dire ? Et que devons-nous croire ?
« On joue sur le théâtre chinois, dit M. Paul Perny, des pièces qui ont de mille à douze cents ans de date : elles sont comprises comme si elles dataient d’hier. »
Et il semble insinuer que ces antiquités formeraient, elles toutes seules, tout le répertoire du théâtre chinois. De son côté, M. Théophile Piry nous apprend que le roman des Pruniers merveilleux « forme le sujet d’une pièce de théâtre des plus goûtées en Chine » ; et lui-même ne fait pas
remonter la rédaction du roman au delà du XVIIe ou XVIe siècle de notre ère. Nous savons encore que le Pi-pa-ki,
ou Histoire du luth, qui peut-être serait le chef-d’œuvre du théâtre chinois, si ses dimensions n’en faisaient plutôt un roman dialogué qu’un drame ou une comédie, date à peine de la
fin du XIVe siècle. Enfin tous les voyageurs nous parlent à l’envi des représentations dramatiques où ils ont assisté à Shanghaï, à Canton, à Pékin ; et les titres des pièces qu’ils ont vu jouer
ne ressemblent guère aux titres de celles que nous connaissons. Cependant ni Bazin, dans sa Chine moderne, ni
M. Paul Perny, ni M. Tcheng-ki-tong n’ont poussé leur histoire du théâtre chinois au delà du siècle des Youen. La matière leur a-t-elle manqué, ou ont-ils fait défaut à la matière ?
On aimerait au moins à le savoir, et le moindre renseignement de ce genre eût mieux fait notre affaire que les plaisanteries, fort agréables sans doute, quoique un peu vieilles peut-être, du
général Tcheng-ki-tong sur « l’esprit de Paris » et autres sujets circonvoisins. Ce général chinois est devenu vraiment trop Parisien ; il nous parle trop de nous-mêmes, pas assez de la Chine ;
et, décidément, il se déguise trop. A moins peut-être que nous ne soyons nous-mêmes et au fond plus Chinois que nous ne le croyons. Si quelques années de Paris ont suffi pour faire de M.
Tcheng-ki-tong un Parisien tellement achevé, c’est peut-être que tous les Chinois ne sont pas à la Chine, et qu’il y a parmi nous des mandarins sans le savoir, mandarins administratifs et
mandarins de lettres, et aussi moins de Parisiens qu’on ne le pense à Paris. Sérieusement, dans les ressemblances et dans les affinités du théâtre chinois avec le nôtre, comme aussi dans celles
de la littérature chinoise avec la littérature européenne en général, pour le fond sinon pour la forme, il ne se peut pas que l’on ne voie que des rapports de surface, et il doit y avoir quelque
chose de plus.
Tutto il mundo e fatto come la nostra famiglia : ce serait une belle occasion de répéter le mot d’Arlequin, et de s’en prendre à la psychologie des nationalités. Oui, les différences ne
sont qu’à l’extérieur, et dans toutes les races d’hommes comme sous toutes les latitudes, c’est toujours un peu et partout la même chose. Quelques particularités locales n’empêchent pas qu’à la
Chine et ailleurs, ce soient les même « biens » que les hommes poursuivent ; les mêmes besoins, les mêmes désirs, les mêmes passions qui les meuvent à cette poursuite ; et, au bout de la course
le même néant, ou du moins la même mort qui les attende. Si les soubrettes du théâtre chinois ne valent pas peut-être les nôtres, les Marinette et les Nérine, les Lisette et les Dorine de notre
vieux répertoire, il faut avouer cependant qu’elles leur ressemblent fort ; et, en Chine comme chez nous, le rêve des bacheliers, — et de leur famille, — est le même : un bon emploi, bien renté,
et un beau mariage. Chose plus étonnante ! les passions s’y trahissent de la même manière, par les mêmes symptômes, elles y tiennent le même langage et y causent les mêmes désordres. En Chine,
qui le croirait ? l’ivrognerie consiste à boire plus que de raison, et l’avarice à tenir trop serrés les cordons de sa bourse. Comme le seigneur Harpagon, le seigneur Kou-jin prête sur gages ; et
quand Li-taï-pé célèbre les plaisirs de l’ivresse, ni Désaugiers ni Panard ne sont mieux inspirés par le vin. J’ai déjà dit plus haut que les héros de roman, très différents en cela de Sindbad le
marin ou même d’Ali-Baba, n’accomplissaient guère d’exploits qui ne fussent à la taille de nos bacheliers. Il est vrai qu’une fois bacheliers, on les voit aspirer à devenir licenciés ; à la
Chine, tous les sous-chefs aspirent à devenir chef, tous les sous-préfets à devenir préfet, et tous les secrétaires d’État à devenir ministre. Voilà sans doute, pour le coup, quelque chose de
tout à fait extraordinaire.
Je ne sais, à ce propos, si je dois hasarder une pensée singulière ; mais ne serait-ce pas nous dont la naïveté, soutenue d’un grand fonds d’ignorance, mettrait entre les hommes des différences
qui n’y sont point ? Par exemple, il nous paraît bizarre, et même extravagant qu’au lieu de filets de sole ou de maquereau, je suppose, un homme se nourrisse d’ailerons de requin ; et, de là,
nous inférons qu’il doit avoir le corps autrement fait que nous. C’est un syllogisme dont la majeure pourrait être ainsi mise en forme : il n’y a d’hommes dignes de ce nom que ceux dont la table
est servie comme la nôtre ; et cette majeure semble au moins contestable. De même encore, n’ayant pas, nous, les yeux obliques et les pommettes saillantes, nous avons décidé qu’un Chinois, les
ayant tels, ne saurait ni sentir, ni penser comme nous : il y aurait là de quoi parler beaucoup. Mais, s’il se nomme enfin Pé-min-Tchong ou Tchao-hing-sun, oh ! alors, nous avons vraiment de la
peine à le prendre au sérieux : — en effet, rue Charlot, au Marais, ou du côté des Batignolles, on s’appelle, plus ordinairement Nonancourt ou Beauperthuis ; — et on nous persuadera peut-être, en
s’y prenant bien, que Pé min-Tchong est notre semblable, mais non pas jamais qu’il puisse être notre égal.
Il l’est pourtant ; et ce qu’il y a de plus admirable, c’est qu’en réalité nous ressemblons bien plus à Pé-min-tchong ou à Tchao-hing-sun qu’à aucun des héros du Shah Nameh ou du
Mahabharata, que dis-je ? plus qu’à ceux même peut-être de l'Iliade ou des Niebelungen. L’ethnographie, la linguistique, la psychologie des races auront beau dire, elles ne prévaudront
pas contre l’histoire. Oui, assurément, pour l’ethnographie, s’il existe une race qui diffère de la nôtre, c’est la jaune, en admettant d’abord qu’il y ait une race jaune ; et c’est la chinoise,
en admettant que les quatre cent millions d’hommes qui peuplent cet énorme empire appartiennent à une seule et même race : deux points, pour le dire en passant, qui ne sont pas encore démontrés,
ni seulement établis. Oui, s’il est une langue dont les sons n’apportent rien de connu à nos oreilles, dont les caractères ne représentent à nos yeux rien de déjà vu, dont la logique enfin
déroute toute la nôtre, c’est la langue des Thai-tseu, la langue du Hao-kieou-tchouan (la Femme accomplie ou
l'Union fortunée) et la langue du Pin-chan-lin-yen (les Deux Jeunes Filles lettrées). Eh
oui, encore, s’il est une civilisation dont les coutumes soient faites pour exciter à la chicane ce que Voltaire appelait « notre esprit contentieux », c’est le pays où, sous l’uniformité d’un
même vêtement, s’évanouit en quelque sorte la distinction des sexes ; où l’on se garderait, comme d’une grossière impolitesse, de se découvrir devant un supérieur ; où l’on dit qu’un cercueil est
le plus beau présent que l’on puisse faire à un parent âgé. A ne considérer que l'extérieur, nous sommes plus voisins d’un Huron, s’il en existe encore, que d’un Céleste, comme l’on dit ; — nous
le croyons du moins, et il le croit ainsi lui-même.
Ouvrons cependant les livres de cet « homme jaune » et consultons l’histoire de « cette face de lune » : voici qu’aussitôt nous nous sentons apparentés de plus près à cet étranger qu’à la plupart
de ceux qui passent pour sortir avec nous d’une même origine : l’Indou, le Persan, le Slave même peut-être. Et réciproquement c’est lui qui, de tous les Asiatiques, avec le plus d’aisance et de
sûreté, dès qu’il le veut, s’assimile tout ce qu’il veut de nos habitudes et de nos pratiques. Quel est donc ce mystère, ou plutôt cette énigme ? et pourquoi passe-t-on à côté d’elle comme sans
la voir ?
« Comment se fait-il, demandait jadis M. Émile Montégut, comment se fait-il que ces frères mongoliques semblent avoir avec les nations européennes une parenté d’âme et d’intelligence si étroite,
tandis que les autres peuples orientaux, qui sont nos véritables parents selon la chair et les lois de la race, n’ont avec nous, pour ainsi dire, qu’une parenté de visage et de couleur ? Comment
se fait-il que nous retrouvions en Chine la morale que nous considérons comme la plus favorable au bonheur du genre humain, le même esprit d’humanité que nous considérons comme le meilleur
instrument du perfectionnement de notre espèce, le même rationalisme éclairé que nous considérons comme la véritable religion de l’homme civilisé ! Comment se fait-il enfin que les seuls peuples
qui nous soient parents par l’âme soient précisément ceux qui, selon la critique, nous sont étrangers par la race, les Juifs et les Chinois ? »
La question est toujours pendante, elle offre toujours le même intérêt ; et aussi les mêmes difficultés. Mais n’est-elle pas digne d’être enfin traitée ? car, si l’on ne la traite pas, on avoue
qu’elle est insoluble ; et, si elle est insoluble, que reste-t-il de la prétendue psychologie des nationalités ? J’inclinerais pour ma part à la croire en effet insoluble.
1er mars 1886.


















