Voltaire (1694-1778)
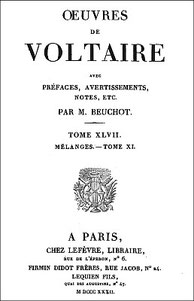
FRAGMENT SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE. CHINE
Firmin Didot frères, Paris, 1832, tome 47 des œuvres de Voltaire, pages 518-531. Première édition 1773.
- La virulence anti-chinoise de Cornelius de Pauw, dans ses Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois (1773), méritait une réponse. Elle fut double, au moins. De Pékin, le père Amiot écrira, en 1777, et la lettre sera publiée dans le tome VI des Mémoires concernant les Chinois, en 1780, distance oblige.
- Voltaire se devait de défendre la Chine face à Pauw. Trois articles de Fragment sur l'histoire générale, publiés en 1773, remplissent ce rôle. Ils seront suivis en 1776 de Lettres chinoises, indiennes et tartares à M. Pauw.
Les trois articles :
Article II. — De la Chine
Article III. — De la population de la Chine, et des mœurs
Article IV. — Si les Égyptiens ont peuplé la Chine, et si les Chinois ont mangé des hommes
Feuilleter
Télécharger/Lire aussi
Il ne nous fallut ni de profondes recherches, ni un grand effort pour avouer que les Chinois, ainsi que les Indiens, ont précédé dès longtemps
l'Europe dans la connaissance de tous les arts nécessaires. Nous ne sommes point enthousiastes des lieux éloignés et des temps antiques ; nous savons bien que l'orient entier, loin d'être
aujourd'hui notre rival en mathématiques et dans les beaux arts, n'est pas digne d'être notre écolier ; mais, s'ils n'ont pas décoré, comme nous, le grand édifice des arts, ils l'ont construit.
Nous crûmes, sur la foi des voyageurs et des missionnaires de toute espèce, tous d'accord ensemble, que les Chinois inventèrent l'imprimerie environ deux mille ans avant qu'on l'imitât dans la
Basse-Allemagne ; car on y grava d'abord des planches en bois, comme à la Chine, et ce ne fut qu'après ce tâtonnement de l'art qu'on parvint à l'admirable invention des caractères mobiles. Nous
dîmes que les Chinois n'ont jamais pu imiter à leur tour l'imprimerie d'Europe. M. Warburton, qui ne hait pas à tomber sur les Français, crut que nous proposions aux Chinois de fondre des
caractères de leurs quatre-vingt-dix mille mots symboliques. Non ; mais nous désirâmes que les Chinois adoptassent enfin l'alphabet des autres nations, sans quoi il ne sera guère possible qu'ils
fassent de grands progrès dans des sciences qu'ils ont inventées.
Toutefois leur méthode de graver sur planche nous paraît avoir de grands avantages sur la nôtre. Premièrement le graveur qui imprime n'a pas besoin d'un fondeur ; secondement le livre n'est pas
sujet à périr, la planche reste ; troisièmement les fautes se corrigent aisément après l'impression ; quatrièmement le graveur n'imprime qu'autant d'exemplaires qu'on lui en demande ; et par là
on épargne cette énorme quantité d'imprimés qui chez nous se vendent au poids pour servir d'enveloppes aux ballots.
Il paraît incontestable qu'ils ont connu le verre avant nous. L'auteur des Recherches philosophiques sur les Égyptiens et sur les Chinois, vrai savant, puisqu'il pense, et qui ne paraît
pas trop prévenu en faveur des modernes, dit que les Chinois n'ont encore que des fenêtres de papier. Nous en avons aussi beaucoup, et surtout dans nos provinces méridionales ; mais des officiers
très dignes de foi nous ont assuré qu'ils avaient été invités à dîner auprès de Kanton dans des maisons dont les fenêtres étaient figurées en arbres chargés de feuilles et de fruits, qui
portaient entre leurs branches de beaux dessins d'un verre très transparent.
Il n'y a pas soixante ans que notre Europe a imité la porcelaine de la Chine : nous la surpassons à force de soins ; mais ces soins mêmes la rendent très chère, et d'un usage peu commun. Le grand
secret des arts est que toutes les conditions puissent en jouir aisément.
M. de Pauw, auteur des Recherches philosophiques, ne fait pas des réflexions indulgentes. Il reproche aux Chinois leurs tours vernissées à neuf étages, sculptées, et ornées de
clochettes. Quel est l'homme pourtant qui ne voudrait pas en avoir une au bout de son jardin, pourvu qu'elle ne lui cachât pas la vue ? le grand-prêtre juif avait des cloches au bas de sa robe ;
nous en mettons au cou de nos vaches et de nos mulets. Peut-être qu'un carillon aux étages d'une tour serait assez plaisant.
Il condamne les ponts qui sont si élevés que les mâts de tous les bateaux passent facilement sous les arcades, et il oublie que, sur les canaux d'Amsterdam et de Rotterdam, on voit cent
pont-levis qu'il faut lever et baisser plusieurs fois jour et nuit.
Il méprise les Chinois, parce qu'ils aiment mieux construire leurs maisons en étendue qu'en hauteur. Mais du moins il faudrait avouer qu'ils avaient des maisons vernies plusieurs siècles avant
que nous eussions des cabanes où nous logions avec notre bétail, comme on fait encore en Vestphalie ; au reste, chacun suit son goût. Si on aime mieux loger à un septième étage, qu'au
rez-de-chaussée ; si l'on préfère le danger du feu et l'impossibilité de l'éteindre, quand il prend au faîte d'un logis, à la facilité de s'en sauver quand la maison n'a qu'un étage ; si les
embarras, les incommodités, la puanteur, qui résultent de sept étages établis les uns sur les autres, sont plus agréables que tous les avantages attachés aux maisons basses, nous ne nous y
opposons pas. Nous ne jugeons point du mérite d'un peuple par la façon dont il est logé ; nous ne décidons point entre Versailles et la grande maison de l'empereur chinois, dont frère Attiret
nous a fait depuis peu la description.
Nous voulons bien croire qu'il y eut autrefois en Égypte un roi appelé d'un nom qui a quelque rapport à celui de Sésostris, lequel n'est pas plus un mot égyptien que ceux de Charles et de
Frédéric. Nous ne disputerons point sur une prétendue muraille de trente lieues, que ce prétendu Sésostris fit élever pour empêcher les voleurs arabes de venir piller son pays. S'il construisit
ce mur pour n'être point volé, c'est une grande présomption qu'il n'alla pas lui-même voler les autres nations, et conquérir la moitié du monde pour son plaisir, sans se soucier de la gouverner,
comme nous l'assure M. Larcher, répétiteur au collège Mazarin.
Nous ne croyons pas un mot de ce qu'on nous dit d'une muraille bâtie par les juifs, commençant au port de Joppé, qui ne leur appartenait point, jusqu'à une ville inconnue nommée Carpasabé, tout
le long de la mer, pour empêcher un roi Antiochus de s'avancer contre eux par terre. Nous laissons là tous ces retranchements, toutes ces lignes qui ont été d'usage chez tous les peuples : mais
il faut convenir que la grande muraille de la Chine est un des monuments qui font le plus d'honneur à l'esprit humain. Il fut entrepris trois cents ans avant notre ère : la vanité ne le
construisit pas comme elle bâtit les pyramides. Les Chinois n'imitèrent point les Huns, qui élevèrent des palissades de pieux et de terre pour s'y retirer après avoir pillé leurs voisins.
L'esprit de paix seul imagina la grande muraille. Il est certain que la Chine, gouvernée par les lois, ne voulut qu'arrêter les Tartares, qui ne connaissaient que le brigandage. C'est encore une
preuve que la Chine n'avait point été peuplée par des Tartares, comme on l'a prétendu. Les mœurs, la langue, les usages, la religion, le gouvernement, étaient trop opposés. La Grande muraille fut
admirable et inutile : le courage et la discipline militaire eussent été des remparts plus assurés.
M. de Pauw a beau regarder avec des yeux de mépris tous les ouvrages de la Chine, il n'empêchera pas que le Grand canal, fait de main d'homme, dans la longueur de cent soixante de nos grandes
lieues, et les autres canaux qui traversent ce vaste empire, ne soient un exemple qu'aucune nation n'a pu encore imiter : les Romains mêmes ne tentèrent jamais une telle entreprise.
Voilà donc deux travaux immenses qui n'ont pour but que l'utilité publique ; la Grande muraille qui devait défendre l'empire chinois, et les
canaux qui favorisent son commerce. Joignons-y un avantage encore plus grand, celui de la population, qui ne peut être que le fruit de l'aisance et de la sûreté de chaque citoyen dans sa petite
possession en temps de paix ; les mendiants ne se marient en aucun lieu du monde. La polygamie ne peut être regardée comme contraire à la population, puisque, par le fait, les Indes, la Chine, le
Japon, où la polygamie fut toujours reçue, sont les pays les plus peuplés de l'univers. S'il est permis de citer ici nos livres sacrés, nous dirons que Dieu même, en permettant aux juifs la
pluralité des femmes, leur promit que leur race serait multipliée comme les sables de la mer.
On allègue que la nature fait naître à peu près autant de femelles que de mâles, et que par conséquent si un homme prend quatre femmes, il y a trois hommes qui en manquent. Mais il est avéré
aujourd'hui que, dans l'Europe, s'il naît un dix-septième de plus d'hommes que de femmes, il en meurt aussi beaucoup plus avant l'âge de trente ans par la guerre, par la multitude des professions
pénibles, plus meurtrières encore que la guerre, et par les débauches non moins funestes. Il en est probablement de même en Asie. Tout État, au bout de trente ans, aura donc moins de mâles que de
femelles. Comptez encore les eunuques et les bonzes, il restera peu d'hommes. Enfin observez qu'il n'y a que les premiers d'un État, presque toujours très opulents, qui puissent entretenir
plusieurs femmes, et vous verrez que la polygamie peut être non seulement utile à un empire, mais nécessaire aux grands de cet empire.
Considérez surtout que l'adultère est très rare dans l'orient, et que dans les harem, gardés par des eunuques, il est impossible. Voyez au contraire comme l'adultère marche la tête levée dans
notre Europe ; quel honneur chacun se fait de corrompre la femme d'autrui ; quelle gloire se font les femmes d'être corrompues ; que d'enfants n'appartiennent pas à leurs pères ; combien les
races les plus nobles sont mêlées et dégénérées. Jugez après cela lequel vaut le mieux, ou d'une polygamie permise par les lois, ou d'une corruption générale autorisée par les mœurs.
Si, dans la Chine, plusieurs femmes de la lie du peuple exposent leurs enfants, dans la crainte de ne pouvoir les nourrir, c'est peut-être encore une preuve en faveur de la polygamie ; car si ces
femmes avaient été belles, si elles avaient pu entrer dans quelque sérail, leurs enfants auraient été élevés avec des soins paternels.
Nous sommes loin d'insinuer qu'on doive établir la polygamie dans notre Europe chrétienne. Le pape Grégoire II, dans sa décrétale adressée à saint Boniface, permit qu'un mari prît une seconde
femme quand la sienne était infirme. Luther et Melanchthon permirent au landgrave de Hesse deux femmes, parce qu'il avait au nombre de trois ce qui chez les autres se borne à deux. Le chancelier
d'Angleterre Cowper, qui était dans le cas ordinaire, épousa cependant deux femmes sans demander permission à personne ; et ces deux femmes vécurent ensemble dans l'union la plus édifiante : mais
ces exemples sont rares.
Quant aux autres lois de la Chine, nous avons toujours pensé qu'elles étaient imparfaites, puisqu'elles sont l'ouvrage des hommes qui les exécutent. Mais qu'on nous montre un autre pays où les
bonnes actions soient récompensées par la loi, où le laboureur le plus vertueux et le plus diligent soit élevé à la dignité de mandarin sans abandonner sa charrue : partout on punit le crime; il
est plus beau sans doute d'encourager à la vertu.
À l'égard du caractère général des nations, la nature l'a formé, le sang des Chinois et des Indiens est peut-être moins âcre que le nôtre, leurs mœurs plus tranquilles. Le bœuf est plus lent que
le cheval, et la laitue diffère de l'absinthe.
Le fait est qu'à notre orient et à notre occident la nature a de tout temps placé des multitudes d'êtres de notre espèce que nous ne connaissons que d'hier. Nous sommes sur ce globe comme des
insectes dans un jardin : ceux qui vivent sur un chêne rencontrent rarement ceux qui passent leur courte vie sur un orme.
Rendons justice à ceux que notre industrie et notre avarice ont été chercher par-delà le Gange : ils ne sont jamais venus dans notre Europe pour gagner quelque argent ; ils n'ont jamais eu la
moindre pensée de subjuguer notre entendement, et nous avons passé des mers inconnues pour nous rendre maîtres de leurs trésors, sous prétexte de leur rendre le service de gouverner leurs
âmes.
Quand les Albuquerques vinrent ravager les côtes de Malabar, ils menaient avec eux des marchands, des missionnaires, et des soldats. Les missionnaires baptisaient les enfants que les soldats
égorgeaient ; les marchands partageaient le gain avec les capitaines ; le ministère portugais les rançonnait tous ; et des auteurs moines, traduits ensuite par d'autres moines, transmettaient à
la postérité tous les miracles que fit la sainte Vierge dans l'Inde pour enrichir des marchands portugais.
Les Européens entraient alors dans deux mondes nouveaux ; celui de l'occident a été presque tout entier noyé dans son sang. Si des fanatiques d'Europe ne sont pas venus à bout d'exterminer
l'orient, c'est qu'ils n'en ont pas eu la force ; car le désir ne leur a pas manqué, et ce qu'ils ont fait au Japon ne l'a prouvé que trop à leur honte éternelle.
Ce n'est pas ici le lieu de retracer aux yeux épouvantés des lecteurs judicieux ces portraits que nous avons déjà exposés de la subversion de tant d'États sacrifiés aux fureurs de l'avarice et de
la superstition, plus cruelle encore que la soif des richesses. Contenons-nous dans les bornes des recherches historiques.
Nous avons toujours soupçonné que les grands peuples des deux continents ont été autochtones, indigènes, c'est-à-dire originaires des
contrées qu'ils habitent comme leurs quadrupèdes, leurs singes, leurs oiseaux, leurs reptiles, leurs poissons, leurs arbres, et toutes leurs plantes.
Les rangifères de la Laponie et les girafes d'Afrique ne descendent point des cerfs d'Allemagne et des chevaux de Perse. Les palmiers d'Asie ne viennent point des poiriers d'Europe. Nous avons
cru que les nègres n'avaient point des Irlandais pour ancêtres. Cette vérité est si démontrée aux yeux qu'elle nous a paru démontrée à l'esprit ; non que nous osions, avec saint Thomas, dire que
l'Être suprême, agissant de toute éternité, ait produit de toute éternité ces races d'animaux qui n'ont jamais changé parmi les bouleversements d'une terre qui change toujours. Il ne nous
appartient pas de nous perdre dans ces profondeurs ; mais nous avons pensé que ce qui est a du moins été longtemps. Il nous a paru, par exemple, que les Chinois ne descendent pas plus d'une
colonie d'Égypte que d'une colonie de Basse-Bretagne. Ceux qui ont prétendu que les Égyptiens avaient peuplé la Chine ont exercé leur esprit et celui des autres. Nous avons applaudi à leur
érudition et à leurs efforts ; mais ni la figure des Chinois, ni leurs mœurs, ni leur langage, ni leur écriture, ni leurs usages, n'ont rien de l'antique Égypte. Ils ne connurent jamais la
circoncision : aucune des divinités égyptiennes ne parvint jusqu'à eux : ils ignorèrent toujours les mystères d'Isis.
M. de Pauw, auteur des Recherches philosophiques, a traité d'absurde ce système qui fait des Chinois une colonie égyptienne, et il se fonde sur les raisons les plus fortes. Nous ne
sommes pas assez savants pour nous servir du mot absurde ; nous persistons seulement dans notre opinion que la Chine ne doit rien à l'Égypte. Le père Parennin l'a démontré à M. de Mairan. Quelle
étrange idée dans deux ou trois têtes de Français qui n'étaient jamais sortis de leur pays, de prétendre que l'Égypte s'était transportée à la Chine, quand aucun Chinois, aucun Égyptien n'a
jamais avancé une telle fable !
D'autres ont prétendu que ces Chinois si doux, si tranquilles, si aisés à subjuguer et à gouverner, ont, dans les anciens temps, sacrifié des hommes à je ne sais quel dieu, et qu'ils en ont mangé
quelquefois. Il est digne de notre esprit de contradiction de dire que les Chinois immolaient des hommes à Dieu, et qu'ils ne reconnaissaient pas de Dieu. Pour le reproche de s'être nourris de
chair humaine, voici ce que le père Parennin avoue à M. Mairan :
« Enfin, si l'on ne distingue pas les temps de calamités des temps ordinaires, on pourra dire de presque toutes les nations, et de celles qui sont les mieux policées, ce que des Arabes ont dit
des Chinois ; car on ne nie pas ici que des hommes réduits à la dernière extrémité n'aient quelquefois mangé de la chair humaine ; mais on ne parle aujourd'hui qu'avec horreur de ces malheureux
temps, auxquels, disent les Chinois, le ciel, irrité contre la malice des hommes, les punissait par le fléau de la famine, qui les portait aux plus grands excès.
« Je n'ai pas trouvé néanmoins que ces horreurs soient arrivées sous la dynastie des Tang, qui est le temps auquel ces Arabes assurent qu'ils sont venus à la Chine, mais à la fin de la dynastie
des Han, au second siècle après Jésus-Christ. »
Ces Arabes dont parlent MM. de Mairan et Parennin sont les mêmes que nous avons déjà cités ailleurs. Ils voyagèrent, comme nous l'avons dit, à la Chine, au milieu du neuvième siècle, quatre cents
ans avant ce fameux Vénitien Marco Paolo, qu'on ne voulut pas croire lorsqu'il disait qu'il avait vu un grand peuple plus policé que les nôtres, des villes plus vastes, des lois meilleures en
plusieurs points. Les deux Arabes y étaient abordés dans un temps malheureux, après des guerres civiles et des invasions de barbares, au milieu d'une famine affreuse. On leur dit, par
interprètes, que la calamité publique avait été au point que plusieurs personnes s'étaient nourries de cadavres humains. Ils firent comme presque tous les voyageurs, ils mêlèrent un peu de vérité
à beaucoup de mensonges.
Le nombre des peuples que ces deux Arabes nomment anthropophages est étonnant : ce sont d'abord les habitants d'une petite île auprès de Ceilan, peuplée de noirs. Plus loin sont d'autres îles
qu'ils appellent Rammi et Angaman, où les peuples dévoraient les voyageurs qui tombaient entre leurs mains. Ce qu'il y a de triste, c'est que Marco Paolo dit la même chose, et que l'archevêque
Navarrete l'a confirmée au dix-septième siècle, à los Europeos que cogen es constante que vivos se los van comiendo.
Texera dit que les Javans avaient encore cette abominable coutume au commencement du seizième siècle, et que le mahométisme a eu de la peine à l'abolir. Quelques hordes de Cafres et d'Africains
ont été accusées de cette horreur.
Si on ne nous a point trompés sur la Chine, si, dans un de ces temps désastreux où la faim ne respecte rien, quelques Chinois se livrèrent à une action de désespoir qui soulève la nature,
souvenons-nous toujours qu'en Hollande la canaille de La Haye mangea de nos jours le cœur du respectable de Witt, et que la canaille de Paris mangea le cœur du maréchal d'Ancre. Mais
souvenons-nous aussi que ceux qui percèrent ces cœurs furent cent fois plus coupables que ceux qui les mangèrent. Songeons à nos matines de Paris ; à nos vêpres de Sicile, en pleine paix ; aux
massacres d'Irlande, pendant lesquels les Irlandais catholiques faisaient de la chandelle avec la graisse des Anglais protestants. Songeons aux massacres des vallées du Piémont, à ceux du
Languedoc, et des Cévennes, à ceux de tant de millions d'Américains par des Espagnols qui récitaient leur rosaire, et qui établissaient des boucheries publiques de chair humaine. Détournons les
yeux, et passons vite.

















